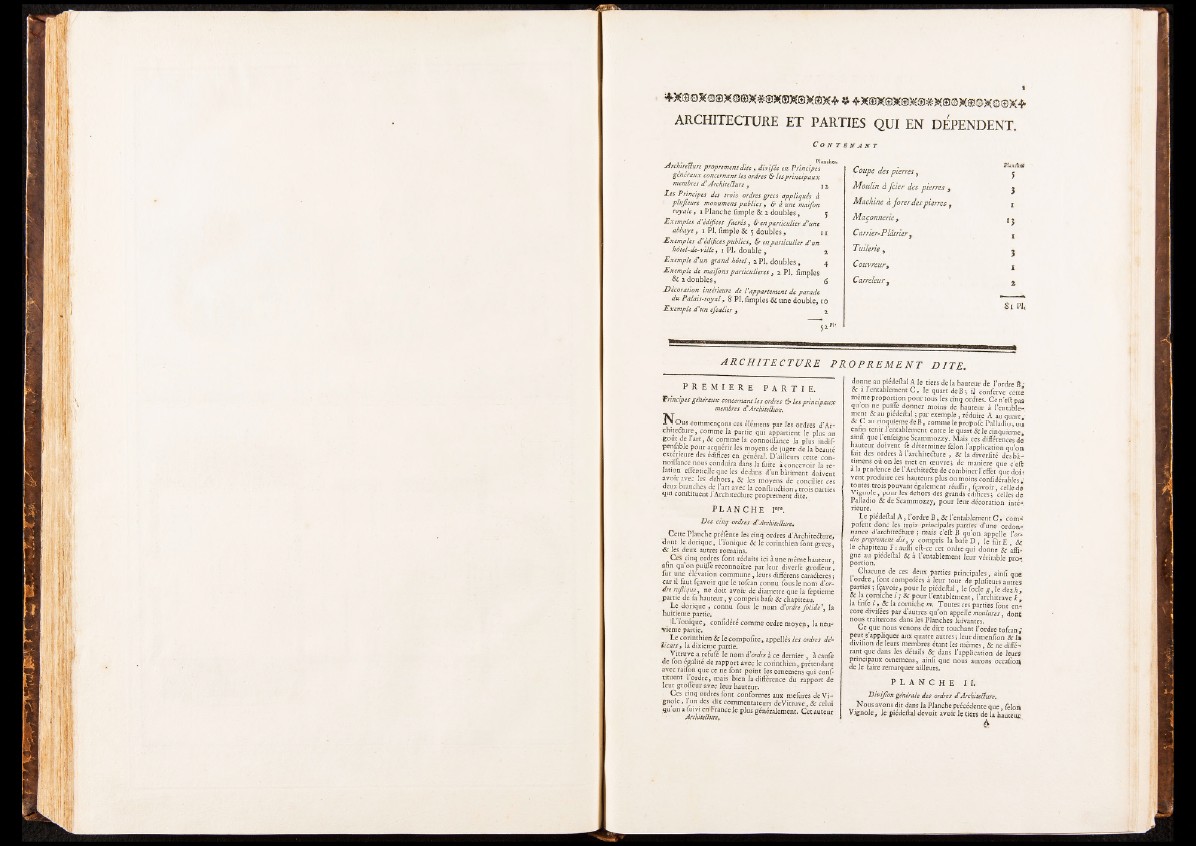
ifrX®©X©®X©©X#®X®X®X®X4- 3 *XSX©X®X®*X®©Xffi©X©©X*
ARCHITECTURE ET PARTIES QUI EN DEPENDENT.
C o n t e n a n t
Planchet.
Architecture proprement dite, divifée en Principes
generaux concernant Us ordres & lesprincipaux
membres d'Architecture , I2
Les Principes des trois ordres grecs appliqués à
f plujîeurs monumenspublics, & aune maifon
royale, i Planche fimple & z dou ble s, ç
Exemples d'édifices facrés, & en particulier d'une
abbaye , i PI. fimple & 5 doubles , 11
Exemples d.' édifices publics, & en particulier d'un
hôtel-de-ville , 1 PI. double , z
Exemple d'un grand hôtel, z PI. d ou b le s , 4
Exemple de màifons particulières , z PI. fimples
& 2 d ouble s, <5
Décoration intérieure de 1'appartement de parade
du Palais-royal, 8 PI. fimples & une double, 10
Exemple d'un efcalier , 2
Coupe des pierres,
Pu ne*«
5
Moulin à feier des pierres , j
Machine à forer des pierres, y i
Maçonnerie , «j
Carrier-Plâtrier , i
Tuilerie , j
Couvreur. i
Carreleur , 2
8 1 Pl<
A R CHI T E C T U R E P R O P R E M E N T DI TE.
P R E M I E R E P A R T I E .
principes gdne'raux concernant les ordres & les principaux
membres £ Architecture.
N O u s commençons ces élémens par les ordres d’Ar-
chitecture i comme la partie qui appartient le plus au
^ °UrL i art> ^ comme^a connoiflance la plus indif-
penlable pour acquérir les moyens de juger de la beauté
extérieure des édifices en général. D ’ailleurs cette connoiflance
nous conduira dans la fuite à concevoir la relation
eflentielle que les dedans d’un bâtiment doivent
avoir avec les dehors, & les moyens de concilier ces
deux branches de l’art avec la conftrudfcion, trois parties
qui confutuent 1 Architecture proprement dite.
P L A N C H E Iere.
Des cinq ordres £ Architecture,
Cette Planche présente les cinq ordres d’Architeéture,
dont le dorique, l’ïonique & le corinthien font grecs,
ôc les deux autres romains.
Ces cinq ordres font réduits ici à une même hauteur,
afin qu’on puiflè reconnoître par leur diverfe groflèur,
fur une élévation commune, leurs différens caraéteres ;
car il faut fçavoir que le tofoan connu fous le nom d’or-
dre rufiique, ne doit avoir de diamètre que la (èptieme
partie de fà hauteur, y compris bafe ôc chapiteau.
Le dorique, connu fous le nom d'ordre folide *, la
huitième partie.
_ |L ionique, confidéré comme ordre moyen, la neuvième
partie.
Le corinthien & lecompofite, appellés les ordres délicats,
la dixième partie.
Vitruve a refufé le nom d'ordre à ce dernier , à caufe
de fon égalité de rapport avec le corinthien, prétendant
avec raifon que ce ne font point les ornemens qui con f
tituent l ordre, mais bien la différence du rapport de
leur groflèur avec leur hauteur.
Ces cinq ordres font conformes aux mefures de V i-
gno le , 1 un des dix commentateurs deVitruve, & celui
qu on a fuivi en France le plus généralement. Cet auteur
Architecture,
donne au piédeftal A le tiers de la hauteur de l ’ordre B $
& a l’entablement C , le quart de B ; il conferve cetté
meme proportion pour tous les cinq ordres. Ce n’cft pas
qu on ne puiflè donner moins de hauteur à rentable-,
ment & au piédeftal ; par exemple, réduire A au quart.’
& C au cinquième de B , comme le propofe Palladio; ou
enfin tenir l’entablement entre le quart & le cinquième*
ainfi que l’enfèigne Scammozzy. Mais ces différences de
hauteur doivent fe déterminer félon l’application qu’on
fait des ordres à l’archite&ure , ÔC la diverfité des bâ-
timens où on les met en oeuvre ; de maniéré que c’eft
à la prudence de l’Architeéfce de combiner l'effet que doil
vent produire ces hauteurs plus ou moins confidérables
toutes, trois pouvant également réuflir, fçavoir, celle dé
Vigno le, pour les dehors des grands édifices; celles de
Palladio ôc de Scammozzy, pour leur décoration inté*
rieure.
Le piedeftal A , l’ordre B , & l’entablement C , com-'
pofènt donc les trois principales parties d’une ordonnance
d’architeélurc ; mais c’eft B qu’on appelle IV -
dre proprement d it, y compris la bafe D , le futE ÔC
le chapiteau F : aufli eft-ce cet ordre qui donne Ôc aflî-
gné au piédeftal & à l’entablement leur véritable proportion.
Chacune de ces deux parties principales, ainfi que
1 o rdre, font compofées à leur tour de plufieurs autres
parties ; fçavoir, pour le piédeftal, fe focle g , le d ezh ,
ôc la corniche i j ô c pour l’entablement, l’architrave k
la frifè l , ôc la corniche m. Toutes ces parties font ené
core divifées par d’autres qu’on appelle moulures, donc
nous traiterons dans les Planches fiiivantes.
Ce que nous venons de dire touchant l’ordre tofean;
peut s’appliquer aux quatre autres ; leur dimenfion Ôc l i
divifion de leurs membres étant les mêmes, Ôc ne diffè-
rant que dans les details ôc dans l’application de leurs
principaux ornemens, ainfi que nous aurons occafioii
de le faire remarquer ailleurs.
P L A N C H E II.
Divifion générale des ordres £ Architecture.
Nous avons dit dans la Planche précédente que, fèloii
Vigno le, le piédeftal devoir avoir le fiers de la hauteur 6