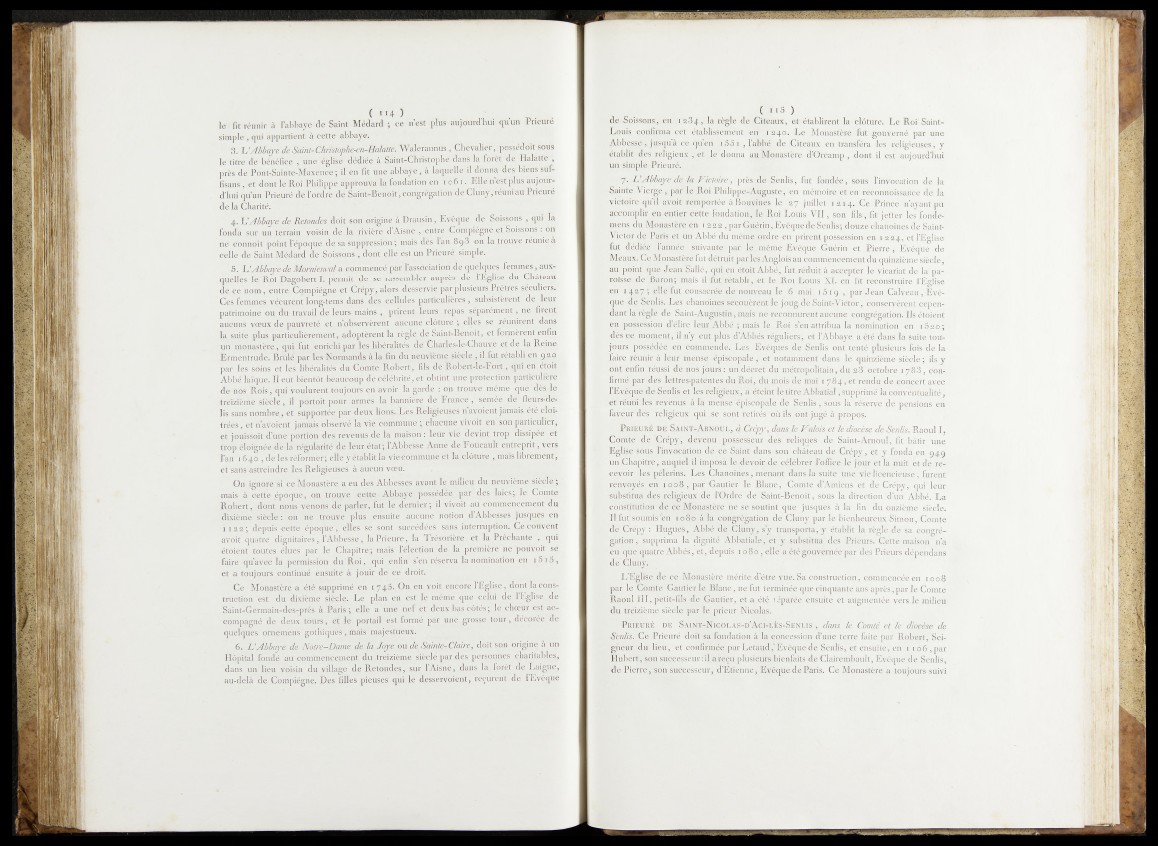
< I f f ) H f l H ç ï M L
k ' : fit- rétfntS.'SàriEâfb^e'ide •fa'iWt* MédaÂ$* « sstó ^ t -flttttïauij 9 g i ^ n Q B H [
gfMplei, <[iii Vip^id'nfi
Ie titre de bénéfice , une église dédiée à Säint-Cliristophe dans la forêt de Bblatte
pri s de P ó n t -S a teM a x eB e è ; il en fit une abbaye , à laquelle il donna des biens suf-
fïsans I et don t le R o i Philippe approuva la fondation en 1 06 r . E lle n’est plus aujourd'hui
qu’un Prieure cle l’ordre de Saint Benoît, congrégationi de Cl'U'Èiÿ, réuni au Prieure
cfe l/i f n f t ' v
4 Abbaye de Retondes doit son origine à Drausin , Evêque de Soissons , qui la
fonda sur un terrain voisin de la 1nu
5. Tu’Âbbaye de Momiewal a commencé par l’association de qdgldjfijies femmes, aux-
1 « D a  ï I.. jléu.r|uI.
Cf s fetnnies vécurent long-tems.dans |des cellules particulières , subsistèrent de leur
patrimoine ou du tra\ ill de leurs mains prire nt leurs repas sépaïémenl , ne firent
aucuns v a üx de pauvreté et n’observèrent aucune i lolin ; elles se réunirent dans
la suite plus particulièrement, adoptèrent la règlf de Saint-Benoît, et formèrent enfin
un mon astèi e , qui lut enrichi par les libéralités; de ' C 11 arles-le-C h au ve et de la Reine
Ermen trade. Bi ûlé par 1< Normands à 11 fin du neuvième siècle , il fut rétabli en 920
par les soins et les libéralités dit Comte Robert fils de R o |M -le -F o T t , qui en étpit j
Abbé laïque. ri i 1 i l l w *■/ f n l y m ^ r ^ iTaTJrk tu
ft} 'flwï R o is , qui voulurent toujours en avoir la garde : on trouve même que dès le
treizième sièc le , il pot toit pour armes la bannière de France , semée de leurs-de- •
lis sans nombre ; et supportée par deux lions. Le s Religieuses navoient jamais été cloî-
tr< es , et n’avoient jamais observé la vie commune ; chacune vivoi-t en son pari 11 ulier
et jouissoit d’uriê portion des revenus de la maison : l< ùr-vie devint trop dissipée et
trop.éloignée de la régularité de leüi e tat; 1 A-bbesse Anne de Foucault entreprit, vers
l’an 1 640 , de les réforme 1 J l ÿ y établit la vie commune et la clôture mais librement,
et sans astreindre le s Religieuses' à aucun voeu:
* On ignore si ce Monastère a eu des Abbesses avant le du neuvième siècle ;
mais à cette époque, o h trou ve ceLte Abbaye possédée par des laïcs.; le Comte
Robe il , dont nous venons de p irler, fut lê dernier; il vivoit au e-qtabpencement-du
dixième siècle : <> 11 ne : trouve plus ensi 1 ite aiicune potion d’Abbesses |us|iue£ e n
T i c 3 1 depuis cette époque., elles se sont succédée s sans interruption. CéVefiv ent
avoit quatri dignitaires, l’Abbe s's.eî, la Prieure, la Trésorière et la Pree hanu ^ qi®t
étoiekt toutes élues par le Chapitre; mais l’élection de la prémière ne pônvoit se
faire qu’avec la permission d u 'R o i , qui enfin’ s’en réserva la poffiii||ÿ^ Jg n ,
et a toujours continué ejnimig t jouir de ce droit •
Ce Monastère a été supprimé en 1 74b. On eu voil^^mofel E g lise , dont la çons?,
traction est du dixième siècle. L é plan en est le même que celui de I Eglise de
Sainttfeermain-des-prés 1 Paris ; elle a une nef et deux bas côtés; le choeur e.st ;açif.
compagné de deux tours, et le portail est.formér|àr' une.grosse to u r , décorée cle
quelques ornëmens gothiques , mais majestueux
6. L ’Abbaye de Notre-Dame de la Jape ou ie .S i r e-C aire, doit Son origine à un
Hôpital fondé au commeimtunent du treizième siècle par des personnes charitables,
dans Un lieu voisin du vil lage de Retond t s , sur f Aisne,, dans la forêt de Laigue
au-delà de Compiègne. Des filles pieuses qui lé d-esser voient, reçurent e lt^ ^ flg Ju e
I J K
de Soissons, en 1 2 3 4 , la règle de Cîteaux, et établirent la clôture. L e Roi' Saint-
Louis 5 pu .Ut»
p-e I d <, jK> ®U 1ù ,e I \
AI e 1 e d’Orcamp , dont il est aujourd’hui
mjiAungjA-Pj a uré.
c4ftï , J } J \ ‘ ; en^lomj'qe t ^ } - ' birlvoi fli^A -(]&#■’ la
Sainte V ie rg e , par le R o i Philippe-Auguste, en mémoire e L ,e n. re c o n n o i s s a n < - e de la
Pvfoib i i-ogeiA’ ro ll I.W!Bb tlfc U - nfît'iiîiffr
B B L dîtî> 1 „ 1 I M
Kpf |1-.(l.iuivj^^^j ^ le.ii tp 1 (a ^ m b p t ] i e ^ J ^ W 5p 5r»e e I M g l
m m ^ 1 I 11 D'JgéW
'fut ppi" B e I Wjvj#I ,,Çn pnùjui'J
Meaux. Ce Monastère fu détruit parles Anglois au e xmmencement du quinzit me iècle '
roisse de Baron; mais 11 able
en 1 4.27 ; elle fut consacrée de nouveau le 6 mai 1 5 19 , par Je an Calveau , E v ê que
de Senlis. Les chanoines secouèrent le joug de SaintA H f l yM^ ^ u t nS j
dant la règle de Saint-Augustin, mais ne reconnurent aucune congrégation. Us étaient
^ ’ 1' i pa/i-la’"rit^rrn\i^]Vio^^^r 1 îw
LU%j%tS^E5jf plli^
i i -, en ii^ |Pi
j ^ ^ a i i ri aW ^ r f< " * du’mf 1101 y J roi m‘AelN Üî. ^ gt 11 lia fe h o lp g e t j hI|
Il i n‘fi 1, - e Ael‘û. fit lÿ jd i ^ sÇ pfVr'ie 11< 11 n&î t
g m ÿCTV w nw t fl I r im i^ iiiifn fg irT iT fii^ g ^ fflnPP
l ' j *n v ju a
B I '■itn rtims
» rai ''•i WfV1 ,*-v 'WeLy 4,u
1 'I. i .j 1 ml KH^lè^re-^,
i SSul al EES^’11 1 itrWWjHWffiyffiyiroftr lüretiÎÂ
, *l< 3 B s * ra u ie ’’ 'él \miètis’ 1 1 )V tqlntioUL
substitua des religieux de l’Ordre de, Sàint-Benoit, sous la dmi7 ^™Sg g îr^^^3 n% .
11 iti‘ J% ? f~mrV<lri‘l
wSM*ibt 1)1»je* ' r r’bJil li u ^e de >,a.a qeCn- ^.111 lÿÇ .til I |mmji^5iTCrfir \1 1’u’j de ,**L v ijIMÆii 1 de^tó iŸpi- n’àîèu
<pie mbty^ïK^-. nC } -'S, ^( 1 ' n ^nwSSf** dePrnuwme [je rtamîj
Sj ejSgfajiV.
I I pLiv jilc .'.f Vlqn-A'ltièÿine.ntft d’qVi e vW ^ f f l^ j- i^ iS s u ^ petmuun t L < Cri
Pai 1 11 '-111 ' i hly^sijTK . nplûl‘ têïïmn'ïin^]jfc.f'inqiidril--^anq'^[^p.-j)ei hi;Ct/;rm^
Raoul lii [Mil fil ,de Ckulin el tadfe ^p d i ■'r m<-uil tjatj^n nl+.< vl'l'-V-e^rLuliftü
du treizième sièels par le. prieur Nicolas, *
Prie'iüré de Saint-Nicolas-d’A cnlès-Si ni i , dans le ComLé et le diocèse de
jA itfh < i IC- elÿjj j e u ie- 'flou^^Sfónd.ition' i^l&^oorice .■ 'iifjd'ehutu terre faite pai lli> l« 'ir/Sli-
par I c ia-yl, f ÿeÿpK- fj^ -e ra s j ?i f ‘'ii.'),1eïtoSï|^Sy')* piy
• ®il>effÂàngiitA<v>'>r |ÿv« t p ç î S p v Ù l f s :
d e P ie ffé^ S ra su<feesseur,t'd,’Eitienim/jFnS,q^i< rlu^ali1 Ct^ÿli na-,ie