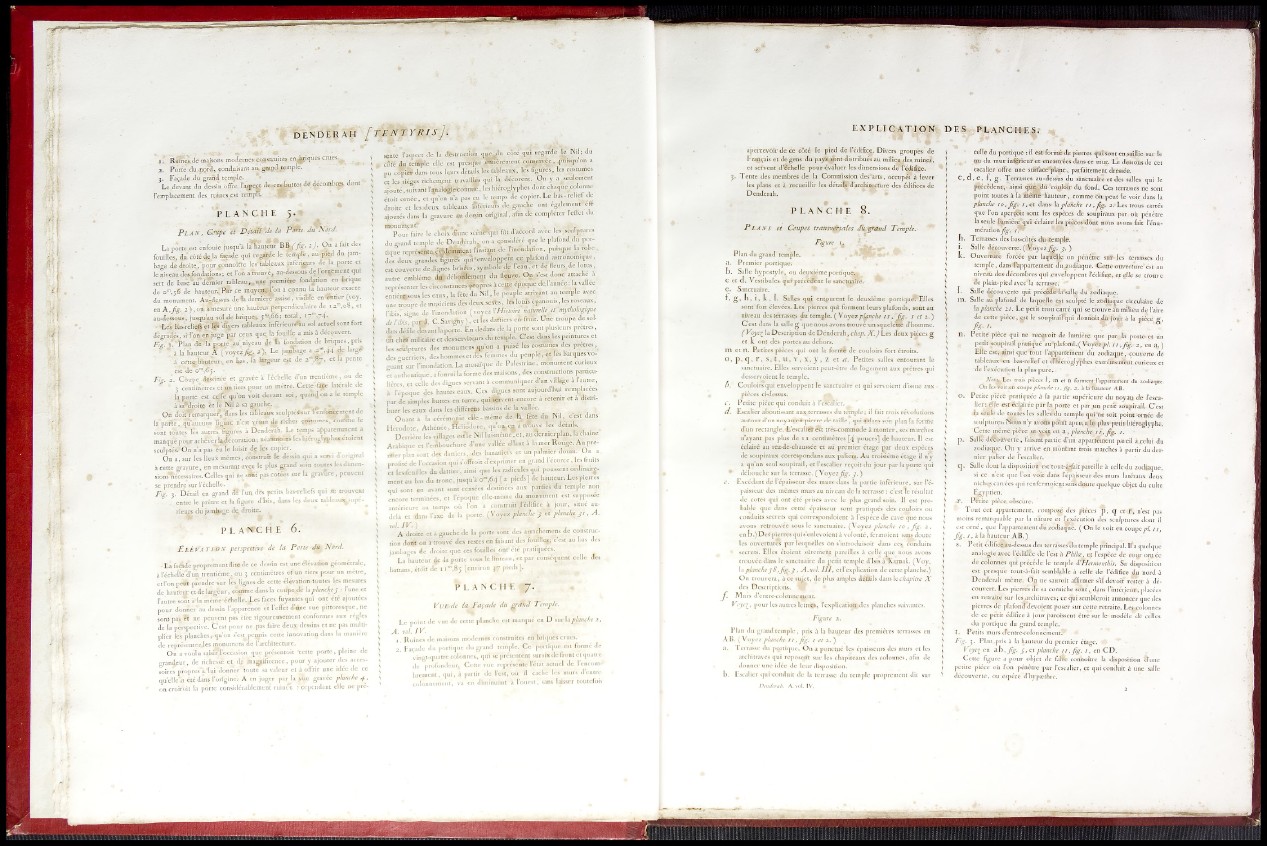
D E N D I i K A 'Î I [ T E N T Y R Î S ]■.
i : RuîmLle' maisons modernes: construites en..hritpies crues
2. Porie ilu.nori, conduisant aie gliagdf^emple.
a. Façade .du grand temple. °
: Le devant du dessin bfire. I% e g . dç-CKjburtesdï décombres dont
l’emplacement des ruines .est rempli.-
" p l a n C i l E 5 - f
P l a n , Coupe' et D é ta il Je la Porte Ju A'orJ.
La porte est enfouie jusqu’à la’ haureuï B E /jf? - 2) . On a fait des
fouilles, iu 'c ô fp ^ la frçàde qui regfde le temple, au pied du jambage
de droite, pour connoître les tableaux inférieurs Je la porte et
le niveau des fondations ; et l’on a trouvé, au-dessous d e fo i^m q » qui
sert de base'bn” d?mier tableau, une première fondation en brique
de 0“ , jd .d e hauteui-, Par .ce moyen; l’on a connu la b u t e » exacte
du monument. Auldeiûs delàdernièrè assise, visible en entier (voy.
en A ,ftg, 2 ) , on a.mesuré une hauteur perpendiculaire de l» * ,o8 , et
au-dessous, justprâti sol de brique; 5“ 66; total, ‘ 7 ">74 -
, rLes bas-reliefs ê f® divers tableaux inférieursnu sol actuel sont fort
deoradés, si l’on en ju’ge' par ceux que la fouille a mis à découvert.
Fig. t^’ jplan d ^ f n æ ^ u niyeau 4 e fa fondation de briques, pris
. " à la hauteur A (voyeijfe-. a), Le jambage IarSé'
• à cette hauteur; en bas, la largeur est de a” Sy. , et la pente
est de o“ ,oy. . -
Ffr.-S. Côupe. à&ûtiéè et gravée a l'échelle d’un trentième, ou de
* k 3 centimètres et un tiers pour un mètre. Cette-fige latérale de
la porte.est celle qu’on voit devant soi, quand on a le temple
à sà^droite èt le Nil à-sa gauche. .,
On doit remarque^ dans les tableaux sculptéfsur lènfoncemçnt de
la porte , qu’aucune figure n’est | % e de riches costumes, confine le
sont toutes lés autres/figures à Denderah. Le temps apparemment a
manqué pôur acheverï^gécoration ; néaimfoins les lÿérqgl^hes étoieht
sculptés?On n’a pas euîe loisir^d^ Igs copier.
On a, sur les lieux mêmes, construit le dessin qui a servi d’original
à cette gravure, en mesurant avec le plus grand soin toutes lesdimen-
sionsSécesèaires. Celles qui ne s k i pas cotées sur la gravure, peuvent
se prendre sur l’échelle.
Fig. 3. Détail en grand de l’un des petits bas-reliefs qui se trouvent
- , entre le prêtre et ht figure d’Isis, dans le? deux taUeatn^supérieurs
dùjam^ge d^ droite. ,
P L A r*PC H E 6 :
É&ÉVa t 1 0 N perspective de la Porte du. Ndrd.
* La fa$de proprement dite de ce dessin est une élévation géometrale,
à l’écheile^d’un trentième^ou 3 centimètres efun tiers pour un mètre,
et l’on pëïfe prendre-sur lès lignes de cette élévation-toutes les mesures
de hauttetfr etde largeur, comme dans la coupe de la planchey ; I une et
l’autre sont à*la mêtnVééhelIe.^Les faces fuyantes qui ont été ajoutées
pour donner'au dessin l’apparence et l’effet d’<ône vue pittoresque, ne
sont pas ne peuvent pas être rigoureusement conformes aux réglés
de Ja perspective, tf’est pour ne pas faire deuxr dessins et ne pas multiplier
lès planches,-qu’on s’est permis cette innovation dans la manière
de représentei^les monumens de l’architecture.
On a voulu saisir,l’occasion que présentent *cette porte, pleine de
grandeur, de richesse et; magnificence, pour y ajouter des accessoires
propres*à.*lui donneGtoute sa valeur et à offrir une idée de ce
quelle^ été dans l'origine? A en juger par la yüe gravée planche 4 ,
' on croifoit la porte considérablement ruinee ? cependant elle ne présenté
l’aspect de la dEstructioji q|e;y k côté qui regarffe îe Nil; du
cofé du temple elle est pr&qbe JÇfèrément . .c ^ n r | e , .puisqu’on a
pu ccfifedans tous I^urs détaiîUes tableaux, les figîn-es , les costumes
et les sièges richement travaillés qui la. décorent. On y a seulement
ajouté , suivant r^alogiécohnuf, les hiéroglyphes dont chaque colonne
étoit ornée, et qu’on n’a pas eu le temps de copier. Le bas-relief de
droite et les .deux tableaux mférieiît-s de gauche ont également - ete
ajoutés dans la gravure îfu dessin original, afin de compléter l'eftet du
monument. ÆP» * ' w v . . . .
Pour faire le choix&me scèn^qui fût d’accord avec les (sculpftiues
du vrand temple de Denifërahvona qpnskléjré que le pUjWtftrpoi'-
tique représènte,évidemment Imstànt de l’inondation, puisque la robe.,
des deux grandes"ïdiiffe' qû’.-tenviloppent ce plafond astronomique.
est couverte de dignes b r i s A s , symbole de l’eau, et de Heurs,de lotus,
autre emblème- du|déboiSement du fleuve. On s est donc attache a
représenter les circonstances propres à cettb époque « anneç : la vailee
entière sous les eaux, la fête du Nil, le peuple arrivant au temple avec
une troupe de musiciens des deuxsexes, les lotus épanouis, les roseaux,
l'ibis’ signe de l’inondation (voyez Wimirc naturelle et mythologique
de ¡’¡bis, pard. C. SavisSiy ) , et les dattiers en.fruit. Une troupe de soldats
défile devant la porte. En ded.ms.de la porte sont plusieurs prêtres,
■ fin chdf militaire et desdervit^irs du temple. C ’est dans les peintures et
les sculptures des monumens .qu’on a puisé’ les costumes des prêtres^
des nuerriers, des hommes etdei femmes du peuple', e t p i Barques voguant
sur l’inondation. La mosaïque de Palesiriné’, dSSunient curieux
et authentique, a fourni la formedes maisons, dés contraction» particulières,
« celle des digues servant à çommuniquer^’ün vill|j;e'|l’»tpe,
à l’époque des hautes eaux. Ces digues sont'aujourd’hui rem|Iacées
par de simples buttes en terre, qui servent .encore à retenir et’à distribuer
les eaux dans les dilterens bassins de la vailee. 3
Quant à la cérémonie elle-même d e . * , Ête du est dans’
Hérodote, Athénée, H éliodore, qu’o^en a tfBuyé les . ,
Derrière les villages esêle Nil luïmêm~et, att'a'emierçlan jla^haîne
Arabique et l’embouchure d’une vallée allant à la mer Rouge. Au premier
plan sont des JattietCdes bana.î|is et un pahnièr'd38mTOn a,
profite de l’occasion qui s’offroit d’exprimer en E rand_^TO^sfruits
et les feuilles du dattier , ainsi que les radicules qui poussent ordinairement
au bas du tronc, jusqu’à o” ,64 [» pieds] de hauteur. Les pierres
qui sont en avant sont censées destinées aux parties du temple nouj
encore terminées, et l’époque elle-même dm monument est'supposée
antérieure au temps où l’on a construit'/édifice^ jour, situe au-
delà et dans l’axe de la porte- (Voyez pEnche J W f la n c l^ j l , A.
m l.m i ) . :
A droite et à gauche de la porte sont des acrachemens de construction
dont on a trouvé des restes en faisant des touille|; c’est au bas des
jambages de droite que ces fouilles oné été pratiquées.
La hauteur ,<Jç 4a porte sous le linteau, et par conséquent celle des
battans, étdit de i i “ ,8y [environ 3^ pieds].
P L A N C H E 7 .
Vu£-de la Façade du graiid Temple.
Le point de vue de cette planche est marqué en D sur \nplanche 2,
A . vol. IV .
1. Ruines de maisons modernes construites en briques crues.
2. Façade du portique du grand temple. Ce portique est forme de
vingt-quatre colonnes, qui se présentent sursix de iront et quatre
de profondeur4 Ceftc vue représente l’état actuel de l’cncom*
brement, qui, à partir de l’est, où il cache les murs d’entre-
colonnemcnt, va en diminuant à l’ouest, sans laisser toutefois
E X P L I C A T I O N * D E S E L A N C F L E J ?
apercevoir de ce côté le pied dé l’édifice. Divers groupés de
Français et de gens du pay$ sont distribues au milie^des.ruinp|,
et servent d’IeliieWé pour é.vaîuer les dimensions de I édif èe.
3. Tente des membres de la Commission des*arts, occupes à lever
les plans et à recueillir les détailsM’ardiiMCture des édifices dé
Denderah.
P L A N C H E § .
P l a n s et Coupes transversales dliygràiid Temple.-
Figure r. .
Plan du grand temple.
a. Pi emier portique:
b. Salle hypostyle, ou deuxième portiqu^fc -
C et cl. Vestibules, qu? précèdent le sanctuaire.
G. Sanctuaire.
f, g , h , i , k , L Sallgs qui entourent le deuxième portiquê^EHes
sont ‘fort élevées. Les pierres qui forment leurs plafonds, sont au
niveau des terrasses du temple. ( Voyez pjanche 1 1 , fig. 1 et 2. )
C ’est dans la salle g que nous avons trouvé un squelette d’homme.
(Voye^ la Description de Dënderah, chap. X .) Lès deux pièces g
et k ont des portes au dehors. * 4.
m et n. Retires pièces qui ont la forriîl de couloirs fort étroits.
O, p><]> F, S, t , U, V , X, y , Z et a. Petites salles entourant le
sanctuaire. Elles servoient peut-être de logement aux prêtres qui
desservoient le temple.
b. Couloirs qui enveloppent le sanctuaire et qui servoient d’issue aux -
pièces ci-dessus.
C. Petite pièce qui conduit à l’escalier. ‘
d. Escalier aboutissant aux terrasses du temple; il fait trois révolutions
autour d’un noyau en^pierre de taille, qui âdans son plan la fornie
d’un rectangle. L ’escaliëï est très-commode à monter, ses marches
n’ayant pas plus de 11 centimètres [4 pouces] de hauteur. II est
éclairé au rez-de-chaussée et au premier étage par deux espèces
de soupiraux correspondans aux paliers. Au troisième étage il n’y
a qu’un seul soupirail, et l’escalier reçoit du jour par la porte qur
* débouche sur la terrasse. ( Voyez fig. y. )
e. Excédant d.e l’épaisseur des murs dans la partie inférieure, sur lepaisseur
des mêmes murs au niveau de la terrasse : c’est le résultat
cle cotes qui ont été prises avec le plus grand soin. II est probable
que dans cette épaisseur sont pratiqués des couloirs ou
conduits secrets qui correspondoient à l’espèce de cave que nous
avons retrouvée sous le sanctuaire. (Voyez planche 10 , Jig. 2 ,
enb.)De?pierresquis’enIevoientà volonté, fennoient sans doute
les Ouvertures par lesquelles ôn s’introdùisoit dans ces randuits
* secrets. Elles étoient sûreiheftj pareilles à celle que nous avons
trouvée dans le sanctuaire du petit temple d’Isis à Ivarnatc. (Voy.
la planche y S ,jig. y , A.vol. I I I , et l’explication de cette planche.)
On trouvera, à ce siuçt, de plus amples défàils dans le chapitre X
des 'Descriptions. ^
f . M urs d’en tre-colon ne me n t.
Voyeç, pour les autres lettres, PexpIicat1<iÉ|des planches suivantes.
Figure 2.
1 lan du grand temple, pris à la hauteur des premières terrasses en
A B. (Voyez planche u , fig. 1 et 2 .)
a. Terrasse du portique. On a ponctué les épaisseurs des murs et les
architraves qui reposent sur les chapiteaux des colonnes, afin de
donner une idée de leur disposition.
I). Escalier qui conduit de la terrasse du temple proprement dit sur
Denderah. A. vol. IV.
1 celle du portique : il éSti fbrifo&dë pierres qüi's'oiu en^alllje sur fe
du mur in^ieuAet e'neàSiféeV dans ce niu£. Le d'essoius de cet
fescalier offre une svÉfaed^îalie, pâiifôitément drëssee.
e , d , e , f, g . Terrasses, au-dessus du sânctüaire et des salles qui le
pîiéèedeniüg ainsi ^ ^d SA q^ld if du fond. Ces terrasses ne sont
point toutes à la^ême^hauteür, comnie ^ p e u t ie voir dans la
planche 10, fig*-1 , e't dans<- Ia pldfich'e u , fig? 2.* Les trous carrés
que l’on aperçoit sont fes espèceis d'e soupiraux par. où pénètre
la seule J^miè^quî éclaire' les pi|ées^I®n.t nous avons-fait I’énu-
mérationJig. iW
h. Terrasses des bas-côtés dlîiiLeinpIë.
I. Salle cjirauverte. (Woyezfig. y . )
k . OùveiTOie forcée par Ia«^ÊHe on néiiêtre sùf.Jes terr<Ksês. du
temple, dansllfeppartement du^odiaque. CeÈje'oaverfure^ést au
nivëaii des* décombres qui venvefoppent Pédifi#; e,t glTe se trouve
aè plain-pifed avec la terrasse:
I. Salle ^couvçr.tô qui précj^l^salle du'zodiaque.
m - Salle au plafond de laquelle e§t sculpté le zôtfeque circulaire de
la planche 21. Le petit trou carré qui se trouve aü milieu de l’aire
de cette ■pièce,^gst le soupjrailxpn donnaitApjlrrfr à la gjèçé g ,
fig: ^ ‘ - W w lî
ï*. Petite’ pièce qui ne recavoit-de lumière; que pai^Jlr poittck et iîn:
petit soupirail pratiqué au pjafoncl.,■( Voytzfpl. i i ,fig.- 2, en a. )
Ellfe estfjgynsi que^fèut l’ajiparÉèmeuf'du zodiaqiré, couverte dë
tableaux »en bas-relief et d’hierogi^phes ëxtrêm'ei^Ént ,curieux et
•de l’exécution la plus pure.. '
NoraJhes trois pièces 1 , m et n formenrl’appârteifient du zodiaque.
On fes A«oit .en coupe planche 11 . fig. 2, à fà'ffauteur A B.
O. Petite pïècfe pratiquée à la partie- supérieure du noyauj de l’esca^
liert^IIe <est éclairée par importé et par^® petiî soiapirajl.- C ’est
4a seule de mutes les salleirou temple qui*h.e soit point bornée de
scuÎpfurçs. fSfêfts n’y avo^S point apeisçii^;plîus*petit»hiéroglyphe.
Cette mêmè pièce en a , planchai r,, fig,. 1.
p . Salle drcôifvertë, faisant partie d’un appautfuîënt pareil àècehù du
zodiaque. On-y arrive çn mônfamt trois marches à partir du deiv
nier palier de l’escalier,
q . Salle dont la dispositio#est*toutr^Miit pareille à celle du zodiaque,
si ce n est que l’on voit dans l’épaisseur des murs latéraux deux
nichqs carrées qui renfèrmqie^t sans dciute quelque objet du culte
Egyptien.
.r. Petite pièce, obscure.
Tout cet appartement, coiuposj des pièces p , q e t fi, n’est pas
moins remarquable par la nature et fexécutioh des sculptures dont il
est orné, que l’appartement du zodiaque. ( On le voit en coupe pl. 11,
fig. 1, à la hauteur AB. )
S. Petit edifiepîu-dessus des tërra’sses^clu temple principal. Il^a quelque
analogie avec l’édifice de l’est à Philoe.e} l’espèce de coty- orç ée
de colonnes qui précède le temple ¿rlermonthis. Sa disposition
est presque tout.-à-fait semblable à cellë cle^ l’édifice du nord à
Denderah même. On ne saurait affirmer s’il devoi? rester à découvert
Les pierres cTe sa corniche Sont dans I’intérieiil-, placées
en retraite sur les architraves; ce qui semblerait ann@nc.er que des
pierres de plafondclevoient poser sur cette retraite. Les«çoIonnes
de ce petit édifice à jour paraissent être sur le» modèle d€ celles
du portique du grand temple.'
t. Petits murs d'èntre-colonneinentî^ •
Fig. 3. Plan.pris à la hauteur du premier étage. 4$
Voyei en a b , fig. y , et planche 1 1 , fig. 1, en CD .
Cette figure a pour objet de faire connoître la disposition a une
petite piece où l’on pénètre -par l’escalier, et qui conduit à une salle
découverte, ou espèce'd’hypæthüe.