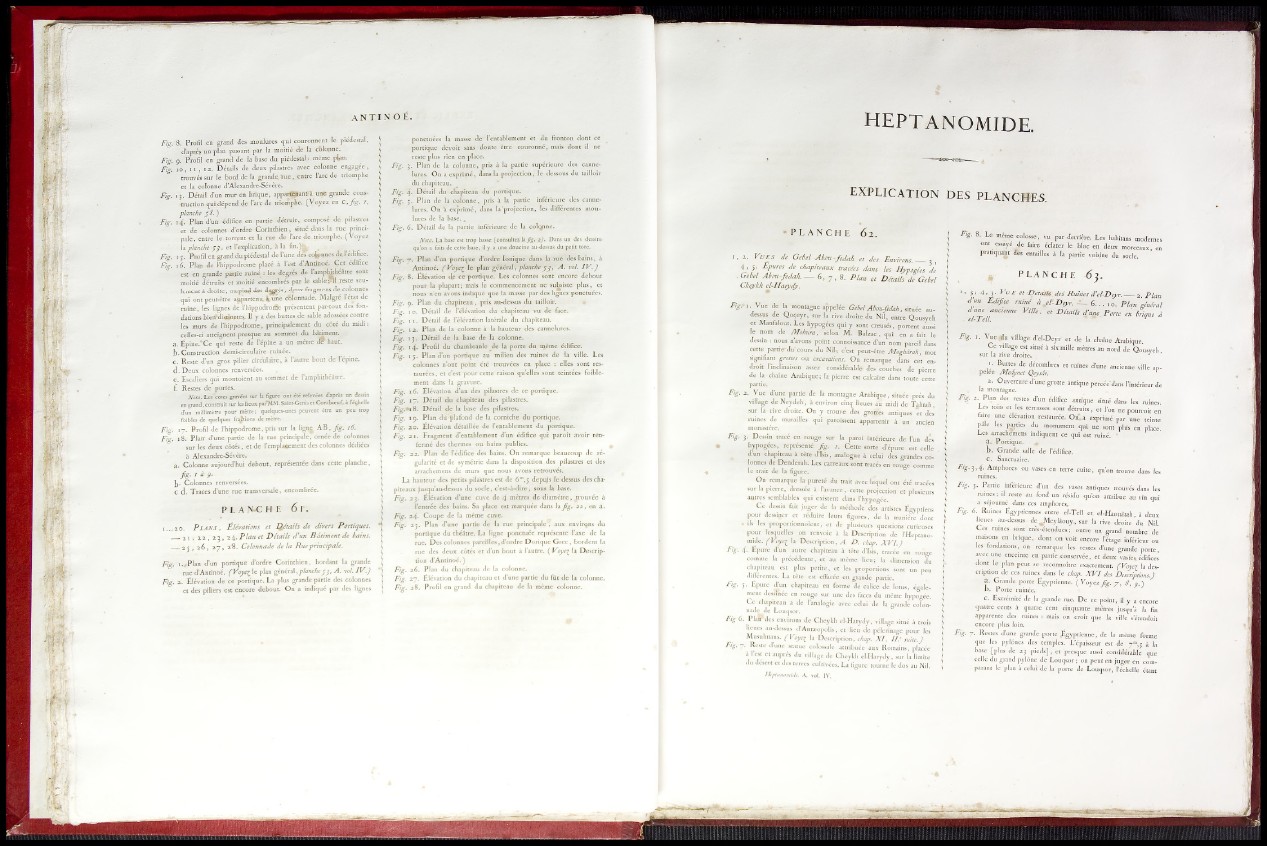
m ¿-i
I I
A N T I N O E .
J p
fa: A mSfi
I yfj i
f[11 P & III
« i s «
I l I#
1
ffpr
m
SfS
Fig.
Fis-
Fis.
Fig.
Fig.
g. profil en grand des moulures qui couronnent le piédestal,
d aprjs. un plan passant par la moitié de la colonne.
9. Profil en grand de la base du piédestal : même pfcn.
10, i l , 12. Détails de deux pilastres avec colonne engagée,
trouvés sur le bord de la grande,rue, entre l’arc de triomphe
et la colonne d’AIexandre-Sévère.
13. Détail d’un mur en brique, appartenant à liiïè grande construction
qui dépend de Tare de triomphe. (Voyez en C, fig. i,
planche 38.)-
14. Plan d’un édifice en partie détruit-, composé de. pilastres
. et de colonnes d’ordre Corinthien, situe dans la rue principale,
entre Je torr.ent et là rue de l’arc de.triomphe. (Voyez
la planche 3 3 , et l’explication, à la f in .^ o ... - : :
15. Profil en grand du piédestal de l’une des colonnes de!’édifice.
16. Plan de Fhippodrome placé à l’est d'Antinoé. Cet édifice
est en grande partie ruiné_ : les degres de I amphkheâtre sont
moitié détruits et moitié encombrés par le sable*! reste seulement
à droite, au pied des degrés, dieux fragmens de colonnes
qui ont peut-etre appartenu, a.. unè c&lonnade. Malgré l’état de
:, les lignes de l ’hippodrome présentent par-tout des fondations
bieiNiafimetes.. 11 y a des buttes de sable adossées contre
les murs de l’hippodrome, principalement du côté du midi:
celles-ci atteignent presque au sommet du bâtiment,
a. Épine.*Ce qui reste de l’épine a un metre de haut,
b-Construction demi-circulaire ruinée.
C. Reste d’un gros pilier circulaire, à l’autre bout de l’épine,
d. Deux colonnes renversées.
ç . Escaliers qui montoient au sommet de 1 amphithéâtre,
f. Restes de portes.
Nota. Les cotes gravées sur la figure ont été relevées d’après un dessin
en g rand, construit sur les lieu x par*MM. Salnt-Genis et C o r a boe u f, à i’éçhelle
d’un millimètre p o u r mètre; quelques-unes peuvent être un peu trop
foibies de quelques fr é t io n s de mètre.
Fia. 17. Profil de l’hippodrome, pris sur la ligne A B , fig. 16.
Fig. 18. Plaïf d’une partie de la rue principale, ornée de colonnes
sur les deux côtés, et de l’emplacement des colonnes dédiées
à Alexandre-Sévère,
a. Colonne aujourd’hui debout, représentée dans cette planche,
fig. ià-p.
J). Colonnes renversées.
C d . Traces d’une rue transversale, encombrée.
P L A N C H E 6 l .
i 2 0 . P l an s , Élévations et T^étaiis de divers Portiques.
2 j , 2 2 , 2 3 , 2 4 . P la n et Détails d ’un Bâtiment de bains.
—r - 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 B . Colonnade de la Rue principale.
Fig. i.#Plan d’un portique d’ordre Corinthien, bordant la grande
rue d’Antinoé. (Voyei le plan général, planche33, A. vol. I V .)
Fig. 2. Élévation de ce portique. La plus grande partie des colonnes
et des piliers est encore debout. On a indiqué par des lignes
ponctuées la masse de l’entablement et du fronton dont ce
portique devoit sans doute etre couronné, mais dont il ne
reste plus rien en place.
Fig. 3. Plan de la colonne, pris à la partie supérieure des cannelures.
On a exprimé, dans la projection, le dessous du tailloir
du chapiteau.
Fig. 4. D étail du chapiteau du portique.
Fia. 5. Plan de la colonne, pris à la partie inférieure des cannelures.
On a exprimé, dans la'projection, les différentes moulures
de la base..
Fig. 6. Détail de la partie inférieure de la col<ÿine.
Nota. L a base est trop basse (consultez la fig. 2). Dans un des dessins
qu’on a faits de cette base, il y a une doucine au-dessus du petit tore.
Fia. 7. Plan d’un portique d’ordre Ionique dans la rue des bains, à
Antinoé. ( Vyyeç le plan général, planche 3 3 , A . vol. IV . J
Fia. 8. Élévation de ce portique. Les colonnes sont encore debout
pour.la plupart; mais le commencement ne subsiste plus, et
nous n’en avons indiqué que la masse par des lignes ponctuées.
Fig. 9. Pian du chapiteau, pris au-dessus du tailloir.
F'g
Fig.
Détail de l’élévation du chapiteau vu de face.
11. Détail de l’élévation latérale du chapiteau.
Fia. ia . Plan de la colonne à la hauteur des cannelures.
Fig. 13. Détail de la base de la colonne.
Fig. 14• Profil du chambranle ^de la porte du même édifice.
Fig. 1 5 . Plan d’un portique au milieu des ruines de la ville. Les
colonnes n’ont point été trouvées en place : elles sont restaurées
, et c’est pour cette raison qu’elles sont teintées foible-
ment dans la gravure.
Fia. 16. Élévation d’un des pilastres de ce portique.
Fia. 1 7 . Détail du chapiteau des pilastres.
Fia.*18. Détail de la base des pilastres.
Fig. 19. Plan du plafond de la corniche du portique.
Fia. 20. Élévation détaillée de l’entablement du portique.
Fia. 21 . Fragment d’entablement d’un édifice qui paroît avoir renfermé
des thermes ou bains publics.
Fig. 22. Plan de l’édifice des bains. On remarque beaucoup de régularité
et de symétrie dans la disposition des pilastres et des
arrachemens de murs que nous avons retrouvés.
La hauteur des petits pilastres est de 6m, j depuis le dessus des chapiteaux
jusqu’au-dessus du socle, c’est-à-dire, sous la base.
Fig. 23. Élévation d’une cuve de 4 mètres de diamètre, prouvée à
l’entrée des bains. Sa place est marquée dans la fig. 22, en a.
Fig. 24. Coupe de la même cuve.
Fig. 25. Plan d’une partie de la rue principale , aux environs du
portique du théâtre. La ligne ponctuée représente l’axe de la
rue. Des colonnes pareilles,d’ordre Dorique Grec, bordent la
rue des deux côtés et d’un bout à l’autre. ( Voye^ la Description
d’Antinoé.)
Fig. 26. Plan du chapiteau de la colonne.
Fig. 27. Élévation du chapiteau et d’une partie du fût de la colonne.
Fig. 28. Profil en grand du chapiteau de la même colonne.
m : ■
r # , n
V f
h e p t a n o m i d e .
e x p l i c a t i o n D E S P L A N C M ë S.
• P L A N C H E 6 2
I , 2 . V ue s de Gebel M o u -fedüh et des. Enviions.^-. , ,
4 , y Epures de chapiteaux tracées dans les Hypogées de
. Gebel Abou-fedah.— 6 , j , 8. P lan , t Détails de Gebel
Cheykh el-Harydy.
Fig* 1. Vus de la montagne appelée Gebel Abcu-fedàh, située au-
dessus de Qoçeyr, sur la rive droite du Nil, entre Qousyeh
et Manfalout, Les hypogées qui y sont creusés, portent aussi
le nom de Mohara, selon M. Balzac, qui en a feu le
dessin : nous n’avons point connoissance d’un nom pareil dans
cette partie-du cours du Nil; c’est peut-être Mogh&rah, mot
signifiant grottes on excavations. On remarque dans cet endroit
l’inclinaison assez considérable des couches de pierre
de ia-chaîne Arabique; ia pierre est calcaire dans toute cette
partie.
Fig. 2. Vue d’une partie de la montagne Arabique, située près du
village de Neydeh, à environ cinq lieues au midi de Tahtah,
sur la rive droite. On y trouve des grottes antiques et des
ruines de murailles qui paroissent appartenir à un ancien
monastère.
Fig. 3. Dessin tracé en rouge sur la paroi intérieure de l’un dés
hypogées, représenté fig. , . Cette sorte d’épure est celle
d’un chapiteau à tête d’Isis, analogue à celui des grandes colonnes
de Denderah. Les carreaux sont tracés en rouge comme
le trait de la figure.
On remarque la pureté du trait avec lequel ont été tracées
sur la pierre, dressée à l’avance, cette projection et plusieurs
autres semblables qui existent dans l’hypogée.
Ce dessin fait juger de la méthode des artistes Égyptiens
pour dessiner et réduite leurs figures, de la manière dont
. ils les proportionnoient, et de plusieurs questio’ns curieuses
pour lesquelles on renvoie à la Description de l’Heptano-
mide. (Voyci la Description, A . D. chap. X V I .)
Fig. 4. Épure d’un autre chapiteau à tète d’Isis, n-aeée en roùge
comme la précédente, et au même lieu; la dimension du
chapiteau est plus petite, et les proportions sont un peu
différentes. La tête est effacée en grande partie.
Fig. J. Epure d'un chapiteau en forme de calice de lotus, également
dessinée en rouge sur une des faces du même hypogée.
Ce chapiteau a de l'analogie avec celui de la grande coîon-
nade de Louqsor.
Fig G. P laide s environs de Cheykh el-Harydy, village situé à trois
lieues au-dessus d’AmæopoIis, et lieu de pèlerinage pour les
Musulmans. (Voyei *» Description, chap. X I , II.- suite.)
Fig. 7 . Reste d'une statue colossale attribuée aux Romains, placée
à l’est et auprès du village de Cheykh el-Harydy, sur la [imite
du désert et des terres cultivées. La figure tourne le dos au Nil. I
HcptanomitU, A. vol. IV.
Fig. 8. Le |i II illli I f l j f f i l i j
ont essayé d e f f e íé ^ q r le bjoc efe! en
pratiquait des entaillés * §£ ¡1 ? , tiljvàisjne
P L A N C H E 6 3 .
11 J! 4 , j . V u e . et'Détfife-des RumesMel-Deyr.. 2. Pian
d'un E 0 ç i% M & d f - O e r & Ê è . M L P im ÿ m a l
dune ancienne V ille , et Dc'tails d’une Porte cil brique à
el-Tell. ■ “ * l .
Fig. 1. V u e^u village d’el-Deyr et de la chaîne Arabique.
C.e village est situé à six mille métrés au nord de Qousyeh
sur la rivé droite. .
- E" ttes <le décombres et ruines d’une ancienne ville ap-
pelee Ivledynet Qeysâr.
X. Ouverture d’uuê grotte. antiqueipet'Gée-dans l’intérieur de
la montagne.
Fig. 2 Plan des restes d’un édifice . antique situé dans lesïtmnesj
Les toits et les terrasses sont détruits, et fonmiépourroit en
faire une élévation restaurée. O dU exprimé par une teinte
pale ies parties du monument qui ne sont plus en place.
Les arrachemens indiquent ce qui est ruiné. *
a. Portique. 4.
b . Grande salle de l’édifice.
C. Sanctuaire.
Fig. 3 ,4- Amphores ou vases .en terre ottit.isÿ, filon trouve dans'fe;
ruines.
Fig. 5. Partie inférieure d’un des vases antiques trouvés dans les
ruines; il reste au fond un résidu qu’on attribue au vin qui
a séjourné dans ces amphore^,
Fig. 6. Ruines Égyptiennes entre el-Telf et. d-Haouatah, à deux
lieues au-dessus de ^Meylâouy,, sur la rive droite du Nil.
Ces ruines sont très - étendues ; outre un grand pombre de
maisons en brique, dont on voit encore l’étage inférieur ou
les fondations, 011 remarque les restes d’une grande porte,
avec une enceinte en partie .conservée, et deux vasfes, édifices
dont le plan peut se reconnoître exactement. (Voyev la description
de ces ruines dans le chap. X V I des Descriptions.)
a. Grande porte Égyptienne. {Yoyez fig. y } 8, p .)
b. Porte rùinée.
C. Extrémité de la grande rue. De ce point, il y a encore
quatre cents à quatre cent cinquante mètres jusqu’à la fin
apparente des ruines : mais on croit que la ville s’étendoit
encore plus loin.
Fig. 7. Restes d’une grande porte JÉgyptienne, de fa même forme
que les pylônes des temples. L’épaisseur est de 7m,y à la
base [plus de 23 pieds], et presque aussi considérable que
celle du grand pylône de Louqsor ; on peut en juger en comparant
le plan à celui de la porte de Louqsor, l’échelle étant
I