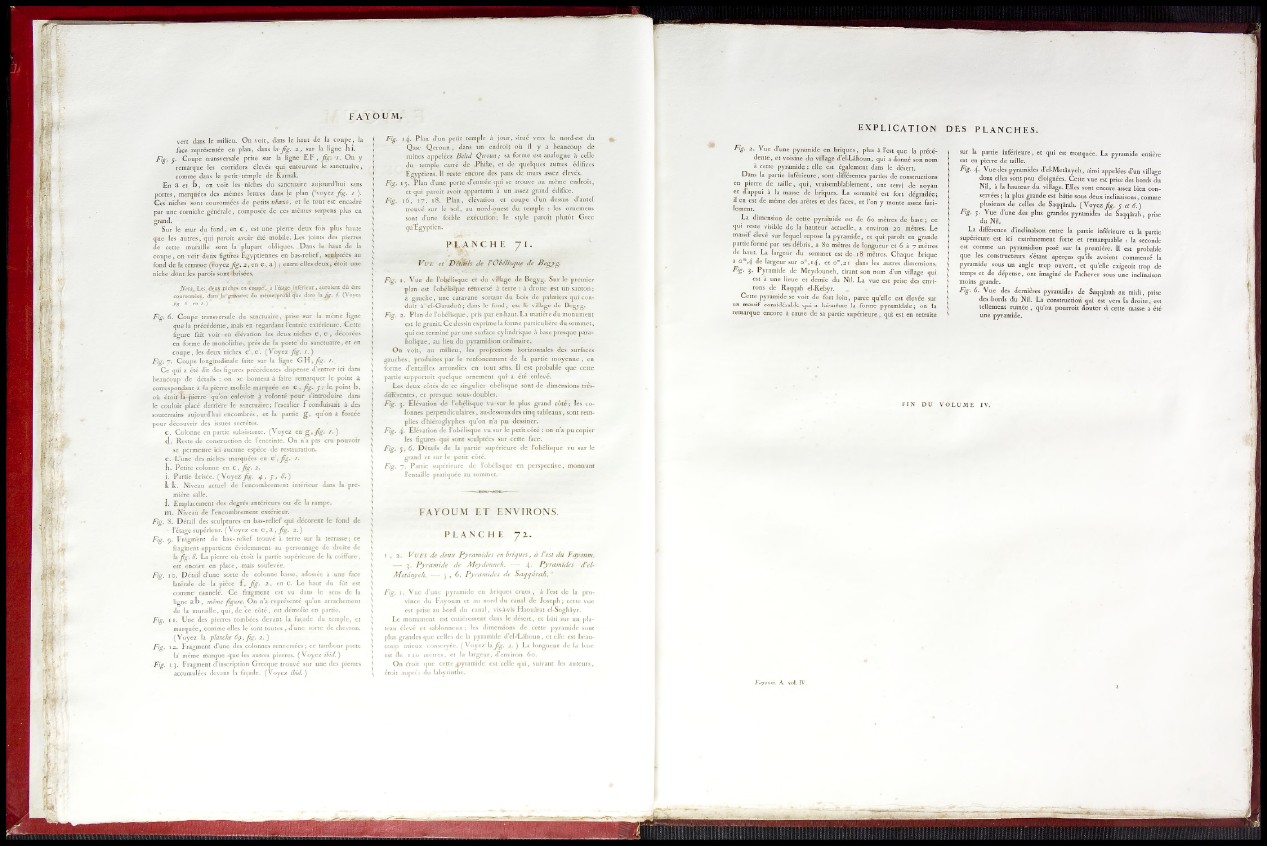
vert dans le milieu. On voit, dans le Haut de la coupe, la
face représentée en plan, dans la'•‘fig. z , sur la ligne I ii.
Fig. 5. Coupe transversale prise sur la ligne E F , fig-. ‘J. On y
remarque les corridors élevés qui entourent le sanctuaire,
comme dans le petit -temple de KarnaL
En a et ï>, on voit les • niches du sanctuaire aujourd’hui sans
portes, marquées des mêmes lettres dans [e plan (Voyez fig. / ).
Ces'-niches Sont Couronnées de petits ubteus-, et le tout est encadré
par une corniche générale, composée de ces mêmes- serpens plus en
grand.
Sur le mur du fond, en C , est une pierre deux fois plus haute
que- les autres, qui paroît avoir été mobile. Les joints des pierres
de cette muraille' sont la plupart obliques. -Dans le haut de la
coupe, on- voit'deüx figtfres Égyptiennes en bas-relief, sculptées au
fond de la terrasse (ÿoyez Jzg. 2, en e , a ) ; entre elles deux, étoit une
niche dônt les parois sont ¿brisées.
Nota.Les^ deuS _nichgs>.en CQgpeV. à l’otage inférieur. auroient dû être
couronnées, dans' la^griiyure? du ipêni^prdfil que dans la jîg. 6. (Voyez
H S B a.) "
Fig. 6. Coupe transversale du sanctuaire, prise sur la même ligne
que la précédente, mais en regardant l’entrée extérieure. Cette
figure fait voir»en élévation les deux niches e , e , décorées
en forme de monolithe*, près de la porte* du sanctuaire, et en
coupe, les deux niches e e r. (Voyez fig. / .)
Fig. y. Coup’e longitudinale faite sur la ligne G H -, fig- /.
Ce qui a été dit des figures précédentes dispense d’entrer ici dans
beaucoup’ de détails : on se bornera à faire remarquer le point a
correspondant à da pierre mobile marquée en C , fig. y;- le point b ,
où étpit‘Ià«pjerre qu’on enfevoit à volonté pour s’introduire dans
le couloir”placé derrière le sanctuaire; l’escalier f conduisant à des
souterrains aujourd’hui encombrés, et la partie g , qu’on a forcée
pour découvrir des issues secrètes.
C. Colonne en partie subsistante. (Voyez en Stfig- i - )
d. Reste de construction de l’enceinte. On n’a pas cru pouvoir
se permettre ici aucune espèce de restauration.
e. L’une des niches marquées en d , fig. /.
h-. Petite colonne en c , fig. 2.
i. Partie brisée. ( Voyez fig. 4 , y , S.)
k k . Niveau actuel de l’encombrement intérieur dans la première
salle.
1. Emplacément des degrés antérieurs ou de la rampe.
m . Niveau de l’encombrement extérieur.
Fig. 8. Détail des sculptures en bas-relief qui décorent le fond de
* l’étage supérieur. (Voyez-en e , a , fig. 2.)
Fif. o. Frâgm'ent de bas-relief trouvé à terre sur la terrasse; ce
fragîhent «appartient évidemment au personnage de droite de
la fig- La pierre où étoit la partie supérieure de la coiffure,
est encore en place, -mais soulevée.
Fier. 10. Détail d’une sorte de colonne basse, adossée à une face
latérale de-la pièce I , fig. 2 , en c . Le haut du fût est
comme* cannelé. Ce fragment est vu dans le sens de la
ligne a b , même figure. On n’a représenté qu’un arrachement
de la muraille, qui, de ce côté, est démolie en partie.
Fig. 1«. Une des pierres tombées devant la façade du temple, et
marquée,.comme elles le sont toutes, d’une sorte de chevron.
(Voyez la planche 69,fig. 2 .)
Fig. 12. Fragment d’une des. colonnes renversées ; ce tambour porte
la* même rfiarque -que les autres pierres. (Voyez ibid. )
Fig. 13. Fragment d’inscription Grecque trouvé sur une des pierres
accumulées devant la façade. (Voyez ibid. )
Fig. 1 4 . Plan d’un petit temple à jour, situé vers le nord-est du
Qasr Qeroun, dans un endroit où il y a beaucoup de
ruines appelées Beled Qeroun ; sa forme est analogue à celle
du temple carré de-JPhihe, et de quelques autres édifices
Égyptiens. II reste encore des pans de murs assez élevés.
Fi<r. 15. Plan d’une porte d’entrée qui se trouve au même endroit,
et qui paroît avoir appartenu à un assez grand édifice.
Fig. 1 6 , 1 7 , 1 8 . Plan, élévation et coupe d’un dessus d’autel
trouvé sur le Sol,' au nord-ouest du temple : les ornemens
sont d’une foible exécution; le style paroît plutôt Grec
qu’Ëgyptien.
P L A N C H E 7 1 .
V u e et D éta ils de l ’Obélisque de Begyg.
Fig. 1. Vue de- l'obélisque et du viHage de Begyg. Sur le premier
plan- est l’obélisque rénversé à terre : à droite »est un santon ;
à gauche,’une caravane sortant du bois de palmiers qui conduit
à* el-Garadoû; dans le fond, est le village de Begyg.
Fig. 2. Plan de l’obélisque, pris par en-haut. La matière du monument
est le granit. C e dessin exprime la forme particulière du sommet,
qui est terminé par une surface cylindrique à base presque parabolique
, au lieu du pyramidion ordinaire.
On voit, au milieu, les projections horizontales des surfaces
gauches, produites par le renfoncement de la partie moyenne , en
forme d’entailles arrondies en tout sëns. 'II est probable que cette
partie supportoit quelque ornement qur a été enlevé.
Les deux côtés de ce singulier obélisque sont de dimensions très-
diiférentes, et presque sous-doubles.
Fig. 3. Elévation de l’obélisque Vu'sur le plus grand côté; les colonnes
perpendiculaires, au-dessous des cinq tableaux, sont remplies
d’hiéroglyphes qu’on n’a p.u dessiner.
Fier. 4. Elévation de l’obélisque vu sur le petit côté : on n’a pu copier
les figures qui sont sculptées sur cette face.
Fig. ç , 6. Détails de la partie supériéure de l’obélisque vu sur le
grand et sur le petit côté.
Fier. 7 . Partie supérieure de l’obélisque en perspective, montrant
l’entaille pratiquée au sommet.
F A Y O U M E T E N V IR O N S .
P L A N C H E 7 2 .
i , 2 . V u e s de deux Pyramides en briques, a l ’est du Fayoum.
— 3. Pyramide de Meydoutieh. — 4 - Pyramides d'el-
Metânyeh. — 5 , 6. Pyramides de Saqqârah.
Fig. 1. Vue d’une pyramide en briques crues, à l’est de la province
du Fayoum et au nord du canal d e Joseph ; cette vue
est prise au bord du canal, vis-à-vis Haouârat cl-Soghâyr.
Le monument est entièrement dans le désert, et bâti sur un plateau
élevé et sablonneux ; les dimensions de cotte pyramide sont
plus grandes que celles de la pyramide d’el-Lâhoun, et elle est beaucoup
mieux conservée. (Voyez la fig. 2. ) La longueur de la base
est de 1 1 0 mètres, et la largeur, d’environ 60.
On droit que cette,pyramide est celle qui, suivant les auteurs,
étoit auprès du labyrinthe.
E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S .
Fig. 2. Vue d’une pyramide en briques, plus à l’est que la précédente,
et voisine du village d’el-Lâhoun, qui a donné son nom
à cette pyramide : elle est également dans le désert.
Dans la partie inférieure, sont différentes parties de constructions
en pierre de taille, qui, vraisemblablement, ont servi de noyau
et d’appui à la masse de briques. La sommité est fort dégradée;
il en est de même des arêtes et des faces, et l’on y monte assez facilement.
La dimension de cette pyraTnide est de 60 mètres de base ; ce
qui reste visible de la hauteur actuelle, a environ 20 mètres. Le
massif éleve sur lequel repose la pyramide, et qui paroît en grande
partie forme par ses débris, a 80 mètres de longueur et 6 à 7 mètres
de haut. La largeur du sommet est de 18 mètres. Chaque brique
a o,n,4 de largeur sur o“ ,i4 , et o" ,2 i dans les autres dimensions.
Fig- 3. Pyramide de Meydouneh, tirant son nom d’un village qui
est à une lieue et demie du Nil. La vue est prise des environs
de Raqqah el-Kebyr.
Cette pyramide se voit de fort loin, parce qu’elle est élevée sur
un massif considérable qui a lui-même la forme pyramidale ; on la
remarque encore à cause de sa partie supérieure, qui est en retraite
j sur la partie inférieure, et qui est tronquée. La pyramide entière
J est en pierre de taille.
j Fig. 4. Vue des pyramides d’el-Metânyeh, ainsi appelées d’un village
J dont elles sont peu éloignées. Cette vue est prise des bords du
¡ j Nil, à la hauteur du village. Elles sont encore assez bien con- servées ; la plus grande est bâtie sous deux inclinaisons, comme
plusieurs de celles de Saqqârah. ( Voyez fig. y .et 6. )
Fig. 5. Vue d’une des plus grandes pyramides de Saqqârah, prise
du Nil.
\ La différence d’inclinaison entre la partie inférieure et la partie
| supérieure est ici extrêmement forte et remarquable : la seconde
| est comme un pyramidion posé sur la première. II est probable
| que les constructeurs s’étant aperçus qu’ils avoient commencé la
| pyramide sous un angle trop ouvert, *et qu’elle exigeoit trop de
( temps et de depense, ont imaginé de l’achever sous une inclinaison
î moins grande.
1 Fig. 6. Vue des dernières pyramides de Saqqârah au midi, prise
des bords du Nil. La construction qui est vers la droite, est
j tellement ruinée, qu’on pourroit douter si cette masse a été
une pyramide.
F IN D U V O L U M E IV .