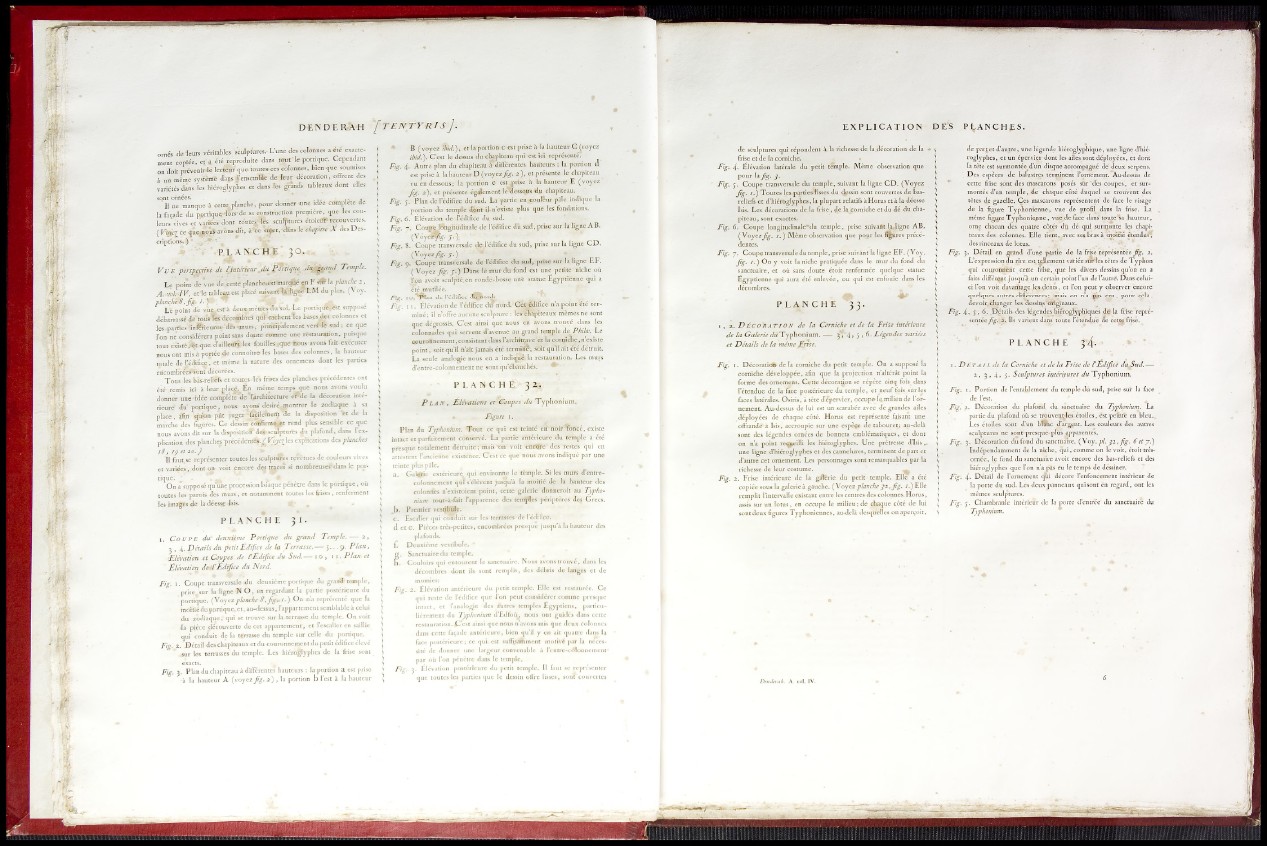
D E N D E R t f M H J t E N T Y R / S J ,
ornés de ‘leurs véritables 'sculptures.- L’une des colonnes a été exactement
copiée, et’ a été reproduite dans tout4 e portique. Cependant
on doit préwenirdè lecieiaf qù&toutes»çeff côlonpes, bien que soumises
à uiî même systèmë d'ans d’enseinÉë de deur décoration, offrent des .
variétés dans les hiéroglyphes et dans.-fes grands tableaux dont elles
sont ornées! . - ' . ,
" i l ne manque à cette, planche, pour donner «ne idee complété de
la façade du portique;«fore-de sa construction première, que les couleurs*
vives et variées dont tdutef. lés; scufpiures étoient'- recouvertes.
ce tjue;.nous'avons- dit, à:ce sujet,'dans le chapitre X des Des-
criptîoiïsv^ *
p . l a n ;.c h e 3 0 . ^
V u e pcrspe.ahie de .Ijntéfkur^dil 'portique, xht.gmml Temple.
Le point de vue de cette plandteitsttnarqué en F sur la planche z ,
A . -vol: IV , et lé tableau est placé suivant ja ligné LM du plan. (Voy.
planche S. fig- *•) ' ? tt
L i point de sù^esf à deusmètte?aaW, Le portiqubiSst suppose
débarrassé de Lotis les décombres qui cachent les bases des colonnes et
les parties inférieures "desèmure, p'ri®palementvery-lg sud; ce que
l’on ne considérera pointsans doute comme une restauration, puisque
tout existé; ¿Lque d'ailleurs Jes fouilles que nous avons fait exécuter
nous ont mis’ à portée de connoître les bases des colonnes, la hauteur
totale de l’édifice, et même la nature des ornemens dont les parties
ericombrées-sont décorées.
Tous -les bas-reliefs et toiues-le's frises des planches précédentes ont
été-.remis ici à leur place. En même temps que nous avons voulu
donner une idée complète de'ljârchitecture et de la décoration intérieure1’
du portique, nous avons- désiré montrer le zodiaque à sa
place, ÿfaf '¿(¿on pût ju g e r * * g lA e * y e la disposition >t de la
marche dès figures. Ce dessin- confirme et rend plus sensible ce que
nous avons dit sur la disposition'des sculptures du plafond, dans l’explication
des planches •précédent#.^ F o l l e s explications des planches
18 , ip et zo: J
II faut se représenter toutes les sculptures revêtues de couleurs vives
et variées,-dont on voit encore des traces si nombreuse#dans le por-
tique; *
On a supposé qu’une procession Isiaque pénètre dans le portique, où
toutes les parois des murs, et notamment toutes les frises, renferment
les imagés de la déesse ¿sis.
P L A N C H E 3 1 .
1. C o u p e du* deuxième Portique du grand Temple. — 2,
5 > 4. Détails du petit Édifice de la Terrasse.— y . .9 . P la n ,
•Elévation et Coupes de l’Édifice du Sud.—- 10 , 11. P lan et
’ Élévation dejïEdifice du Nord.
Fig. 1. Coupe transversale «du deuxième portique du grand temple,
prise sur la ligne -M O , en regardant la partie postérieure du
portique. (V o y e zplanche 8, figmi■) On nia représenté que la
moitié du portique, et, au-dessus, 1 appartement semblable à celui
diu zodiaque,' qui se trouve sur la.terrasse du temple. On voit
4a pièce découverte de cet appartement', et l’escalier en saillie
qui conduit de la terrasse du temple sur celle du portique.
Fig. 2. Détail des chapiteaux et du couronnement du petit édifice éleve
sur les terrasses du temple. Les hiéroglyphes de la frise sont
exacts.
Fig. 3. Plan du chapiteau à différentes hauteurs : la portion a est prise
-à la hauteur A (voyez fig. 2) , la portion b l’est à la hauteur
B ( voyez îbid.), et la portion C est prise à la hauteur G (voyez
ibid.). C ’est le dessus du chapiteau qui est ici représenté.
Fier. 4. Autre plan du chapiteau à différentes haifteurs : la portion a
est prise à la hauteur D (voyez fig. 2 ) , et présente le chapiteau
vu en dessous; la portion 6 est .prise à la hauteur E (voyez
fig. 2), et présente également le^essqù's *d.,u chapiteau.
Fig. y Plan de l’édifice du sud. La partie en: couféur pale indique la
portion du temple cfqnt ü- n’existe plus que les fondations.
Fig. 6. Elévation de: l’édifice du. sud.
Fier. 7. Coupe.longitudinale de l’édifice dû sud, prise sur la ligne AB.
( V o y ^ g . j . f . ■ ■ '
Fiv. 8. Coupe transversale de l’édifice du sud, prise, sur la ligne CD .
(Voyezfig-F-) ; . * . „ „
Fio\ 9. Coupe transversale de l’édifice du sud, prise sur la ligne h r .
( Voyez f ig . J . ) Dans le mur dü fond est une petite niche où
l’on avoit sculpté, en ronde-bosse unè statue Égyptienne qui a
été mutilée.
Fig. 1 o. PTan de l’édifice cf|piordï
Fier. 11. Élévation de l’édifice diTnord. Cet odifice n’a point été terminé;
il n’offre aucune sculpture : Ierenapiteaux mêmes ne sont
que dégrossis. C ’est ainsi que nous en avons trouvé dans les
colonnades qui servent d’avenue au grand teiqple de Phi lot. Le
Gourofinement, consistant dans l’architrave et la corniche, 11 existe
point, soit qu’il n’ait jamais été termine'; soit qu’il ait ete détruit.
La seule analogie nous en a indique? la restauration. Les murs
d’entre-colonnement ne sontqu’ébauchés. *'■
P L A N C H E 3 m
P l a n . É lé v a t io n s et Coupes d u Typhônium.
t-. -Figure |
Plan du Typhônium. Tout ce qui est teinté en hoif^rôricé, existe
intact et parfaitement conservé. La partie antérieure du temple a été
presque totalement détruite ; niais *biï voit endure des restes qui en
attestent l’ancienne existence. C ’est ce que nous avons indiqué par une
teinte plus pâle.
a. Galçjâe extérieure qui environne le tëmple. Si les murs d’entrecolonnement
qui s’élèvent jusqu’à la moitié de la hauteur des
colonnes n’existoient point, cette galerie dbnneroit au Typho-
nium teut-à-fait l’apparence des temjSles périptères des Grecs.
b . Premier vestibule.
C. Escalier qui conduit sur les terrasses de l’édifice,
d et e. Pièces très-petites, encombrées presque jusqu’à la hauteur des
plafonds.
ï. Deuxième vestibule. *
Sanctuaire du temple.
Couloirs qui entourent le sanctuaire. Nous avons trouvé, dans les
décombres dont ils sont remplis, des débris de langes et de
momies!
Fig. 2. Élévation antérieure du petit temple. Elle est restaurée. Ce
qui reste de l’édifice que J’on peut considérer comme presque
intact, et l’analogie des âùtres temples Égyptiens, particulièrement
du Typhônium d’EdfoiL nous ont guidés dans cette
restauration. £ ’est ainsi que nous n avons mis que deux colonnes
dans cette façade antérieure, bien qu’il y en ait quatre dans la
face postérieure; ce qui. est suifyâmment motivé par la nécessité
de donner une largeur convenable à l’cntre-culonncmcnt*
par où l’on pénètre clans le temple.
Fig. 3. Élévation postérieure du petit temple. Il faut sc représenter
que toutes les parties que le dessin offre lisses, sont couvertes
E X P L I C A T I O N D É*S P L A N C H E S .
de sculptures.qui répondent à,la richesse de. Ia^écoration de la <
frise et de la corniche.
Fig. 4- Élévation latérale du petit temple. Même observation que
pour Ia_/%-, 3 . „ v £* - ,
Fig. y Coupe transversale du temple, suivant la ligne C D . (Voyez
fig, /.) -Toutes les parties-fisses du dessin sont couvertes de bas-
reliefs et d’hiéroglyphes, la plupart relatifs à Horus et à la déesse
Isis. Les décorations de la frise, Je,la corniche et du dé du chapiteau,
sont exactes. .
Fig. 6. Coupe longitudinale*du temple, prise suivanftja^Iigne AB.
( Voyez fig. 1. ) Même observation que pour les figures précédentes.
Fig. 7. Coupe transversale du temple, prise suivânt la ligne EF. (Voy.
fig. 1. ) On y voit la niche pratiquée dans le mur du fond du
sanctuaire, et où sans doute étoit renfermée quelque statue
Égyptienne qui aura été enlevée, ou qui est enfouie dans les
décombres.
mttU
P L A N C H E 3 3 .
1 , 2. D é c o r a t i o n de la Corniche et de la Frise intérieure
de la Galerie ¿/«Typhônium. — 3 , 4 > 5 > 6. Légendes variées
et Détails de la même firise.
Fig. 1. Décoration- de la corniche du petit temple. On a supposé la
corniche développée, afin que la projection n’altérât point la
forme des ornemens. Cette décoration se répète cinq fois, dans
l’étendue de la face postérieure du temple, et^neuf fois sûr les
faces latérales. Osiris, à têted;epervier, occupeIç.milieu de l’ornement.
Au-dessus de lui est un scarabée avec de grandes ailes
déployées de chaque côté. Horus est représenté faisant une
offrande? à Isis, accroupie sur une espèce de tabouret^; au-delà
sont des légendes ornées de bonnets emblématiques, ët dont
on n’a point requeilii les hiéroglyphes. Une prêtresse d’Isis,.
une ligne d’hiéroglyphes et des cannelures, terminent de part et
d’autre cet ornement. Les personnages sont remarquables par la
richesse de leur costume.
Fig. 2. Frise intérieure de la galerie du petit temple. Elle a été
copiée sous la galerie à gauche. (Voyez planche y z , fig. /.) Elle
remplit l’intervalle existant entre les centres des colonnes. Horus,
assis sur un lotus, en occupe le milieu; de chaque côté de lui
sont deux figures Typhoniennes, au-delà desquelles on aperçoit,
de par|.et d’autre, une légende hiéroglyphique, une ligne d’hié-
roglyphes, et un épervier dont les ailes.sont déployées, et dont
la tête est surmontée d’un disque accompagné de’ deux serpens.
Des espèces de balustres terminent l’ornement. Àu-dessùs de
cette frise sont des iiiascar.ons posés sûr'des coupes , et surmontés
d’un temple, de chaque côté duquel se trouvent des
têtes de gazelle. Ces mascarons représentent de face le visage
de la figure Typhonienne-, vue de profil dans la frise. La
même figjÿ'e Typhonippne, vue de face dans" toute'îsa „hauteur,
orne chacun des quatre côtés dt^ dé. qui surmonte. les chapiteaux
des colonnes. Elle tient, avec ses bras à 'moitié étendu*
des rinceaux de lotus.
Fig. 3. Détail, en grand d’une partie de la frise représentée fig. z.
L ’expression du -rire, est tellement variée suFÎes têtes de Typhon
qui couronnent cette frise, que les divers dessins qu’on en a
faits diffèrent jusqu’à un certain point l’un deTautrë. Dans celui-
ci l’on voit davantage les, dents, et l’on peut y observer encore
quelques autres différences; «mais on li’a ^ s cru, pour cela,
devoir,(éhanger les dessins'cMginaux.
Fig. 4 , 5 , 6. Détails des légendes hiéroglyphiques d# la frise représentée
fig.îjz,. Ils varient dans toute l'étendue de cette frise.
P L A N C H E y / f . -
i . D é t a i l de la Corniche et de la Frise de l ’Edificè dujïud.—
2 , 3 , 4, y Sculptures intérieures dit Typhônium.
Fig. 1. Portion de ¿’entablement du temple du sud, prise sur la face
de l’est.
Fig. 2. Décoration du plafond du sanctuaire du Typhônium. La
partie du plafond où se trouvenfcjles, éto.iles, est peirifh en hleu.n
Les étoiles sont d’un brame d’argent. Les couleurs des autres
sculptures ne sont'presquê« plus apparentes.
Fig. 3. Décoration du fond du sanctuaire. (Voy. pl. y z , fig. 6 et pi)
Indépendamment de la niche, qui, comme on le voit, étoit très*
ornée, le fond du sanctuaire avoit encore des bas-reliefs et des
hiéroglyphes que l’on n’a pas eu le temps de dessiner.
Fig. 4- Détail de l’ornement qui décore l’enfoncement intérieur de
la porte du sud. Les deux panneaux qui sont en regard, ont les
mêmes sculptures.
Fig. y Chambranle intérieur de la porte d’entreé du sanctuaire du
Typhônium.
Drndernh. A. vol. IV.