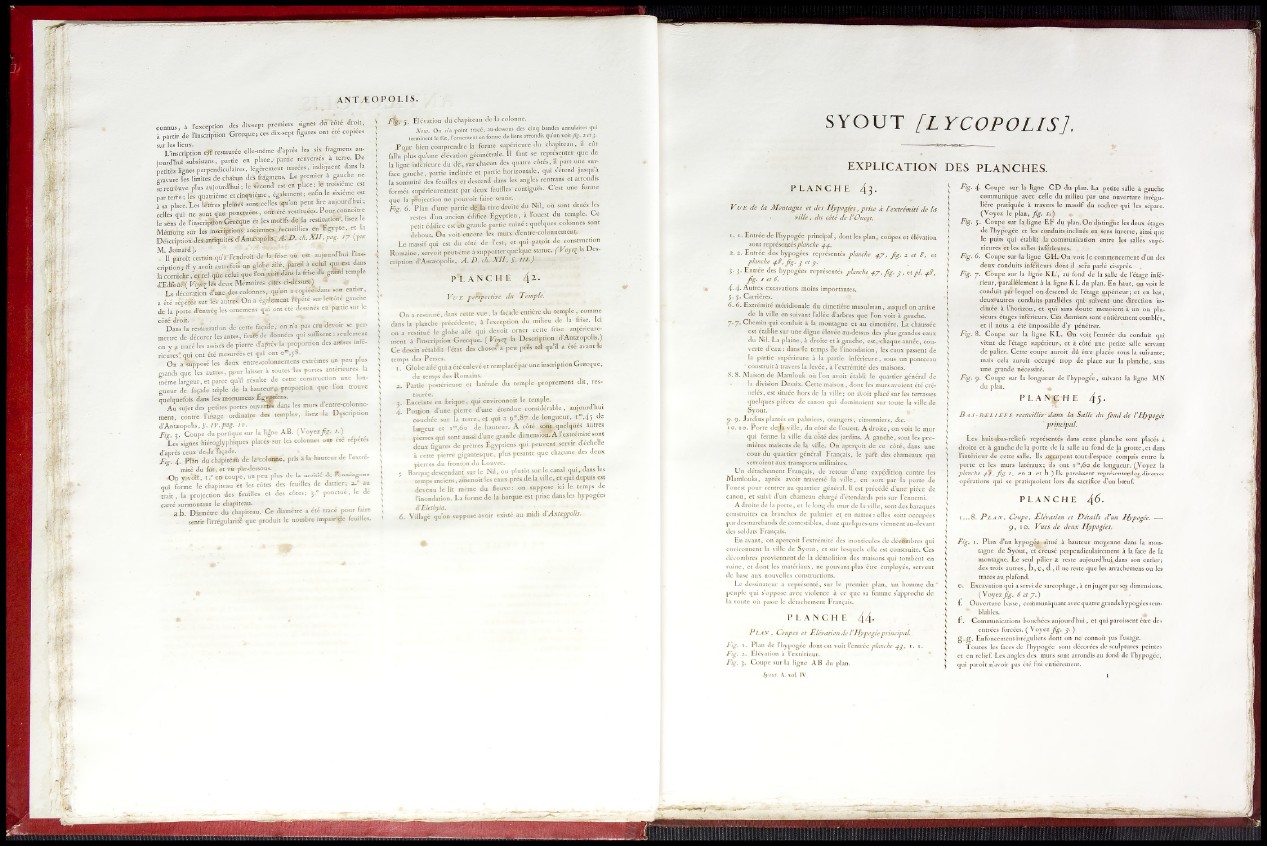
A N T Æ O P O L I S .
connus à ¡’exception Jes dix-sept premiers signes diTcôté droit;
à partir de l'inscription Grecque; ces dix-sept figures ont été copiées
sur les lieux. . f
L’inscription e lt restaurée elle-même ^ a | rp les six fragmens au-
H H « place ,.partie renvérs& a terre. De
petites lignes perpendiculaires, légèrement tracées , indiquent dans la
U v u re fis limites de chacun dés fragmens. Le premier a gauche ne
se retrouve plus aujourrShui le second est-en place ; le troisième est
par teirê ; lès quatrième et cinquième, également; enfin le sixième es.
rsa%faee.les tëtfres pleines sont celles «Ju'on peut lire aujourdhui;
celles qui- ne sont que. ponctuées, ont-iéié restituées. Pour.conno.tre
le sens de ImscripWGreèque etjes moiifi,délia restitution, l.serle
Mémoire'sûr' les insçnp.pîotfs; anciennes recueillies eh'Egypte,.et la
Dêseri^idnàdaita4tiipSiféSdîÂnt^cipôIis;'A.’ D. ch .X II .ja g . 1 7 (par
M. Joînard). i: ."x ■-* W* * ® . p.
. II paraît cernin qu a J’endroit dé là;frise, où est aujourdhui lin»
criptionV il y avoir autrefois un glohé ailé, pareil à celui qui‘est dans
la comicfie,' etrel- q îe celui que l’on voitdani la frise du grand remple
ÆEdfoû-if Kqy%1S deux Mémoires cités cirdéssusï) *
La décoration ifùne des colonnes, qu’on a copiéé-dans son entier,
a été a égatoent ftpêté snrietcôré gauene
de-la porte dhmtrég les omemens qui ont été dessinés en parue sur le
côté droit. '*
Dans la restauration de cette façade, on n’a pas cru devoir se per-
mettre de décorer lésantes, fauTÉde ddnuées qui suffisent : seulement
on y ¿1 tracé les assisés de pierre .l'afrès ^proportion des assises inférieures?
qui ont été mesurées et qui ont o“ ,jS .
On a sùpposé les deùx entre.colonnemens extrêmes un peu plus
grands que les autres, ppur laisser à toutes‘ les portes antérieures la
même largeur, et parce qu’il résulte de cette cons.ruc.ion une longueur
de façade triple de la hauteur-proportion que Ion trouve
quelquefois dans les momimens Égyptiens.
Au sujet des petites portes ouvertes dans les murs dentre-colonne-
tnena, contre l'usage ordinaire des temples, lisez da Dsscr.pt.on
. d’Àntæopofis, J. I V , pog- ¡ 0 . " ' '
Fig. 2. Coupe du portique sur la ligne AB. (Voyez fig. t .)
.Les'signes hiéroglyphiques placés-sur les colonnes on» été répétés
d’après ceux déjà' façade. 1
Fie. 4- P15Ù dit chdpitêifc de la-coIoMe, pris à la hauteur de 1 extrémité
du fût, et via' phr-dessous.
On V»v3ü , 1 en coupe, un peu plus de la moitié de Ieuuéagone
qui formé le chapiteau et les côtes des feuille» de dattier; z.° au
¿-ait, la projection des feuilles et des côtes; 3." ponctué, le de
carré surmontant le chapiteau.
a b. Diamètre du chapiteau. Ce diamètre a été tracé pour faire
sentir l’irrégularité que produit le nombre im p a ire feuilles.
\ Fïjgi 5. Élévation du chapiteau de la colonne.
j ............ Nota. On n’a point tracé, au-dessous des cinq bandes annulaires qui
terminent le fût, l’ornement en forme de liens arrondis qu’ on voit fig. 2 et 3.
Tou r bien comprendre la ferme supérieure du chapiteau, il eût
1 fallu plus qu’une élévation géométrale. II faut se représenter que de
! la ligne inférieure du dé, sur chacun des quatre côtés, il part une surface
gauche, partie inclinée et partie horizontale, qui s’étend jusquà
la sommité des feuilles et descend dans les angles rentraus et arrondis
| formés supérieurement par deux feuilles- contiguës. Cest une oime
^ que la projection ne pouvoit faire sentir. .
\ Fi?. 6. Plan d’une partie dë?la rive droite du Nil, où sont situes les
) restes d’un anciem édifice Égyptien, à l'ouest du temple. Ce
petit édifice est’-oh grande partie ruiné : quelques colonnes sont
) debout. Ôn voit* encore les mure d’entre-colonnement.
Le massif qui est du côté de l’est, et-qui paçpk de construction
i Romaine, servoit peut-être à supporter quelque statue. ( Voy«?£ la Des-
\ cription d’Antæopolis, A . D . ch. X I I , § . I I I . )
p I a n c h e 4 2 -
V u e perspective du Temple.
I On a restauré, dans cette vue, la façade entière du temple,^comme
! dans la planche précédente, à l’exception du milieu de la Bise. Ici
on a restitué le globe ailé qui devoit orner cette frise antérieure-
I ment à l’inscription Grecque. ( KW I» Description ,d Annnopohs )
j Ce dessin rétablit l’état des choses*à peu près teb qu’il a etc avant4e
i temps des Perses. ^ _ #
| 1. Globe aile qui a été enlevé et remplacé par une inscription Grecque,
\ du temps des Romains.
\ 2. Partie postérieure et latérale du temple proprement dit, restaurée.
’
1 3. Enceinte en brique, qui environnoit le temple. ^
I 4'. Portion d’une pierre d’une étendue considérable, a-.ij<pird'hui
1 couchée sur la terre, ef qui a 9” ,8:7, deJ.Qngli.eu,-, ;r»,4 5 de
lasgeur et i “ ,6o de hauteur. À . côté sont quelques autres
pierres qui sont aussi d’une grande dimension; A I extrémité sont
deux figures de prêtres Égyptiens qui peuvent servir d’échelle
à cette pierre gigantesque, plus pesante que chacune des deux
pierres du fronton du Louvre. ■ •
! s . Barque descendant sur le Nil, ou plutôt sur.Ie canal qui,dans les
temps anciens, amenoit les eaux près de la ville, et qui depuis est
devenu le lit même du fleuve; on suppose .ici le, temps de
l’inondation. La forme de la Barque est prise dans les hypogées
SElelhyia. ’ ’ »
6. Village qu’on suppose avoir existé au midi d Antcegpolis.
SYOU T [L YCO
E X P L I C A T IO N D E S P L A N C H E S .
P L A N C H E 4 3 -
V u e de la Montagne et des Hypogées, prise à l'extrémité de la
ville, du côté de l’.Oue^t.
1. 1. Entrée de Ihypogee principal, dont les plan, coupes et élévation
sont représentés planche 44..
2. 2. Entrée des hypogées représentés planche 4 7 , fig. 2 et 8, et
planche 48, fig. y et p.
3.3. Entrée des hypogées représentés planche 4 7 , fig. y , et pl. 48,
fig. 1 et 6.
4.4. Autres excavations moins importantes,
y. ç. Carrières.
6. 6. Extrémité méridionale du cimetière musulman, auquel on arrive
de la ville ensuivant lallee d’arbres que l’on voit à gauche.
7' 7‘ Chemin qui conduit à la montagne et au cimetière. La chaussée
est établie sur une digue élevée au-dessus des plus grandes eaux
du Nil. La plaine, à droite et à gauche, est,»chaque année, couverte
deau : dans de temps de l’inondation, les eaux passent de
la partie supérieure à la partie inférieure, sous un ponteeau
- construit à travers la levée, à l’extrémité des maisons.
8. 8. Maison de Mamlouk où l’on avoit établi le quartier général de
la division Desaix. Cette maison, dont les murs avoient été crénelés
, est situee hors de la ville ; on avoit placé sur les terrasses
quelques pièces de canon qui dominoient sur toute la ville de
Syout.
.9.9. Jardins plantés en palmiers, orangers-, citronniers, &c. -
10. 10. Porte d^ â ville, du côté de l’ouest. A droite, on voit le mur
qui ferme la ville du côté des jardins. A gauche, sont les premières
maisons de la ville. On aperçoit de ce côté, dans une
cour du quartier général Français, le paré des chameaux qui
servoient aux transports militaires.
Un détachement Français, de retour d’une expédition contre les
Mamlouks, après avoir traversé la ville, en sort par la porte de
l’ouest pour rentrer au quartier général. II est précédé d’une pièce de
canon, et suivi d’un chameau chargé d’étendards pris sur l’ennemi.
A droite de la porte, et le long du mur de la ville, sont des baraques
construites en branches de palmier et en nattes
par des marchands de comestibles, dont
des soldats Français.
En avant, on aperçoit l’extrémité des monticules de déc®nbres qui
environnent la ville de Syout, et sur lesquels elle est construite. Ces
décombres proviennent de la démolition des maisons qui tombent en
ruine, et dont les matériaux, ne pouvant plus être employés, servent
de base aux nouvelles constructions.
Le dessinateur a représenté, sur le premier plan, ün homme du
peuple qui s’oppose avec violence à ce que sa femme s’approche de
la route où passe le détachement Français.
P L A N C H E 4 4 .
P l a n , Coupes et Elévation de l ’Hypogée principal.
Fig. 1. Plan de l’hypogée dont on voit l’entrée planche 43, 1. 1.
Fig. 2. Elévation à l’extérieur.
Fig. 3. Coupe sur la ligne A B du plan.
Syout. A. vol. IV.
es sont occupées
quelques-uns viennent au-devant
Fig. 4. Coupe sur la ligne C D dû plan. La petite salle à gauche
communique avec, eelle du miligu par une ouverture irrégulière
pratiquée à travers le massif du rochei» qui les sépare.
(Voyez le plan, fig.
Fig. y. Coupe sur la;digne E F du plan. On distin|ue les deux étages
de I1 hypogée et les conduits inclinés en sens inverse, ainsi que
le puits qui établit la çoînmliniçation entre igs galles supérieures
'¿t les salles jnférie.ures.
Fig. 6. Coupe sur da ligne GH.-OnAvoit Je, commencement d’un des
deux conduits inférieurs ‘dont il sera parlé ci-après. . ,
Fig. y. Coupe sur la ligne K'L', au fond de’ la Salle de l’étage inférieur,
«parallèlement à la-ligne K L du plan. En haut, gg vpit le
conduit par lequel on descend de l’étage gppérieur; et en bas,
deux&autres conduits parallèles qui suivent une direction in-
clinée à l’horizon, et qui sans douté menoient à ün ou plusieurs
étages inférieurs. Ces derniers sont entièrement comblés,
et il nous a été impossible d’y pénétrer.
Fig. 8. Coupe sur la ligne K L . ®n voi^ l’entrée du conduit qui
vfent de l’étage supérieur», et à côté une petite salle servant
de palier. Cette coupe auroit dû être „placée sous la suivante;
mais cela auroit occupé trpp de place sur la planche,-sans
une grande nécessité.
Fig. 9. Coupe sur la longueur de l’hypogée, suivant la ligne MN
du plan.
P L A N « H E 4 ")■
B a s - r * e l i e f s recueillis'dMi's la Salle'du fond de l ’Hypogie
' principal.
Les huit^bas-reliefs représentés dans cette planche sont placés à
droite et à gauche de la porte de la salle au fond de la grotte, et dans
l’intérieur de cette salle. Ils .occupent toutjd’espace compris entre la
porte et les murs latéraux; ils ont 1 m,é>o.,de longueur. (Voyez la
planche 4%, fig. i , en a et b.) Iis paraissent représenter/les,diverses
opérations qui se pratiquoient lors du sacrifice d’un boeuf.
P L A N C H E 46.
1...8. P l a n , Coupe, Elévation et Détails d’un Hypogée. —
9, 10. Vues de deux Hypogées.
Fig. 1. Plan d’un hypogée situé à hauteur moyenne, dans la montagne
de Syout, et creusé perpendiculairement à la face de la
montagne. Le seul pilier a reste aujourd’hu^dans son entier;
des trais autres, b , C, d , il ne reste que les arrachemens ou les
traces au plafond.
e. Excavation qui aservide sarcophage,à en juger par ses dimensions.
( Voyez fig. 6 et 7 .)
f. Ouverture basse, communiquant avec quatre grands hypogées sein-
6 blables.
f'. Communications bouchées aujourd’hui, et qui paraissent être des
entrées forcées. ( Voyez fig. p. )
g . g . Enfoncemens irréguliers dont.on ne connoît pas l’usage.
Toutes les faces de l’hypogée sont décorées de sculptures peintes
et en relief. Les angles des murs sont arrondis au fond de l’hypogée,
qui paraît n’avoir pas été fini entièrement.