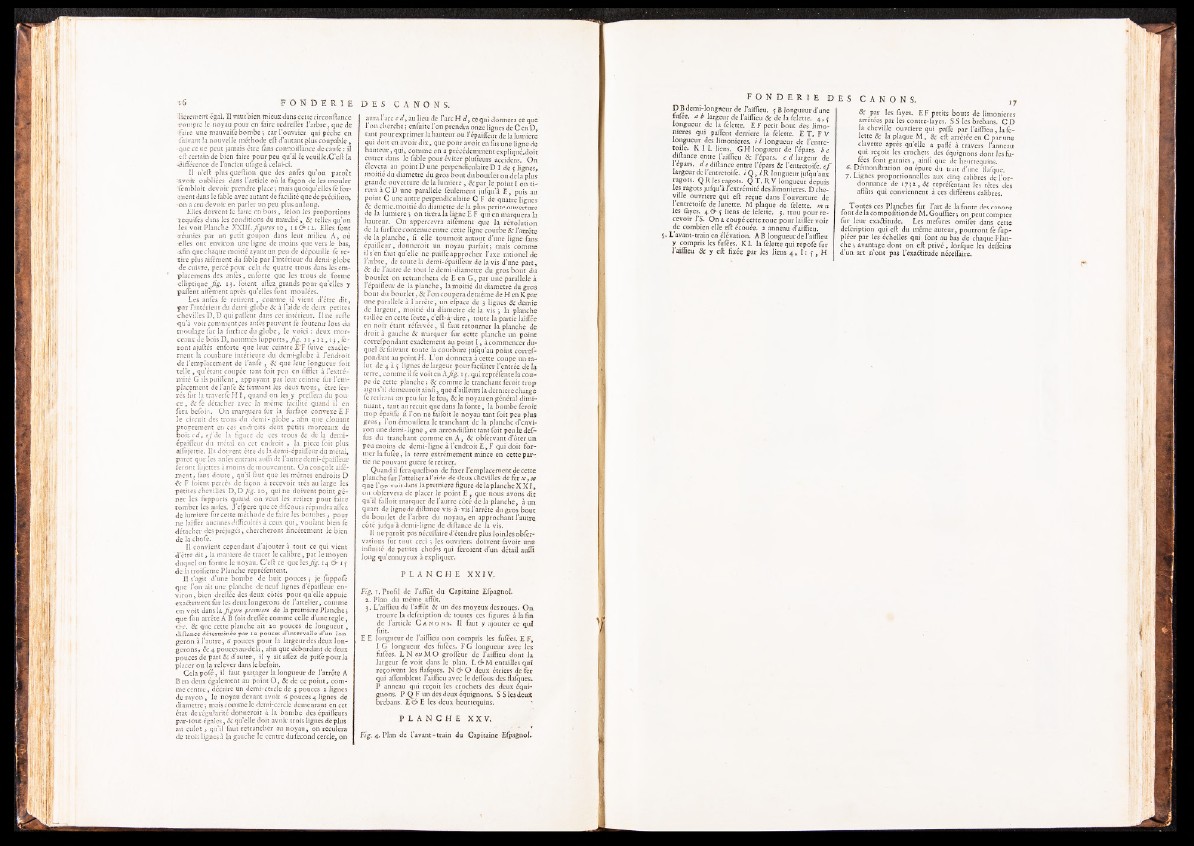
lierement égal. îl vautbien mieux dans cette circonfiance
«rompre le noyau pour en faire redreiïèr l’arbre, que de
■ -faire une mauvaifè bombe ; car l’ouvrier qui pèche en
■•fui van t la nouvelle méthode eft d’autant plus coupable,
'que ce ne peut jamais être fans connoiflànce decaulê : il
-eft certain de bien faire pour peu qu’il 4e veuille.C’eft la
«différence de l’ancien ufage à celui-ci.
Il ri’eft plus queftion que des anfès qu’on paroît
savoir oubliées dans l’article où la façon de les mouler
''fèmbloit devoir prendre place; mais quoiqu’elles fè foramen
t dans le fable avec autant de facilité que de précifion,
«on a cru devoir en parler un peu plus au long.
Elles doivent fe faire en bois, félon les proportions
requifes dans les conditions du marché, 6c telles qu’on
les voit Planche XXIII. figures iq , 1 1 & i l . Elles font
•«réunies par un petit goujon dans leur milieu A , où
•elles ont environ une ligne de moins que vers le bas,
•afin que chaque moitié ayant un peu de dépouille le retire
plusaifément du fable par l’intérieur du demi-globe
de cuivre, percé pour cela de quatre trous dans les em-
placemens des anfès, enforte que les trous de forme
«lliptique fig . 13. foient allez grands pour qu’elles y
paflènt aifément après qu’elles font moulées.
Les anlès le retirent, comme il vient d’être dit,
par l’intérieur du demi-globe & à l’aide de deux petites
chevilles D, D qui paflènt dans cet intérieur. Il ne refte
•qu’à voir commentées anlès peuvent fe foutenir lors du
moulage fur la furfacedu globe, le voici : deux morceaux
de bois D , nommés fupports, fig . 1 1 , 1 2, 13, feront
ajuftés enlorte que leur ceintre E*F fuive exactement
la courbure intérieure du demi-globe à l’endroit
de l’emplacement de faille , 6c que leur longueur foit
telle , qu’étant coupée tant foit peu en lifflet à l’extrémité
G ils puiffent, appuyant par leur ceintre fur l’emplacement
del’anfe & fermant les deux trous, être ferrés
fur la traverfè H I , quand on les y preffera du pouce
, 6c le détacher avec la même facilité quand il en
fera befoin. On marquera fur la lùrface convexe E F
le circuit des trous du demi-globe , afin que clouant
proprement en ces endroits deux petits morceaux de
b o isc^ , e f de la figure de ces trous & de la demi-
épaiffcur du métal en cet endroit , la piece foit plus
affujettie. Ils doivent être delademi-épaillèur du métal,
parce que les anlès entrant aum de l’autre demi-épaiffeur
feront fujettes à moins de mouvement. On conçoit aifément
, fans doute, qu’il faut que les mêmes endroits D
& F foient percés de façon à recevoir très au large les
petites chevilles D, D fig. 10 , qui ne doivent point gêner
les fupports quand on veut les retirer pour faire
tomber les anfes. J ’efpere que ce difcours répandra affez
de lumière fur cette méthode de faire les bombes, pour
ne laiffer aucunes difficultés à ceux qui, voulant bien le
détacher des préjugés, chercheront lîncérement le bien 1
de la chofe.
Il convient cependant d’ajouter à tout ce qui vient
d’être dit, la maniéré de tracer le calibre, par le moyen
duquel on forme le noyau. C’eft ce que les fig. 14 ô> 1 y
de la troifîeme Planche repréfentent.
Il s’agit d’une bombe de huit pouces ; je fuppofe
que l’on ait une planche de neuf lignes d’épaiflèur environ
, bien dreffée des deux côtés pour qu’elle appuie
exactement fur les deux longerons de l’attelier, comme
on voit dans la figure première de la première Planche ;
que fon arrête A B foit dreffée comme celle d’une réglé,
&>c. 6c que cette planche ait zo pouces de longueur ,
diftance déterminée par 10 pouces d’intervalle d’un longeron
à l’autre, 6 pouces pour la largeur des deux longerons#
6c 4 pouces au-delà, afin que débordant de deux
pouces de part & d’autre, il y ait allez de prilè pour la
placer ou la relever danslebefoin.
Cela pofé, il faut partager la longueur de l’arrête A
B en deux également au point O , & de ce point, comme
centre, décrire un demi-cercle de 3 pouces 2 lignes
de rayon, le noyau devant avoir 6 pouces 4 lignes de
diamètre; mais comme le demi-cercle demeurant en cet
état de régularité donneroit à la bombe des épaiflèurs
par-tout égales, & qu’elle doit avoir trois lignes de plus
au culot, qu’il faut retrancher au noyau, on reculera
de trois lignes à la gauche le centre du fécond cercle, on
aura 1 arc c d , au lieu de 1 arc H </, ce qui donnera ce que
l’on cherche ; enfuite l’on prendra onze lignes de C en D,
tant pour exprimer la hauteur ou l’épaiffcur de la lumière
qui doit en avoir dix, que pour avoir en fus une ligne de
hauteur, qui, comme on a précédemment expliqué,doit
entrer dans le fable pour éviter plufieurs accidens. On
élevera au point D une perpendiculaire D I de f lignes,
moitié du diamètre du gros bout du bourlet ou de la plus
grande ouverture delà lumière , &par le point I on tirera
à C D une parallèle feulement jufqua E , puis au
point C une autre perpendiculaire C F de quatre lignes
Sc demie, moitié du diamètre de la plus petite ouverture
de la lumière ; on tirera la ligne E F qui en marquera la
hauteur. On appercevra aifement que la révolution
de la furface contenue entre cette ligne courbe & l’arrête
de la planche, fi elle tournoit autour d’une ligne fans
épaiffeur, donneroit un noyau parfait; mais comme
il s’en faut qu’elle ne puiffe approcher l’axe rationel de
l’arbre, de toute la demi-épaiffeur de la vis d’une part,
& de l’autre de tout le demi-diamètre du gros bout du
bourlet on retranchera de E en G , par une parallèle à
! l’épaiffeur de la planche, la moitié du diamètre du gros
bout du bourlet, & l’on coupera de même de H en K par
une parallèle à l’arrête, un efpace de 3 lignes & demie
de largeur, moitié du diamètre de la vis ; la planche
taillée en cette forte, c’eft-à-dire, toute la partie Jaiflee
en noir étant réfèrvée, il faut retourner la planche de
droit à gauche & marquer fur cette planche un point
correfpondant exactement au point I , à commencer duquel
ôc fiiivant toute la courbure jufqu’au point corref-
pondant au point H. L’on donnera à cette coupe un ta-
lut de 4 à f lignes de largeur pour faciliter l’entrée de la
terre, comme il fe voit en A fig. 1 f . qui repréfente la coupe
de cette planche ; & comme le tranchant fèroit trop
aigu s’il demeuroit ainfi, que d’ailleurs la derniere charge
fe retirant un peu fur le feu, & le noyau en général dimi-,
nuant, tant au recuit que dans la fonte, la bombe fèroit
trop épaillè fi l’on ne faifbit le noyau tant foit peu plus
gros, l’on émouflèra le tranchant de la planche d’environ
une demi-ligne, en arrondifïànt tant foit peu le def-
fus du tranchant comme en A , & obfèrvant d’ôter un
peu moins de demi-ligne à l’endroit E ,F qui doit former
la fufée, la terre extrêmement mince en cette par-,
tie ne pouvant guere fè retirer.
Quand il fèra queftion de fixer l’emplacement de cette
planche fur l’attelicv à l’aide de deux chevilles de fer x , x
que l’on voit dans la première figure de la planche X X I ,
on obfervera de placer le point E , que nous avons dit
qu’il falloit marquer de l’autre côté delà planche, à un
quart de lignede diftance vis-à-vis l’arrête du gros bout
du bourlet de l’arbre du noyau, en approchant l’autre
côté jufqu’à demi-ligne de diftance de la vis.
Il ne paroît pas nécefiàire d'étendre plus loinles obfer-
vations fur tout ceci ; les ouvriers doivent favoir une
infinité de petites chofes qui fèroient d’un détail aufïï
long qu’ennuyeux à expliquer.
P L A N C H E X X I V .
Fig. t. Profil de l’affût du Capitaine Efpagnol.
z. Plan du même affût.
3. L’aiflieu de l’affût & un des moyeux des roues. On
trouve la defèription de toutes ces figures à la fin
de l’article C a n on s . Il faut y ajouter ce qui
fuit.
E E longueur de l’aiflieu non compris les fufées. E F,
I G longueur des fufées. F G longueur avec les
fufées. L N ou M O groffeur de l’aiffieu dont la
largeur fè voit dans le plan. L & M entailles qui
reçoivent les flafques. N & O deux étriers de fer
qui affemblent l’aiffieu avec le deffous des flafques.
P anneau qui reçoit les crochets des deux équi-*
gnons. P Q F un des deux équignons. S S les deux
brebans, Ed* E les deux heurtequins.
P L A N C H E X X V .
Fig. 4. Plan de l’avant - train du Capitaine Efpagnol.
F O N D E R I E D
D B demi-longueur de l’aiflieu. y B longueur d’une
fufee. a b largeur de l’aiffieu & de la felette. 4 , f
longueur de la fèlette. E F petit bout des limo-
nieres qui paflènt derrière la fèlette. E T , F V
longueur des limonieres. i l longueur de l’entre-
toifè. K I L liens. G H longueur de l’épars, b c
diftance entre l’aiflieu & l’épars, c d largeur de
1 epars. d e diftance entre l’épars & l’cntretoifè. e f
largeur de 1 entretoifè. i Q , /R longueur jufqu’aux
ragots. Q R les ragots.^ Q T . R V longueur depuis
les ragots jufqu’à l’extrémité des limonieres. D cheville
ouvrière qui eft reçue dans l’ouverture de
l’entretoife de lunette. M plaque de fèlette. m n
les fàyes. + & f liens de felette. 3. trou pour recevoir
l’S. On a coupé cette roue pour Jaiflèr voir
de combien elle eft écouée. 2 anneau d’aiffieu.
L avant-train en élévation. A B longueur de l’aiffieu
y compris les fufees. K L la fèlette qui repofè fur
l’aiffieu & y eft fixée par les liens 4 • 1 ; f , H
8c par les fàyes. E F petits bouts de limonieres
arrêtées par les contre-fàyes. S S les brebans. C D
la cheville ouvrière qui paflè par I’aiflîeu, la felette
& la plaque M , & eft arrêtée en C par une
clavette après qu’elle a paflé à travers l’anneau
qui reçoit les crochets des équignons dont les fufées
font garnies, ainfi que de heurtequins..
G. Démbnftration ou épure du trait d’une flafque.
7. Lignes proportionnelles aux cinq calibres de l’ordonnance
de 1731 , 6c repréfentant les têtes des
affûts qui conviennent à ces différens calibres.
Toutes ces Planches fur l’art de la fonte des canons
fontdelacompofitionde M.Gouffier; on peut compter
fur leur exactitude. Les mefures omifès dans cette
defèription qui eft du même auteur, pourront fè fup-
pléer par les échelles qui. font au bas de chaque Planche
; avantage dont on eft privé, lorfque les deflèins
d’un art n’ont pas l’cxaétitude ncceffaire.