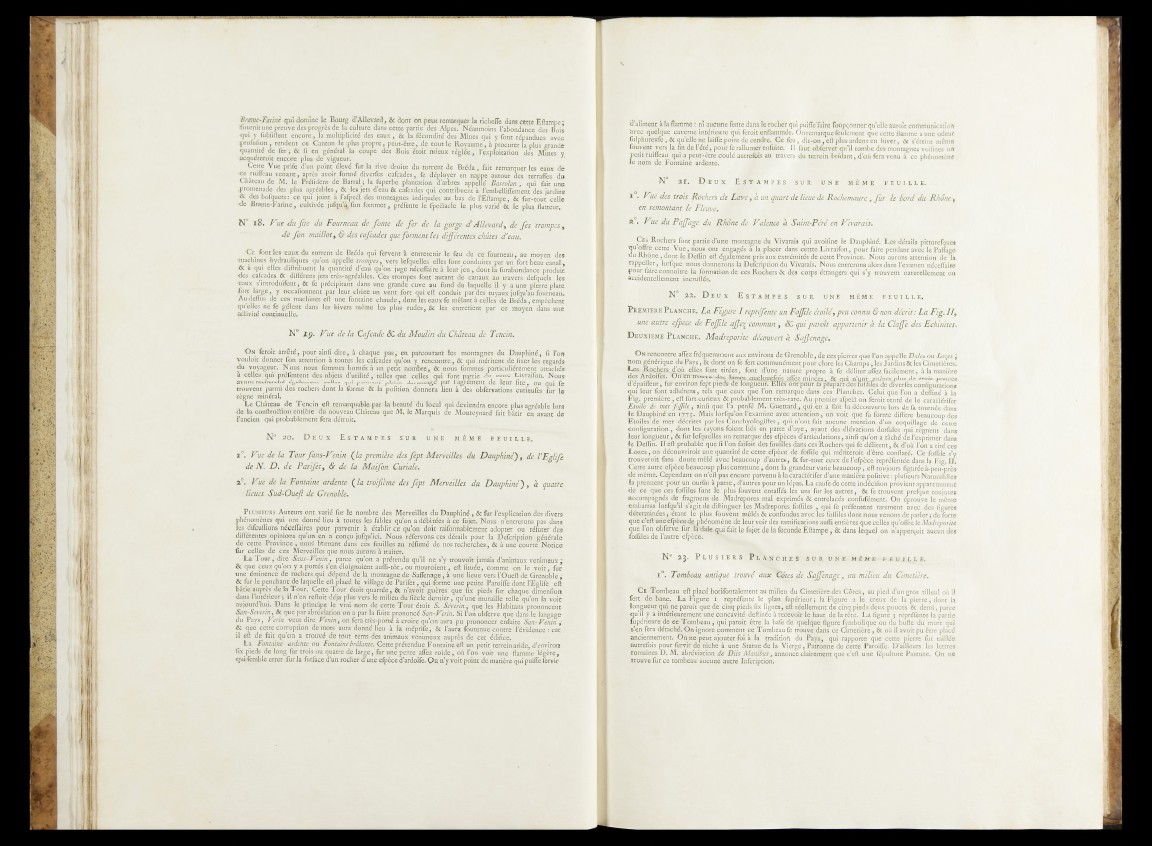
’Brame-Forint 4ÙI .domine le Bourg d’AlIevard, & dont on peut remarquer la richeffe dans cette Eflampe}
tfournitune preuve des progrès de la culture dans cette partie des Alpes. Néanmoins l'abondance des Bois
■ qui y fublillent encore., la multiplicité des eaux, & la fécondité des Mines qui y font répandues avec
.profufion , rendent ce Canton le iplus propre, peut-être, de tout le Royaume, à procurer la plus grande
quantité .de -fer; '& fi en général la -coupe des Bois étoit mieux réglée , l'exploitation des Mines y
•ncqitéreroic encore plus de vigueur; MB * ’ ' 'ri':: ' 1
Cette Vue-prife d’un point élevé fur la r iv e ‘droite du torrent de Bréda, fait remarquer les eaux de
•cp rujffeau venant, après avoir formé diverfes cafcades, fe déployer en nappe autour des terraffes du
•Château de M. le Préfidcnt de Barrai ; la fuperbè plantation d’arbres appellé Barrolan , qui fait une
■ Promenade des plus agréables , & les jets d’eau & cafcades qui contribuent à l'embelliffement des jardins
* des bofquets: ce qui joint à l'afpea des montagnes indiquées au bas de l'Eftampe ■ & fur-tout celle
<oe Brame-Farine, cultivée jufqu’à fon fommet, préfente le fpeflacle le plus varié & le plus flatteur.
;N° 1-8. V u e d u fitc du F e rnean de f o je de fer cl, la gi gt cTA evard, de f i s ’trompes,
de fo n maillot, & des cafcades que forment les différentes chûtes -d’eau.
'C e fontïes eaux-du torrent de Bréda qui fervent à entretenir le feu de 'ce. fourneau, au moyen des
•machines hydrauliques qu’on appelle trompes, ver lefquelles elles font conduites par un fo t beau canal,
& a qui elles difiribuent la- quantité d’eau qu’on juge néceflaire à leur jeu , dont la furabondance produit
des cafcades & différens jets très-agréables. Ces trompes -font autant de canaux au travers defquels les
«aux s’intrâdujfent,, & fe précipitant dans Une grande cuve au fond de laquelle il y a une pierre plate
jri T large, y occafionnent par leur chute un vent, fort qui elt conduit par des tuyaux jûfqu’au fourneau.
Au-deflus de ces m a rn e s eft une fontaine chaude,, dont les eaux fe mêlant à celles de Bréda, empêchent
qu elles rie -fe gèlent dans les hivers même les plus rudes, & les entretient par ce moyen dans une
aâiyité continuelle. , .
JM. uc de LafCdjçadt SCdt t\Ionf i Tc"e r. f :
"On ferait arrêté, pour airifi dire, à chaque ;pas, en parcourant les montagnes du Dauphiné, fi l ’oit
vouloir donner fon attention à toutes les cafcades qu’on y rencontre, & qui méritent de fixer les regards
du- voyageur. ’Nous nous fommes bornés à un petit nombre, 8c nous fommes particuliérement attachés
à celles qui préfentent des objets d’udlité, telles que celles qui font partie d . = « ? lûvraifon. Nous
nyonsi-rc^lici-oi.^ -'s-i— j.........igc par t'agrément de leur fite, jOu-gui,1®
des rochers dont la 'fofo e fieu à rg,es\ ob&tvatdons cUrieufes fut le
règné-'ifûri'émî 'ri’'; s'
Le.Çh|tÿW de Tenpin j f t ^atoatauahla«xuiida»ite^ffi^M8cal' g W agréabledora
de la coiiftruaion entière du nouveau Château que M. le Marquis de Monteynard Élit bâtir en avant de
l ’ancien qu^prbba'blemefit'férajdéfiujKu^yj
O 1 M-.ïïE'S- 1 STJMÜOT S £ M è M E
1°. KiK'ÿéè^'Tvur/hts-F^y^^laji’^m'Jnc^^^t-'Mweilles 'du JDïpiphijiél) ^deJiFgffc
v ’& sJVj D aeJPçj- /ttwçS d a \latj§ssQtr'Jt. f
a°. ihîfièmfflesygfêtr Mefvetlies dtt^dupÊné'), à qutûfci
' ,-ltlUeSrSddc0uel1 ded@fcbobLéf\~
v ^ ü jS fe f s Auteurs holqb'teS<?KMaryeïlIes du Daurfuné, & fu r ÿ g x g K ^ m aes-myeft
■ phénomènes qui ont donné lieu à toutes les fables qu’on a débitées à ce fujet. Nous n’entrerons pa dans
les difeuflioris néceffaires pour parvenir à établir ce qu’on doit raifonnablement adopter ou réfuter des
différentes ( pinions qu’on en a conçu jufqu’ici. Nous réfervons ces détails pour la Defcription générale :
de cette Province , nous' bbrnànt dans ces feuilles au réfiimé de nos recherches, & à une courte Notice !
fur celles de ces Merveilles1 que nous aurons à traiter.
La Tou r, dite Sans-Venin, parce qù’on a prétendu qu il ne s’y trouvoit jamais d’animaux yen n eux ,
®t que ceux qu’on y a portés s en éloignoient aulfi-tôt, ou mouraient, eft fituéê,. comme on le v o it, fur
une éminence de rochers q û dé] end delà montagne de Saffenage, à une lieue vers l’Oueft de Grenoble;
& fur le penchant de laquell eft placé le village de Parifet, qui forme une petite P: oiffe dont l ’Eglife */U
■ M t iM ^ » c^ ^ ^ g ^ ^ ^EEour*éfcit qu«-r<.c, 6c „ aT i tW i e s * me fix 1
■ dans-l’intérieur ; il n’en reftoit-déjà plus vers le milieu dufiècle dernier, q aune muraille telle qu’on la voit
aujourd'hui. Dans le principe le vrai nom de cette Tour étoit S. Séverin, que les Habitans prononcent
San Stverin, & que par ibrëviati >n on a par la fuite prononcé San-Verin. Si l’on obferve que dans le langage
du Pày , Vérin veut dire Vlenin, on fera très-porté à croire qu’on aura pu prononcer enfùite San-Venin
& que cette corruption demots -aura donné lieu à la méprife, & l’aura foutenue contre l'évidence : car;
i l eft de fait quon a trouvé de tout tems des animaux venimeux auprès 'de cet édifice.
La Fontaine ardente ou Fontaine brûlante. Cette prétendue Fontaine eft un petit terrein aride, d’environ:
Ex pieds de long fur trois ou quatre de lar c , fur une pente affez roide, où l’on voit une flammt légère,'
gui femble errer fui la furfàce d’un rocher d’une elpèce d’ardoife. On n’y voit point de matière qui puiffe fervir
a alïmenfiala ftfiftoiê ; ^'àfiSïtfie fente éaiis lêroclhét qui puîfelmre fq'ipqônnèt qu'efiè aUroît coiïitfiunieatîon
hveçs^^Bjie . catèrne intérieure quifèA&^^ ^ A é e . On remjrque feulement que cette flamme a une odettt
fi»lpi^»Së,'^;qg.(^^^i^TOp|çÿitdecendre.^e feu, ditafin, eft plus ardent en hiver, & s’éteint même
fmiymt-'versla finidel’éeé^pour le raüuujgpenfuSte. I l faut obfervet qu’il tombe des montagnes voiGnês üd1'
f m t t A au ’ -travers du tefrdn trûlant, d’oh fera venu à ce phénomène
le nom de Fontaine ardente*
a i. Dft’c x Es Wa m p e s 4Ç e.*iô n e m êm é ï ï ü , x i . t t . .
^ Wwéhcr$de M®üe, P Ftcictcde -Rôch&maure, f e r le -Ford ■du. R h ôn e ,
en $g
û . V%e Rhône de Valence h. 'Whiô^Pétô én. Ÿivtlrcùp, '
C ês Rochers font .partie d’une montagne du Vivarais qui 'avoifine le Dauphiné. Les détails pittorefqües
qu/cfis^xt^.^Ve^ouglpjtviengagés à la placer dans, cetÉ’te^v^lfeit'y pqur faire pendant avec le Paffagè
•du R hône, dont le Delfin eft également pris aux extrémités de cette Province. Nous aurons attention de là
rappelle , 1 >rfi ue nous donnerons la. Defcription du Vivar is. NoUs entrerons alors dans l’examen néceflaire
pour faire connoître la formation de ces Rochers & des corps, étrangers qui s’y trouvent naturellement où
accidentellement incruftés.
'i N? 22. D eux E s t amp e s sue. une même f e u i l l e . ",
P remiere dm m f tè u connu & non détint L à F ig . d f
une autre efptce de F ojfile 'afjc-£ commun , SC qui paraît appartenir à la Clàffe des ErèhinitcSi
P^ëuxieme Pxanche. JMtttàr'6porïtd 'dêcbfferî
On rencontre affez fréquemment aux environs de Grenoble, de ces pierres qùe l’on appelle Daks ou Lo\es j
' ï ° nl ê ^ rtclus du Pays, & dont on fe fert CônimWméntponr clore les Champs, les Jardins & les Cimetières-.
~ es iriindu'.rs. d nii elles font tirées, font d’une nature- propre à fe déliter affez facilement, à la maniéré
,,,e? Ardoiles. O n Q u e l q u e fois affezririnces. fir trui n’orir anère» nWde_rtoi»_po„ces
d épailleur, 'fur environ lept pieds de longueur. Files ont pour la;,plupart des fbffiles de diverfes configurations '
qui leur font adhérens, tels que ceux que l’on refharque dans ces Planches. Celui que l’on a delfiné à la
^ ^ *M ^ i^ g i'^ iw ^ ^W e u x .,K 4)rdbableCTèa^ttès-rate, A ^ ;M |îerjafpea'omfefeSuté'dK'ÎK*î-!i'r!ifl^«ff»i
Etoile de mer fojjile , ainfi que l’a penfé M.! G-Uettard , qui rima fait la.découverte lors de fa tournée dans
le Dauphiné en 1775. Ma‘s lorfqu’on l’examine avec attention -, on voit que fa forme diffère beaucoup des •
Etoiles de mer décrites par les Conchyologiftes, qui n’ont fait aucune mention d’un coquillage de cette
configuration, dont les rayons foiênt liés en patte d’o ye, ayant des élévations dorfales qui rè'gn'ent -dàflï
eÿ:ècês-,d’aEriGulationsq;aj:nfi1^ ^ 4 .tâ:cl^'aeï’eΣprimèt dàiih
le D«ffi»?Il%PppbaDl^qj^PMPMlMt des fomllës d a^céa^bçh^mjujfe délitent, onà tiré'ces
L o zes , on. découvrirent une quantité de cette efpèce de foflile qui mériterait -d’être conflaté. Ce foflile s’ÿ
_ Ô^ïV® of# 1|-Fig. ÇTj1
iÆetteautrèregpèée,'beàfiGoupjp™^Mffln^L~1jont
de même. Cependant on n’eft pas encore parvenu à lacaradlérifer d’une manière pofitive : plufieursNaturhhftei
-la prennent P ^ ^ ^ f e ^ M y ^ ^ » 4V t fe s .^ q iu jjn® f^ ^ p ^ â |^ ^ ê )|è^ ^ ï|^ p |9t;^^ÿîïfttapphtetnmeoi
W W S W S Ç autres > 8e fp ttouyent prefljnè, toujùufi
Maîltépates,foÆlfeii();Btti-femt'é*&teia iàrement avee.deç:fîgurèi
étant Me -filÜ; mêlés fie M^^MMay^j^fiafriles dôntnûüe venons dfe parler if de,'forte'
, quçg^iffit&êl^èeaijg phénomène de IeUr voir des racâftcatiocs aUflt’ entièr^Bu» celiet 'mi’nflre le M/idràimri*
Ma lejmrifâit le fujet d e i 6 eo ^ & Ë fk® & j& .d an s lequel on h’appercoic âliéM de*
folfiles de l’autre efpèce*
N s 2 3 . P l U S I E R S P fi À N C H E S S U R U N E M Ê M E F E U I L É E*
i°. WËffik gultéit du, @hmeüère.
C e t ombeaü eftplacé horifontalement au milieu du Cimetière des Côtes, aU pied d’Uri gros tilleul où il
lertg c lq fe ic . mijr.éje n r e le Figure ^ M 'ièreuxidfeyla pip.rtu*.dnnr. U
longueur qui ne paraît que dé cinq pieds fix rïgn^jfëft.téellernerit ,&c demi, parce
qu’il y a intérieurement une concavité deftinée à recevoir le haut de la tête-, La figure 3 repréfente la partie
fiipérieurede ce Tombeau, qui paraît être la bafe de quelque figure fymbolique ou du bulle du mort qui
s’en fera déc iché. On ignore coma ent t e Toml a 1 fe trouve dans ce Cimetière, 8c où i!avoir pu être placé
anciennement. On ne peut ajouter foi à la tradition du Pays, qui rapporte que cette pierre fut taillée
autrefois pour fervir de niche à une Statue de la Vierge, Patronne de cette Paroiffe. D’ailleurs les lettres
romaines D. M. abréviation de JDiis Manïb s , annonce clairement que c’eft une fépulture Païenne, On ne
trouve fur ce tombeau aucune autre Infcription,