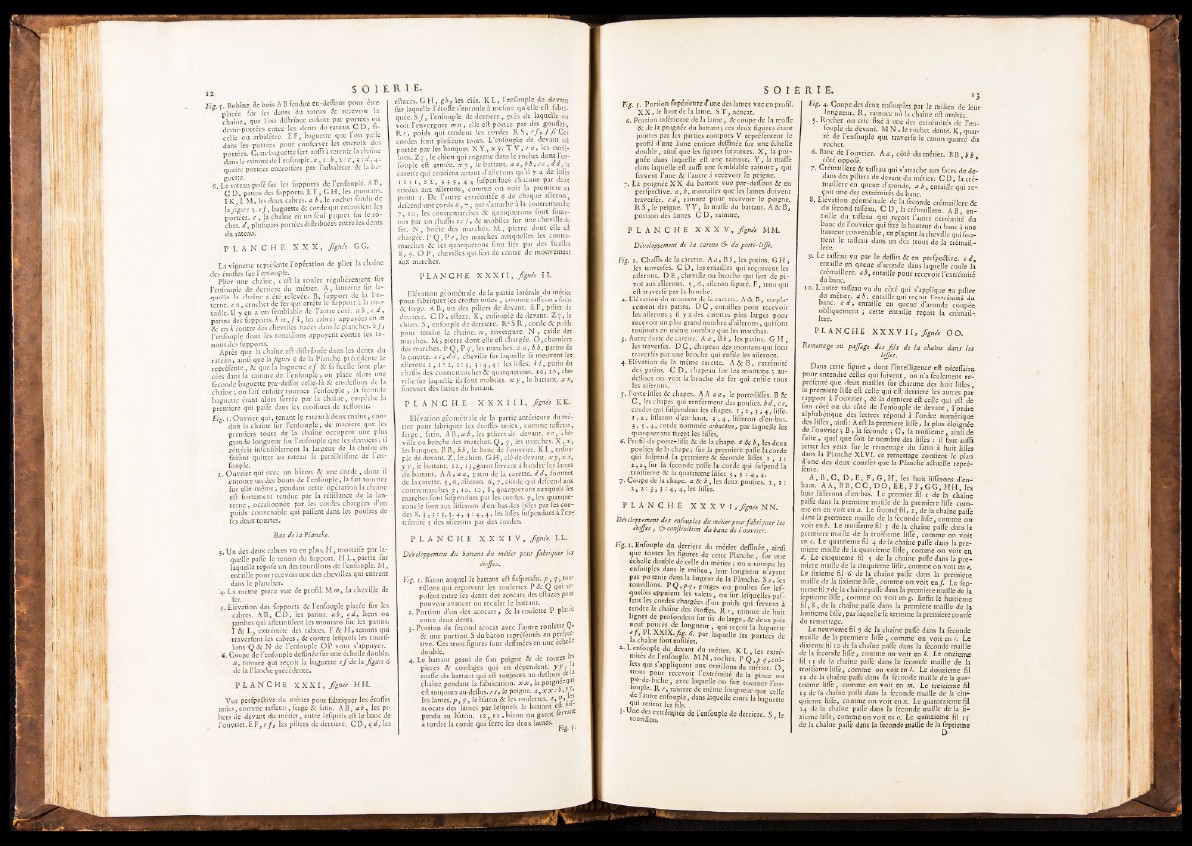
B g c Bobine de "bois A B fendue en-deffous pour être
placée fur les dents du rateau & recevoir la
chaîne, que l’on diftribue enfuite par portées ou
demi-portées entre les dents du rateau.C D . ficelle
ou arbalêtre. E F , baguette que l’on parte
dans les portées pour confervér les encroix des
portées. Cettebaguette fert auffi à retenir la chaîne
dans la rainure de renfouple. a y i : b , x : c 9 3 : <1, 4 :
quatre portées encroifées par l’arbalêtre & la ba-.
■6. Le rateau pofé fur les fupports de l'enfoupîe. A B ,
C D , patins des fupports. E F , G H , les montans.
I K , L M , les deux cabres, a b, le rochet fendu de
\a figure f . e ƒ , baguette & corde qui encroifent les
portées, c , la chaîne en un feul paquet fur le rochet.
d , plufieurs portées diftribuées entre les dents
du rateau.
P L A N C H E X X X , fignèe G G.
La vignette repréfente l’opération de plier la chaîne
des étoffes fur l’enfouple. , , , r
Plier une chaîne, c'eft la rouler régulièrement fur
l’enfouple de derrière du metier. A , lanterne fur laquelle
la chaîne a été relevée. B, fupport de la lanterne.
£ n , crochet de fer qui arrête le fupport à la muraille.
11 y en a un femblable de l’autre côté, a b ,c d ,
patins des fupports. h mi f k i les cabres appuyées en m
Sc enk contre des chevilles fixées dans le plancher, h j ,
l’ enfoupîe dont les tourillons appuyent contre les tenons
des fupports.
Après que la chaîne eft diftribuee dans les dents du
rateau, ainfi que la figure 6 de la Planche précédente le
repréfente , & que la baguette e ƒ & fa ficelle font placées
dans la rainure de l’enfouple, on place alors une
fécondé baguette par-dertiis celle-là & en-dertous de la
chaîne; on fait enfuite tourner l’enfouple , la fécondé
baguette étant alors ferrée par la chaîne, empêche la
première qui pafle dans les croifures de reflortir.
Fig. 1. Ouvrier qui, tenant le rateau à deux mains, conduit
la chaîne fur l’enfouple, de maniéré que les
premiers tours de la chaîne occupent une plus
grande longueur fur l’enfoupîe que les derniers; il
rétrécit infenfiblemenc la largeur de la chaîne en
faifànt quitter au rateau le parallélifme de l’en-
1 M , * I j , ..
1 . Ouvrier qui avec un bâton & une corde, dont il
entoure un des bouts de l’enfoupîe, la fait tourner
fur elle-même; pendant c.ette opération la chaîne
eft fortement tendue par la réfiftance de la lanterne
, occafionnée par les cordes chargées d’un
poids convenable qui paffent dans les poulies de
fes deux tourtes.
eftazes. G H , g h, les clcs. K L , l’ enfoupîe de devant
fur laquelle l’étoffe s’enroule à mefure qu’elle eft fabriquée.
S ƒ y l’enfouple de derrière, près de laquelle on
voit l’envergure m n , elle eft portée par des gouflets.
R r , poids qui tendent les cordes R S , r f , f f i Ces
cordes font plufieurs tours. L’enfouple de devant eft
portée par les banques X Y , x y . T V , t u » les oreillons.
Z i y le chien qui engrene dans le rochet dont l’enfouple
eft armée, x y y le battant. a a ,b b , cc, dd, la
carette qui contient autant d’aîlerons qu’il y a de lifïes
1 1 i 1 , 1 z , 3 5 3 , 4 4 fufpendues chacune par deux
cordes aux aîlerons, comme on voit la première au
point f. De l’autre extrémitée 6 de chaque aileron,
defeend une corde 6 , 7 , qui s’attache a la contremarche
7 , 10 , les contremarches & quarquerons font foute-
nus par un chaffis r i / , & mobiles fur une cheville de
fer. N , boete des marches. M , pierre dont elle eft
chargée. P Q, P 7 , les marches auxquelles les contremarches
& les quarquerons font liés par des ficelles
8,9. O P , chevilles qui fert de centre de mouvemenc
aux marches.
P L A N C H E X X X I I , fignèe 11.
Elévation géométrale de la partie latérale du métier
pour fabriquer les étoffes unies , comme taffetas, fatin
& ferge. A B , un des piliers de devant. E F , pilier de
derrière. C D , eftaze. K , enfouple de devant. Z { , le
chien. S , enfouple de derrière. R aS R , corde & poids
pour tendre la chaîne, n , envergure. N , caiffè des
marches. M , pierre dont elle eft chargée. O,charnière
des marches. P Q, P 7 , les marches, a a y b b y patins de
la carette. cc, d d , cheville fur laquelle le meuvent les
aîlerons i , i t z , 1 : 3 , 3 ; 4, 4 • les liffes. k l , patin du
chaffis des contremarches & quarquerons.-1 0 , 1 0 , cheville
fur laquelle ils font mobiles, x y , le battant. sçxt
fommet des lames du battant.
P L A N C R E X X X I I I , figne'e KK.
Elévation géométrale de la partie antérieure du métier
pour fabriquer les étoffes unies , comme taffetas,
ferge, fatin. A B , a b , les piliers de devant. 00, cheville
ou broche des marches. Q , 7 , les marches. X , x y
les banques. B B , b b t le banc de l’ouvrier. K L , enlou?
pie de devant. Z , le chien. G H , clé de devant. x y ,x x ,
y y , le battant, iz , 1 3 , garot férvant à bander les lames
du battant. A A , a a , patin de la carette. d d t fommec
de la carette. f , 6 , aîleron. 6, 7 , corde qui defeend aux
contremarches 7 , 10. 10 , 8, quarquerons auxquels les
marches font fufpendues par les cordes. 9, les quarquerons
le font aux lifferons d’en-bas des lifïes par les cordes
8. 3 , 3 : 3 , 3 . 4 , 4: 4 , 4 , les liftes fufpendues à l’extrémité
ç des aîlerons par des cordes.
Bas de la Blanche.
3 . Un des deux cabres vu en plan. H , mortaife par laquelle
paffe le tenon du fupport. H L , partie fur
laquelle repofe un des tourillons de l’enfouple. M ,
entaille pour recevoir une des chevilles qui entrent
dans le plancher.
4. La même piece vue de profil. M « , la cheville de
fer. I I
ç. Elévation des fupports & l’enfouple placée fur les
cabres. A B , C D , les patins, a b , c d 9 liens ou
jambes qui affermiffènt les montans fur les patins.
I & L , extrémité des cabres. F & H , tenons qui
traverfent les cabres, & contre lefquels les tourillons
Q & N de l’ enfoupîe O P vont s’appuyer.
6. Coupe de l’enfouple deffinée fur une échelle double.
a , rainure qui reçoit la baguette e f de la figure 6
de la Planche précédente.
P L A N C H E X X X I , fignèe HH.
Vue perfpeétive du métier pour fabriquer les étoffes
unies, comme taffetas, ferge & fatin. A B , ab y les piliers
de devant du métier, entre lefquels eft le banc de
l’ouvrier. E F , e ƒ , les piliers de derrière. C D , c d y les
P L A N C H E X X X I V , fignèe LL.'
Développement du battant du métier pour fabriquer les
étoffes.
Fig. 1. Bâton auquel le battant eft fufpendu. />, ^, tourillons
qui reçoivent les roulettes P & Q qui re-
pofènt entre les dents des acocats. des eftazes pour
pouvoir avancer ou reculer le battant. ,
z. Portion d’un des acocats, & la roulette P placée
entre deux dents.
3. Portion du fécond acocat avec l’autre roulette Q»
& une portion S du bâton repréfentés en perfpec*
tive. Ces trois figures font deffinées en une échelle
double. . .
4. Le battant garni de fon peigne & de toutes 1ÇS
pièces & cordages qui en dépendent, y y .> a
maffe du battant qui eft toujours au-deffous de a
chaîne pendant la fabrication. x x t lapoigneequ
eft toujours au-deflus. r s , le peigne, a tx x •* b ,X/»
les lames, p, 7 , le bâton & les roulettes, t, e.
acocats des lames par lefquels le battant eft 11
pendu au bâton, iz , 13 * bâton ou garot ferva
à tordre la corde qui ferre les deux lames.
Fig. f. Portion ffipcrretire d’une des lames vue en profil.
X X , le haut de la lame. S T , acocat.
6. Portion inférieure de la lame, & coupe de la maffè
& de la poignée du battant ; ces deux figures étant
jointes par les parties rompues V repréféntent le
profil d’une lame entière deffinée fur une échelle
double, ainfi que les figures fuivantes. X , la poignée
dans laquelle eft une rainure. Y , la maffe
dans laquelle eft auffi une femblable rainure, qui
fervent l’une & l’autre à recevoir le peigne.
7. La poignée X X du battant vue par-deffous & en
perfpeétive. a , b y mortaifès que les lames doivent
traverfèr. cdy rainure pour recevoir le peigne. 1< S , le peigne. Y Y , la mafTe du battant. À & B ,
portion des lames. C D , rainure.
P L A N C H E X X X V , fignèe MM.
Développement de la carette & du porte-liffe.
Fig. 1. Chaffis de la carette., A a t B b, les patins. G H ;
les traverfes. C D , les entailles qui reçoivent les
ailerons. D E , cheville Ou broche qui fert de pivot
aux aîlerons. f , 6 , aileron feparé. F , trou qui
eft traverfé par la broche.
2. Elévation du montant de la carette. A & B , emplàr
cernent des patins. D C , entailles pour recevoir
les ailerons ; il y a des carettes plus larges pour
recevoir un plus grand nombre d’ailerons, qui font
toujours en même nombre que les marches'.
3. Autre forte de carette. A a , B b , les patins. G H ,
les traverfes. D C , chapeau des montans qui font
traverfes par une broche qui enfile les ailerons.
4 . Elévation de la même carette. A & B , extrémité
des patins. C D , chapeau fur les montans ; au-
deflpus on voit la broche de fer qui enfile tous
les aîlerons.
j . Porte-liffés & chapes. AA a a t le porte-lifTes. B &
C , les chapes qui renferment des poulies. b d y cef
cordes qui fufpendent les chapes. 1 , z , 5 , 4 , lifte.
i , z , lifferon d’en-haut. 3 , 4 , liflêron d’en-bas.
3 , f , 4, corde nommée arbalêtre, par laquelle les
quarquerons iirent les liftes.
6. Profil du porte-liflè & de la chape, a 8c b, les deux
poulies de la chape; furla première paffe la Corde
qui fufpend la première & fécondé liftes 1 , 1 :
z , z , fur la fécondé paffe la corde qt^ti fufpend la
troifieme & la quatrième liftes 3 , 3 : 4 ,4 .
7. Coupe de la chape, a & b , les deux poulies. 1 , 1 :
2 > 2 : 3 » 3: 4> 4» les liflès.
P L A N C H E X X X V I , fgne’e N N.
’Développement des enjouples du métier pour fabriquer les
étoffes y conjlruàion du banc de Vouvrier.
Fig. 1 . Enfouple du derrière du métier deffinée, ainfi
que toutes les figures de cette Planche, fur une
echelle double de celle du métier ; On a rompu les
enfouples dans le milieu, leur longueur n’ayant
pas pu tenir dans la largeur de la Planche. S s , les
tourillons. VQ tp q , gorges ou poulies fur lef-
quel es appuient les valets, ou fur lefquelles paffent
les cordes chargées d’un poids qui fervent à
tendre la chaîne des étoffes. R r , rainure de huit
lignes de profondeur fur fix de large, & deux piés
qui reçoit la baguette
e ƒ, PI. XXIX. f e 6. par laquelle les portées de
la chaîne font enfilées.
a. L’enfouple du_ devant du métier. K L , les extrémités
de 1 enfouple. M N , rochet. P Q ,p ,7,collets
qui s appliquent aux oreillons du métier. O
trous pour recevoir l’extrémité de la pince ou
pie-de-biche, avec laquelle on fait tourner I’cn-
îouple. R r , rainure de même longueur que celle
de 1 autre enfouple, dans laquelle entre la baeuette
qui retient les fils. 3* Une des extrémités de i’enfouple de derrière. S le
tourillon. •* •
Fig. 4. Coupe iles deux énfouplcs par le iMieu de leur
longueur. R , rainure oi\ la chaîne eft arrêtée.
y. Rochet ou Cric fixé à une des extrémités de l’en-
fouple de devant. M N , le rochet denté. K , quarte
de .l’enfouple qui traverfe le canon quarré du
rochet.
6. Banc de l’ouvrier. A a , côté du métier. B B b b
cote oppofe.
7. Cremaillere & taffeait qui s’attache aux faces de dedans
des piliers de devant du métier.' C D , la crémaillère
en queue d aronde. a b , entaille qui reçoit
une des extréfnités du banc.
8. Elévation géométrale J e h fecpnde crémaillère &
du lecôrid talleau, C D , la crémaillère. A B , entaille
dm tafleau qui reçoit 1 autre extrémité du
banc de I ouvrier qui fixe la hauteur du banc à une
hauteur cStl Vènàble, en plaçant là cheville quïfpuÿ
tient le tafiéau dans utt des trous de la ctémail-<
lere.
î>. Le tafFeau vil par le deffils & en perfpecîive. c i ,
entaille eh queue d’aronde dans laquelle coule la
ciemaillere. ab, entaille pour recevoir l'extrémité
du banc.
lo. L autre taflèau vu du côté qui s’applique au pilier
dit metier. a b, entaille qui reçoit l’extrémité du
banc, c d y entaille en queue d’aronde coupée
obliquement ; cette entaille reçoit la crémaillère.
P L A N C H E X X X V I I , fignèe O O.
Remettage ou paffage des f ils de la chaîne dans IsS
liffes.
Dans cette figure , dont l’intelligence eft néceflàire,
pour entendre celles quffuivent, on n’a feulement re-
préfenté que deux mailles fur chacune des huit liftes ,
la première lifte eft celle qui eft derrière les autres par
rapport à l’ouvrier, & la derniere eft celle qui eft de
fon cote ou du côté de l’enfôuple de devant, l’ordre
alphabétique des lettres répond à l’ordre numérique
des liftés, ainfi : A eft la première lifte, la plus éloignée
de l’ouvrier ; B , la fécondé ; C , la troifieme, ainfi de
fuite, quel que foit le nombre des liftes : il faut auffi
jetter les yeux fur le remettage du fatin à huit liffes
dans la Planche XLVI. ce remettage contient le plan
d une des deux courfes que la Planche aétuelle repré-
fente.
A , B , C , D , E , F , Ç , H , les ’ huit lifterons d’en-
haut. A A , B B , C C , D D , E E , F F , G G , H H , les
huit,lifterons d’en-bas. Le premier fil i de la chaîne
paffe dans la première maille de la première lifte comme
on en voit en a. Le fécond fil, i , de la chaîne paffe
dans la première maille de la fécondé lifte, comme on
voit en b. Le troifieme fil 3 delà chaîne paffe dans la
première maille de la troifieme lifte, comme on voie
en c. Le quatrième fil 4 de la chaîne paffe dans la première
maille de la quatrième lifte, comme on voit en
d. Le cinquième fil y de la chaîne paffe dans la première
maille de la cinquième lifte, comme on voit én e.
Le fixieme fil <> de la chaîne paffe dans la première
maille de la fixieme lifte, comme on voit en f . Le fep-
tieme fil 7 de la chaîne paffe dans la première maille de la
feptieme lifte, comme'on voit en g. Enfin le huitième
fil, 8 , de la chaîne paffe dans la première maille de la
huitième lifte, par laquelle fe termine la première courfe
du remettage.
Le neuvième fil 9 de la chaîne paffe dans la féconde
maille de la première lifté , comme on voit en i. Le
dixième fil 10 de la chaîne pâfle dans la féconde maille
de la fécondé lifte, comme on voit en k. Le onzième
fil 1 1 de la chaîne paffe dans la féconde maille de la
troifieme lifté, comme orivorten/. Le douzième fil
1 z de la chaîne paffe dans la féconde maille de la quatrième
lifté, comme on voit en m. Le treizième fil
13 de (a chaîne paffe dans la féconde maille de la cinquième
lifté, comme on voit en n. Le quatorzième fil
14 de la chaîne pafle dans la féconde maille de la fi-
xîeme lifté,' comme on voit en 0. Le quinzième fil iç
de la chaîne paffe dans la fécondé maille de la feptieme
r»