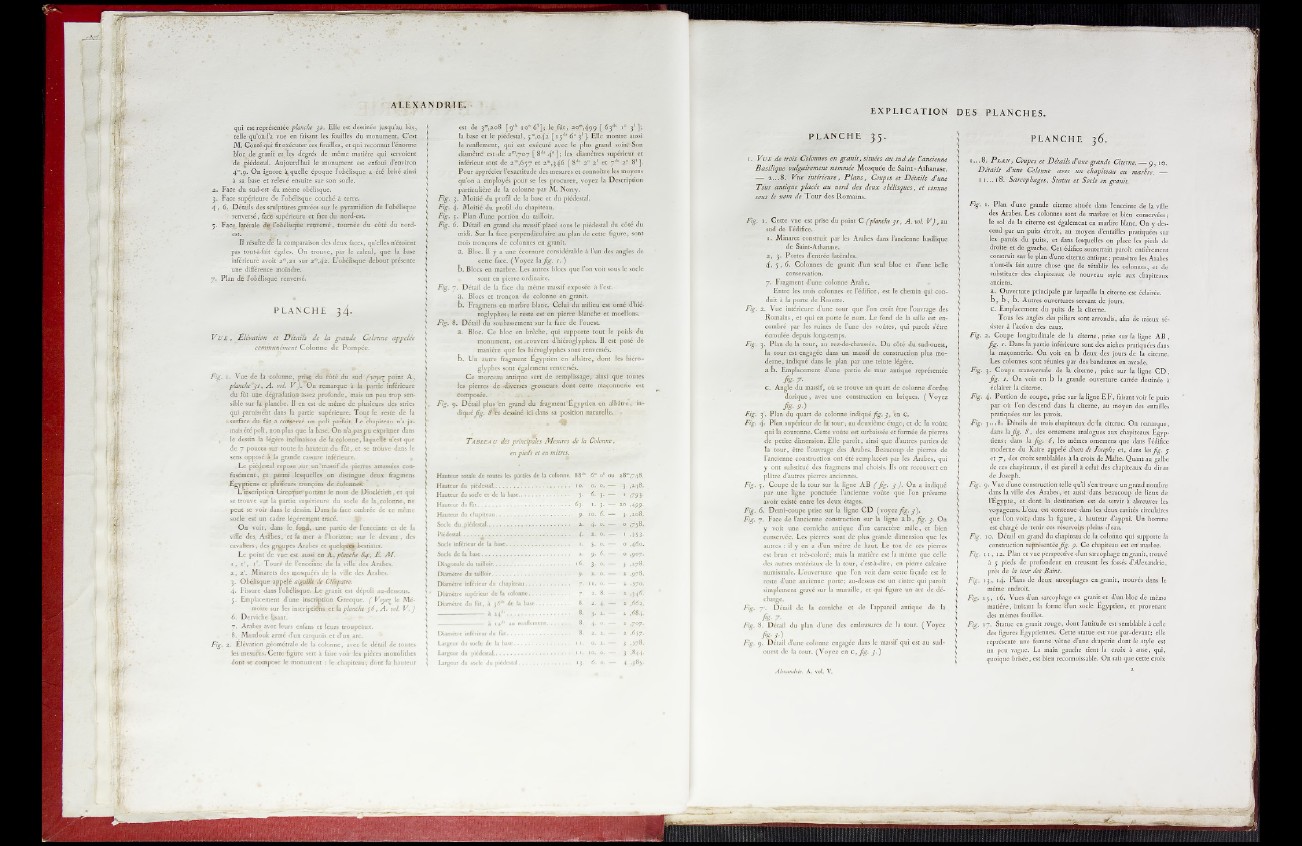
'H !
A L E X A N D R I E .
■1 ;
#
qui est représentée planche J2. Elie est dessinée jusqu’au bas.,
telle-qu’onJ’a vuè en faisant les fouilles du monument. C ’est
M. Conté qui fit exécuter ces. fouilles, et qui reconnut l’énorme
bloc ,de granit et, les degrés de même matière qui servoient
de .piédestal. Aujourd’hui le monument est enfoui d’environ
4 “ ,9. On ignore à quelle époque Fobélisque a été brisé ainsi
à sa base et relevé ensuite sur son socle. .
2. Face du sud-est du même obélisque.
3. Face supérieure de Fobélisque couché à terre.
4 . 6, -Détails des sculptures gravées sur le pyramidion de Fobélisque
renversé, facE'supérieure et face du nord-est.
5. Face. latérale ded’obélisqüe renversé, tournée du côté du nordest
:
If résulte de la comparaison des deux faces, qu’elles n’étoient
pas tout-à-fait égales.. On trouve, par le calcul, que la base
inférieure avoit 2“ ,21 sur 2m,42. L ’obélisque debout présente
une différence moindre.
7. Plan dê Fobélisque renversé.
P L A N C H E 3 4 -
V u e , Elévation et Détails de la grande Colonne appelée
communément Colonne de Pompée.
Fig. 1. Vue de la -colonne, prise du-côté du sud (voye7 point A ,
planche 3 1 , A . vol. V ) . On remarque à la partie inférieure
du fut uçe. dégradation àssez profonde, mais un peu trop sensible
sur la planche. 11 en est de même de plusieurs des stries
qui paroissènt dans la partie supérieure. Tout le resté de la
. surface du- fût a conservé un poli parfait. Le chapiteau n’a jamais
été poli, non plus que la base. On n’a pas pu exprimer dans
, le dessin la légère inclinaison de la colonne, laquelle n’est que
de 7 pouces sur toute la hauteur du fût,, et se trouve-dans le
sens opposéià la grande cassure inférieure.
. L e piédestal repose .sur un'massif.de pierres amassées confusément,
et parmi lesquelles on distingue deux fragmens
■Égyptiens et plusieurs tronçons de colonnes.
L’inscription Grecque'portant le nom de Dioclétien, et qui
se trouve sur la partie supérieure du socle de la .colonne, ne
. - peut se voir dans le dessin. Dans la-face ombrée de ce même
sodé est un cadre légèrement tracé. Jfp.
On voit-, dans le fond, une partie d e Fencejnte et de la
ville des Arabes, et la mer à- l’horizon; sur le devant, des
cavaliers, des groupes Arabes et quelque*, bestiaux.
L e point de vue est aussi en A , planche 8*f-, E. M .
i ,; i ' , 1". Tour# de l’enceinte de la ville des Arabes.
2 , 2'. Minarets des njosquées de la ville des Arabes. -
3. Obélisque appelé aiguille de Cléopatre.
4 • Fissure dans Fobélisque. Le granit est dépoli au-dessous.
• 5. Emplacement d’une inscription. Grecque. (V o y e i le Mémoire
sur les inscriptÎOTS et la planche 5 6 , A . vol. V. )
6. Derviche Ijsant.
7. Arabes avec leurs enfans et leurs troupeaux.
8. MamJouk armé d’un carquois.et d’un arc.
Fig. 2. Elévation géométrale de la. colonne, avec le détail de toutes
les mesurés. Cette figure sert à faire voir les pièces monolithes
dont se composé le monument : le .chapiteau’, dont la hauteur
est de 3” ,208 [9^ io ° 6 '] ; le ,fû t, 20™,499 [ é j ds i° 31];
la base et le piédestal, ym,o42 [ 1 5 * é° 31]. Elle montre aussi
le renflement, qui est exécuté avec le plus grand soins? Son
diamètre' est de 2m,707 [ 8ds 4° ] ; les. diamètres supérieur et
inférieur sont de 2’",65 7 et 2m,346 [8 ds 20 21 et 7 * 2? ’81].
Pour apprécier l’exactitude des mesures et connoître les moyens
qü’on a employés pour se les procurer, voyez la Description
particulière de la colonne par M. Norry.
Fig. 3. Moitié du profil de la base et du piédestal.
Fig. 4. Moitié du profil du chapiteau.
Fig. 5. Plan d’une portion du tailloir.
Fig. 6. Détail en grand du massif placé sous le piédestal du côté du
midi. Sur la face perpendiculaire au plan de cette figure, sont
trois tronçons de colonnes en granit.
a. Bloc. Il y a une écomure considérable à l’un des angles de
cette face. (Vo y e z la fig. 1. )
b . Blocs en marbre. Les autres blocs que l’on voit sous le socle
sont en pierre ordinaire.
Fig. 7. Détail de la face du même massif exposée à l’est.
a. Blocs et tronçon de colonne en granit.
b . Fragmens en marbre blanc. Celui du milieu est orné d’hiéroglyphes
; le reste est en pierre blanche et moellons.
Fig. 8. Détail du soubassement sur la face de l’ouest.
a. Bloc. C e bloc en brèche, qui supporte tout le poids du
monument, est,couvert d’hiéroglyphes. Il est posé de
manière que les hiéroglyphes sont renversés.
b . Un autre fragment Égyptien en albâtre, dont les hiéroglyphes
sont également renversés.
C e morceau antique sert de remplissage, ainsi que toutes
les pierres de -diverses grosseurs dont cette maçonnerie est
composée. " - jtfjg *. -
Fig. 9. Détail plus en grand du fragment'Egyptien en albâtre, indiqué/^.
8 e t dessiné ici dans sa position naturelle. ■
T a b l e a u des principales Mesures de la Colonne,
en pieds et en mètres.
Hauteur totale de toutes les parties de la colonne.
Hauteur du piédestal.......................................
Hauteur du sodé et de la base...................................
Hauteur du fû t...............................................................
Hauteur du chapiteau...................................................
Socle du.piédestal...................... ..
Piédestal ..........................................................
Socle inférieur de la b a s e . ..............................
Socle de la base .................................
Diagonale du tailloir. ......................................
Diamètre du tailloir.....................................................
Diamètre inférieur du chapiteau.. . . . . . . . . . . .
Diamètre supérieur de la colonne............................
Diamètre du lut, à 36" de la base.......................
Diamètre inférieur du fu t...........................................
Urgeu
socle de la
base.
Largcu
piédestal..
du socle du piédei
88d* 6° o1 ou a8m,748.
10; -~à:S0. — 3 ,*48.
5- 6. 3. !§ f i >79}'
¿ 3- 3. — arò >4? *
9- 10. 6. - 3 ,ao8.
2. M 0. — .0 ,758.
4* a. 0. — i >353-
». n 0. — 0 ,460.
a. 9- 6. — 0 ,907.
16. 3- 0. — 5 ,*78.
9- a- 0. — a ,978.
P11. 0. — a ,570.
7. a. 8. — a ,34*.
8. a. 4. — a ,661.
8. 3- 8 — a ¿84.
8. 4- 0. — a ,707.
8. a. a. — a ¿ 57.
11. 0. a. — 3 ,178.
11. 10. 0. — 3 .844.
' 3- 6. 0. — 4 .385-
E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S .
m
P L A N C H E 3 5 .
1. V u e de trois Colonnes en granit, situées au sud de l ’ancieniie
Basilique vulgairement nommée Mosquée de Saint-Athanase.
— 2 ...8 . Vue intérieure, P la n s , Coupes et Dé tails d ’une
Tour antique placée au nord des deux obélisques, e t connue
sous le nom de T o u r des Romains.
'g. 1. Cette vue est prise du point C (planche y / , A . vol. V ) , au
sud de 1 édifice.
1. Minaret construit par les Arabes dans l’ancienne basilique
de Saint-Athanase.
2 , 3. Portes d’entrée latérales.
4 , 5 , 6. Colonnes de granit d’un seul bloc et d’une belle
conservation.
Fragment d’une colonne Arabe.
Entre les trois colonnes et l’édifice, est le chemin qui conduit
à la porte de Rosette,
f. 2. Vue intérieure d’une tour que l’on croit être l’ouvrage des
Romains, et qui en porte le nom. Le fond de la salle est encombré
par les ruines de l’une des voûtes, qui paroît s’être
écroulée depuis long-temps.
3. Plan de la tour, au rez-de-chaussée. D u côté du sud-ouest,
la tour est engagée dans un massif de construction plus moderne,
indiqué dans le plan par une teinte légère,
a b . Emplacement d’une partie de mur antique représentée
fig- 7-
C. Angle du massif, où se trouve un quart de colonne d’ordre
dorique, avec une construction en briques. ( Voyez
fig- p-)
3'. Plan du quart d e colonne i n d i q u é y , en C.
'. 4 ’ Plan supérieur de la tour, au deuxième étage, et de la voûte
qui la couronne. Cette voûte est surbaissée et formée de pierres
de petite dimension. Elle paroît, ainsi que d’autres parties de
la tour, être l’ouvrage des Arabes. Beaucoup de pierres de
l’ancienne construction ont été remplacées par les Arabes, qui
y ont substitué des fragmens mal choisis. Ils ont recouvert en
plâtre d’autres pierres anciennes.
-. 5. Coupe de la tour sur la ligne A B ( fig. j J. On a indiqué
par une ligne ponctuée l’ancienne voûte que l’on présume
avoir existé entre les deux étages.
-. 6. Demi-coupe prise sur la ligne C D ( voyez fig. j ) .
. 7. Face de l’ancienne construction sur la ligne a b , j . On
y voit une corniche antique d’un caractère mâle, et bien
conservée. Les pierres sont de plus grande dimension que les
autres : il y en a d’un mètre de haut. Le ton de ces pierres
est brun et très-coloré; mais la matière est la même que celle
des autres matériaux de la tour, c’est-à-dire, en pierre calcaire
numismale. L ’ouverture que l’on voit dans cette façade est le
reste d’une ancienne porte; au-dessus est un cintre qui paroît
simplement gravé sur la muraille, et qui figure un arc de décharge.
. 7'. Détail de la corniche et de l’appareil antique de la
fig- 7-
, 8. Détail du plan d’une des embrasures de la tour. ( Voyez
fig-}-) .
. 9. Détail d’une colonne engagée dans le massif qui est au sud-
P L A N C H E 3 6 .
ouest de la tour. (Voye z en C, fig. J . )
1 ... 8. P LAN,. Coupes, et Détails d ’une-grande Citerne. - 9 ,
D é tails d ’une Colonne avec un; chapiteau en marbre.
1 i . . . 18. Sarcophages, Statue et'Socle en granit.
PLn d’une grande citerne située dans l’enceinte de la ville
des Arabes. Les colonnes sont de marbre et bien conservées;
le sol de la citerne est également en marbre blanc. On y descend
par un puits étroit,- au moyen d’entâîlies pratiquées sur
les parois du puits , et, dans lesquelles on place les pieds de
droite et de gauche. Ce t édifice souterrain paroît entièrement
construit sur le plan d-une citerne antique; peut-être les Arabes
n’ont-ils fait autre chose que de rétablir les colonnes, et de
substituer des chapiteaux de nouveau style aux chapiteaux
anciens.
a. Ouverture principale.par laquelle la citerne est éclairée.
b , b , b . Autres ouvertures servant de jours.
C. Emplacement du puits de la citerne.
Tous les angles des piliers sont arrondis', afin de mieux résister
à Faction des eaux.
Fig. 2. Coupe longitudinale de la citerne, prise sur la ligne A B ,
fig. 1. Dans la partie inférieure .sont des niches pratiquées dans
la maçonnerie. .On voit en b. deux des jours de la citerne.
Les colonnes sont réunies par des bandeaux en arcade.
Fig. 3. Coupe transversale de la citerne, prise sur :1a ligne C D ,
fig. J. On voit en b la grande .ouverture carrée destinée àî
éclairer la citerne.
Fig. 4- Portion de coupe, prise sur la ligne E F , faisant voir le puits
par .où l’on descend dans la citerne, au moyen des entailles
pratiquées sur les parois.
Fig. 5 ...8 . Détails de trois chapiteaux de la citerne. On remarque,
dans la fig. 8 , des ornemens analogues aux chapiteaux Égyptiens;
dans la fig. 6, les mêmes ornemens que dans l’édifice
moderne du Kaire appelé divan de Joseph; et, dans les fig. j
et y , des croix semblables à la croix de Malte. Quant au galbe
de ces chapiteaux, if est pareil à celui des chapiteaux du divan
de Joseph.
Fig. 9. Vue d’ une construction telle qu’il s’en “trouve un grand nombre
I dans la ville des Arabes, et aussi dans beaucoup de lieux de
l’Egypte , et dont-la destination est-de servir à abreuver les
! voyageurs. L ’eau est contenue dans les; deux cavités circulaires
que l’on voit,- dans la figure, à hauteur d’appui. Un homme
est chargé de tenir ces réservoir-pleins d’eau.
| Fig. 10. Détail en grand du chapiteau de.la colonne qui supporte la
j construction représentée fig. p. Ce chapiteau est et? marbre.
1 Fig. 1 1 , 12. Plan et vue perspective d’un sarcophage en granit, trouvé
j à y pieds de profondeur, en creusant les fossés d’Alexandrie,
j près de la tour des Bains.
J Fig. 13., i 4. Plans de 'd eu x.sarcophages en.granit, trouvés dans le
( même endroit.
J Fig. 15 , 16. Vues d’un sarcophage en granit et d’un bloc de même
matière, imitant la forme il’un socle Egyptien, et provenant
1 des mêmes fouilles.
; Fio\ 17. Statue en granit rouge, dont l’attitude est semblable à celle
I des figures Égyptiennes. Cette statue est.vue par-devant; elle
} représente une femme, vêtue d’une .draperie dont le style est
| un peu vague. La main gauche tient la croix à anste , qui,
| quoique brisée, est bien reconnoissable. On sait, que cette croix
Alexandrie. A. vol. V.