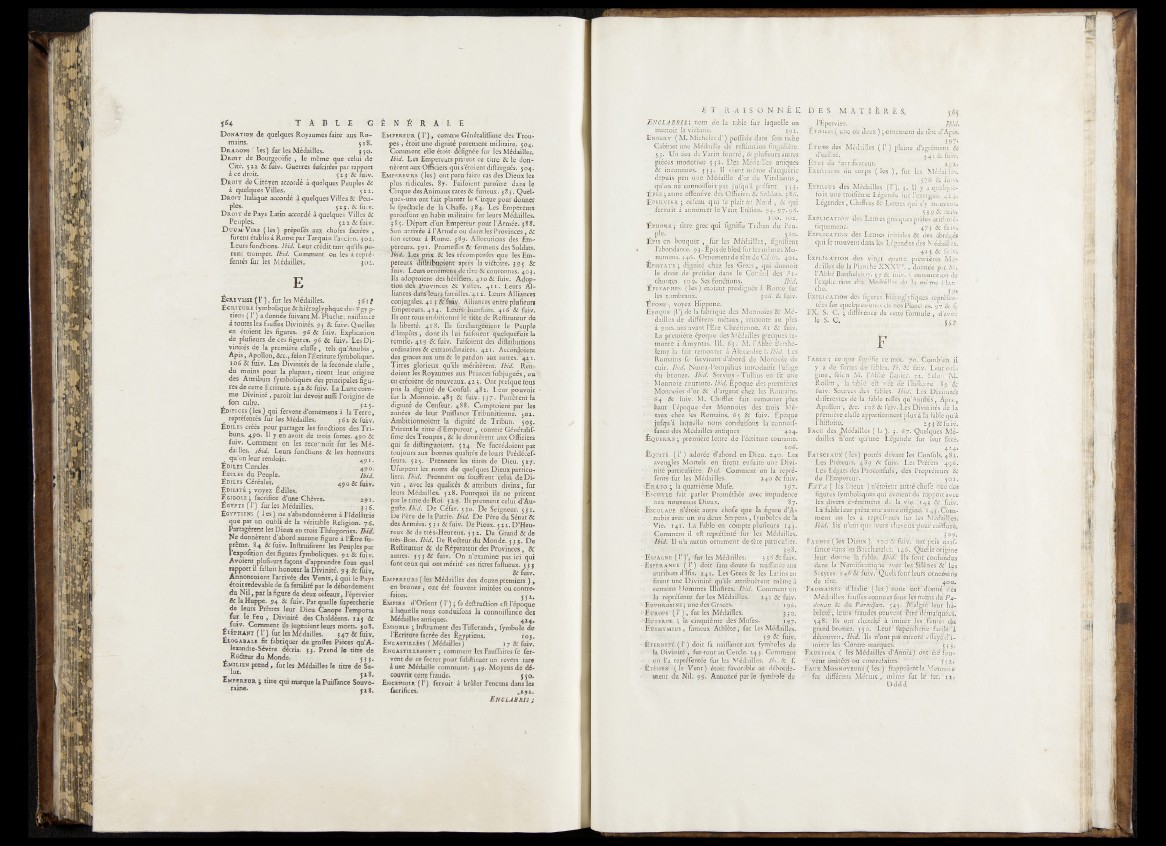
D o nation d e quelques Royaumes faite aux Romains.
518.
Dragons ( les) fur les Médailles. 550.
D r o it de Bourgeoise , le même que celui de
Cité. 521 8c jfuiv. Guerres fufcitées par rapport
a ce droit. 5 1 $ 8c fuiv.
D r o it de Citoyen accordé à quelques Peuples &
à quelques Villes. j u ,
D r o it Italique accordé à quelques Villes & Peuples.
_ ' 523. & fuiv.
D r o it de Pays Latin accordé à quelques Villes 8c
Peuples. 522 & fuiv.
D u vm -V irs ( les) prépofés aux chofes facrées ,
Furent établis«. Rome par Tarquin l’ancien. 302.
Leurs fonctions. Ibid . Leur crédit tant qu’ils purent
tromper. Ib id . Comment on les à repré-
femés fur les Médailles. 502.
E
Écrivisse-(T), fur les Médailles. } 6 i f
É c r it u r e fymbolique & hiéroglyphque des É gy p -
tiens ( 1’ ) a donnée fuivant M. Pluche, naiflance
à toutes les fauffès Divinités. 5>5 & fu iv . Quelles
en etoient les figures. 9 6 & fuiv. Explication
'1 d f plufieurs de ces figures. 9 6 8c fuiv. Les Divinités
de la première dalle, tels qu’Anubis ,
Apis, Apollon, &c., félon l’Écriture fymbolique.
106 8c üiiv. Les Divinités de la fécondé clalfe,
du moins pour la plupart, tirent leur origine
des Attributs fymboliques des principales figures
de cette Écriture. 23 2 & fuiv. La Lune com -
me Divinité , paroit lui devoir aulfi l’origine de
ion culte. jw
Édifices {les ) qui fervent d’ornemens à la Terre,
repréfentés fur les Médailles. 362 & fuiv.
Eihi.es créés pour partager les fondions des Tribuns.
450. Il y en avoir de trois fortes. 490 &
fuiv. Comment on les reco^noît fur les Médailles.
ib id . Leurs fondions 8c les honneurs
qu’on leur rendoit. 45)1.
Édiles Curales. 490.
Édiles du Peuple. Ib id .
Édiles Cereales. | 490 8c fuiv.
É d il it é j v o y e z Éd iles .
É gibole j facrifice d’une Chèvre. 2 9 1 .
É gypte { ! ’ ) fu r ie s Médailles. 336*
É gyptiens ( 1 es ) ne s’abandonnèrent à l’Idolâtrie
que par un oubli de la véritable Religion. 7 6 ,
Partagèrent les Dieux en trois Théogonies. Ib id .
Ne donnèrent d’abord aucune figure à l’Être fuf
rême. 84 &fuiv. Inftruifirenc les Peuples par
éxpofition des figures fymboliques. 92 & fuiv.
Avoient plufieurs façons d’apprendre fous quel
rapport il fâiloit honorer la Divinité. 93 8c fuiv»
Annoncoient l’arrivée des Vents, à qui le Pays
ctoit redevable de fa fertilité par le débordement
du Nil, par la figure de deux oifeaux, l’épervier
& la Huppe94 & fuiy. Par quelle fuperchcrie
de leurs rretres leur Dieu Canope l’emporta
fur le Feu , Divinité des Chaldeens. 125 &
fuiv. Comment ils jugeoient leurs morts. 308.
E léph ant (1 ) fur les Médaillés. 347 & fuiv.
E lo g a ba le fit fabriquer de grofies Pièces qu’A-
lexandre-Sévère décria. 33. Prend le titre de
Re&eur du Monde. < 3 j ,
É milien prend, fur les Médailles le titre de Sa-
J w j*8.
Emper eur 3 titre qui marque la Puifiance Souveraine.
528.
E mpereur ( F ) , comme Généraliïfime des Trou-
pes , étoit une dignité purement militaire. 504.
Comment elle étoit défignée fur les Médailles.
Ib id . Les Empereurs prirent ce titre & le donnèrent
aux Officiers qui s’étoienr diftingués. 504.
E mpereurs (les) ont paru faire cas des Dieux les
plus ridicules. 87. Faifoient paroîcre dans le
Cirque des Animaux rares & furieux. 3S3. Quelques
uns ont fait planter le Cirque pour donner
le fpe&acle de la Chafie. 384. Les Empereurs
paroifiènt en habit militaire fur leurs Médailles.
385. Départ d’un Empereur pour l'Armée. 388.
Son arrivée à l’Armée ou dans les Provinces, 8c
fon retour à Rome. 3 89. Allocutions des Empereurs.
391. Promettes 8c ferai ens des Soldats.
/&4..Les prix & les récompenfes que les Empereurs
aîf&ibuoiçnc après la viétoire. 395 8c
fuiv. Leurs orneHfièfts-de tête & .couronnes. 403.
Ils adoptoient des héritiers., 41 o 8c fuiv. Adoption
des provinces 8c Villes.- 411. Leurs Alliances
dans leurs familles.412. Leurs Alliances
conjugales. 41 3 &fmy. Alliances entre plufieurs
Empereurs. 414. Leuf'Sîbi en faits. 416 & fuiv.
Ils ont tous embitionné lé' titre de Reftituteur de
la liberté. 418. Ils furchargëèient le Peuple
d’Impots , dont ils lui faifoient quelquéfois la
remife. 419 & fuiv. Faifoient des diftributions
ordinaires & extraordinaires. 421. Accorcjoient
des grâces aux uns & le pardon aux autres. 422.
Titres glorieux qu’ils méritèrent. Ib id . Rén-
doient les Royaumes aux Princes fubj ugués, ou :
en créoient de nouveaux. 423. Ont prefque tous
pris la dignité de Conful. 482. Leur pouvoir
fur la Monnoie. 485 & fuiv. 537. Portèrent la
dignité de Cenfëür. 488. Comptoient par les
années de leur Puiflance Tribtinitiênne. 302.
Ambitiofinoient la dignité de Tribun. 505.
Prirent le titre d’Empereur , comme Généralif-
fime des Troupes, 8c le donnèrent aux Officiers
qui fe diftinguoienr. 5 24. Ne fuccédoient pas
toujours aux bonnes qualités de leurs Prédécef-
feurs. 525. Prennent les titres de Dieu. 517.
Ufurpent les noms de quelques Dieilx particuliers:
Ib id . Prennent ou fouffrent celui de Divin
, avec les qualités 8c attributs divins, fur
leurs Médaillés. 528. Pourquoi ils nie prirent t
pas le titre de Roi. 529. Ils prennent celui d’Au-
gufte. Ib id . De Céfar. 530. De Seigneur. 531.
De Père de la Patrie, ib id . De Père du Sénat 8c
des Armées* 531 8c fuiv. De Pieux. 522. D’Heureux
8c de très-Héureux. 532. De Grand 8c de
très-Bon. Ib id . De Reéteur dii Monde. 5 3 3. De
Reftituteur 8c de Réparateur des Provinces, 8c
autres. 353 & fuiv. On n’examine pas ici qui
font ceux qui ont mérité ces titres faftueux. 533
8c fuiv.
Empereurs ( les Médailles des douzepremiers ) ,
en bronze, ont été fouvent imitées ou contre-
faites. r ? 2,
E mpire d’Orient ( 1’ ) ; fa deftru&ion cft l’époque
à laquelle nous conduifons la connoiflànce des
Médailles antiques. 424.
Emsuble 3 Inftrument des Tifierands, fymbole de
l’Écriture lacrée des Égyptiens. 103.
Encast illées ( Médailles ) 1 7 & fuiv.
En c a st illemen t 3 comment les Fauftiires fe fervent
de ce fecret pour fnbftituer un revers rare
à une Médaille commune. 549. Moyens de découvrir
cette fraude. 330.
Encensoir ( 1’ ) fervoit à brûler l’encens dans les
(âcrifices. tt 92.
E n c l a b r i s :
£ T R A I S O N N E E
E n c l a b r i s ; nom de la table, fur laquelle on
. ' ; ■ ' ........ ' 291.
E nnery •( M. Michelet d’ .) pottede dans fon riche
Cabinet une Médaille de reftitution fingulière.
53. Un écu de Varin fourré, Sc plufieurs autres
pièces modernes 551. Des Médailles uniques
8c inconnues. 553. Il vient même d’acquérir
depuis peu une Médaille d’or de Vitaïianus,
qu’on ne connoiftoit pas jüfqu’d prefent. 555.
Épée 3 arme offenfive defs Officiers & Soldats. 3 8 <j.
ÉPer v ih r 3 oi.fe.au qui fie plaît au Nord , '\ik qui
fervoit à annoncer le Vent Eüéfien. ,94. 97. 98.
Ë phore 3 titre grec qui lignifie Tribun du Peu-
M | | j 5.10*.
É pis en bouquet , fur les Médailles, lignifient
l'abondance. 93. Epis de bled fur les mêmes Mo-
nuraens. 346’. Ornement de tête'.de Cércs. 401»
É pistate 3 dignité chez les Grecs, qui donnoit
le droit de préfider dans le Cor.feil des'Archontes.
509. Ses fonctions. Ib id .
É p it a ph e s (les) écoient prodigués à Rome fur
les tombeaux. 30<S. & lùiv.
É pone -, voyez Hippone.
Epoque (1’) de la fabrique des Monnoies 8c Médailles
de différens métaux, remonte au plus
-a 900-. ans avant l’Ère Chrétienne. 6 1 8c fuiy.
La première époque des Médailles grecques remonte
à Amyntàs. III. 6 5 . M. l’Abbé Barthélémy
la fait remonter à Alexandre I. Ibid . Les
Romains fe lervirent d’abord de Monnoie de
cuir. Ib id . Numa-Pompilius introduifit l’ufage
du bronze. Ib id . Servi us - Tullius en fit une
Monnoie courante. Ib id . Epoque des premières
Monnoies d’or 8c d’argent chez les Romains.
64 & fuiv. M. Çhimec fait remonter plus
haut l’époque des Monnoies des trois ' Mé-
8 taux chez les Romains. 6 5 8c fuiv. Époque
jufqua laquelle nous conduifons la connoif-
• lance-des Médailles antiques. 424;
É querre 3 première lettre de l’écriture courante.
D É S M À T I È R Ë §.. i p
l’Éperv tyi&s
É toiles •( une ôii deux ) 3 ornement: de tête d’Apis-.
. . 3 97-
É tude dé
:s Médailles ( 1’ ). pleine d’agrcment 8c
d’utilité 541 & fuiv.
Étui du Sacrificateur.
Exercice s du corps ( les ) , fur les Médaillés!
^ t , ' -,37^ fiiivv
Exergue dés Médailles (P ) , 3. 11 y a quelquefois
une troifième Légende (ur l’exergue. 424.
Légendes, Chiffres 8c- Lettres, qui s’y trouvent.
„ W j 5 39^ ^
Explication 'des Lettres grecques'.prifes arithmé-
' riquèment. ^ ; 1 47J & fém
Exp lic a t ion des Lettres iniriales & des abrégés
qui.fe trouvent dans lés Légendes des Médailles.
425 & iU'.V.
Ex p l ic a t io n des vingt - quatre premières Médailles
de la Planche XXXVe. , donnée par Mi
l’Abbé Barthélémy. 57 & luiv. L ontinuation de
l’explic.:tion dès Médaillés de la même .Plan-
che. ! lS ) aW 59-
Ex p l ic a t io n dés figurés hicrogiyfiqués rèpréfien-
tées fur quelques-unes de nos Planches. 97 8c Ù
EX. S. C. 3 différence de cette formule, d’avèc
Fa b le *, ce que figniffe Cohibiéh il
y a de fortes de. fables. 7 é.J& füiv. Leur ori-
■ gine, feicn M- l’Abbé Damer. 72. Selon ML
Rolün , la fable eft; née Hé l’liiftoite'. •. '89 &
fuiv. Sources des fables. Ib id . Lés Divinités'
différentes de la fable tellês qù’Anubis , Apis ,
Apollon , 8cc. 108 & fuiv. Les Divinités de la
première clafle appartiennent plus a là fable qu’à
l’hiftoirei ' ' ^ : " -■ ■ j.33 '& fuiv.
F ace des. Médailles ( la ). 3. 6 7 . Quelques Médailles
n’ont qu’uné Légende fur leur facé*
! , : i o5i
Équité ( P ) adorée d’abord en Dieu. 240. Les
aveugles Mortels en firent en fuite une Divinité
particulière. Ib id . Comment on là repré-
feiitê fur les Médailles. 240 & fuiy.
-Eratô 3 la quatrième Mufe. 15)7.
E schyle fait parler Prométhée avec impudence
' aux nouveaux Dieux. 87.
E sculape n’étoic autre chofe que la figure d’A-
nubis avec un ou deux Serpens, fymbôles de la
Vie. 141. La Fable en compte plufieurs 143.
Comment il eft repréfenté fur les Médailles.
Ib id . Il n’a aucun ornement de tète particulier.
'398.
E spagne ( 1’ )’, ■ fur les Médailles. 3 3 6 & fuiv.
Es p é r a n c e 1 ( P) doit fans doute fa liai (Tance aux
attributs d’Ifis. 241. Les Grecs 8c les Latins en
firent une Divinité qu’ils attribuèrent même à
certains Hommes Illuftres. Ib id . Comment ôn
la repréfente fur les Médailles. 14: & fuiv.
ËupH‘RôsiNE-3 une des Grâces. f ■- ( -196.
E urope ' ( P ) , fur les Médailles; ' 330.
■ 'Eu terpr. 3 la cinquième dès Mufes. 197.
E ûthymius , fameux Athlète, fur les Médailles.
59 & füiV.
Éternité (■ P ) doit fa naiffance aux fymbôles de
la Divinité , fur-tout au Cercle. 243. Gomment
1 on l’a repréfentée fur les Médailles, l b .... & fi
ÉtÈ'sï'éN- ( le Vent) étoit favorable aii;débordement
du Nil. 99. Annoncé par le fymbolè de
:’ j . / 1 r • .. . 4 ^4 *
Fa is c e a u x ( les) portes devant lés Confüls. 482.
Les Préteurs. 4S9 8c fuiv. Les Préfets 49ô-.
Les Légats des Proêonfuts, dès Prüpréteurs 8c
de l’Empereur............; ‘ Toi.
F a t a ( lés Dieux ) n’étoieht àutr| chofe que des
figures- fymboliques qui àvôient du rapport avec
les divers événemens de la Vie. . 143 8c fuiv.
La fable leur prête une aurfe o’ITginë. î 45. Comment
on les a repréfençés fur les Médailles.
Ib id . Ils'n’ont que leurs 'chevéùx pouf cbêffurê.
,,'r . -J ; h 9 *.
FàüNès ( lés Dieux! ). i 2 füiV. brtt pris riaif-
lance dans les Bacchanales. ’ï 46'. Quelle orjginé
leur donne ' là ( fable, Ils font “confondus
dans la N a mrfim a ti que ' ' a v,e c :|es Silènes &' les
Satyres. i+ ô -'S i fùiv. Quels font leurs ôfnèméns
de tète. • ‘ , 400.
Faussaires- d’Itàlië’ ( lèS )-horis bnf donné dès
' Médailles faufles connues fops'lés notps dii P a -
d ouan 8c du Parméfan. 545. JV?hIgfq> leVar lià-
bilèté, lé tirs' fraudes peuvent êtréuémafquéës.
548. Ils ont cherché à imiter les ‘feriies cfii
grand bronze. 55b. ,Leur* ItipércKefite-facile ^
découvrir. Ib id . Vis n’ontpafciTCôfëefiayé d’i-
- miter les 'Contré-marques. 1 ' j yj ;
Fao’stina ’( lés Médailles d’Ânnfâ")1 dirt été îbu-
’ vent imitées où cohrrefaites.1 J - * fa * *
Fau x Monnoyèurs' ;( lés ) frappoiéiit la Mohnoié
' fur différens Métaux , même fur f e ù 1 u
Dddd