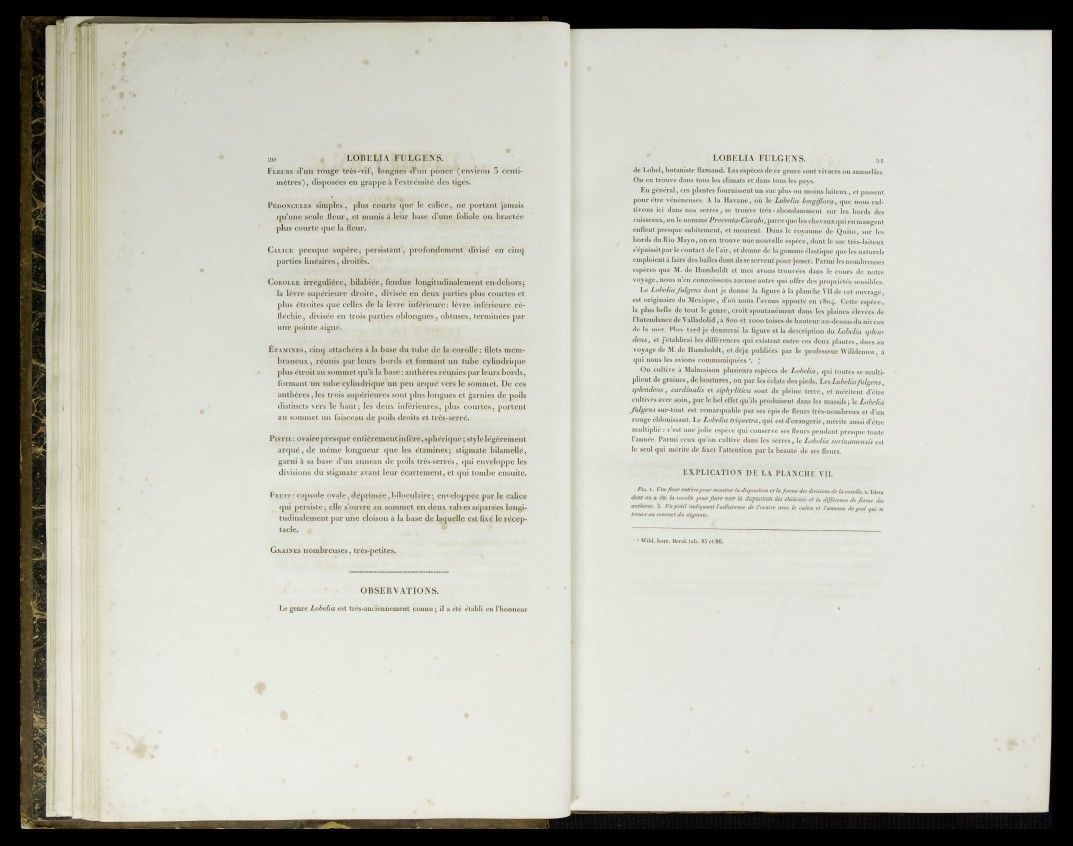
ao 4 LOBEI^A FULGENS.
FLEURS d'un rouge très-vif, longues d'un pouce (environ 3 centimètres),
disposées en grappe à l'extrémité des tiges.
PÉDONCULES simples, plus courts que le calice, ne portant jamais
qu'une seule fleur, et munis à leur base d'une foliole ou bractée
plus courte que la fleur.
C A L I C E presque supère, persistant", profondement divisé eit cinq
parties linéaires, droites.
COROLLE irrégulière, bilabiée, fendue longitudinalement en-dehors;
la lèvre supérieure droite, divisée en deux parties plus courtes et
plus étroites que celles de la lèvre inférieure : lèvre inférieure réfléchie,
divisée en trois parties oblongues, obtuses, terminées par
une pointe aiguë.
ETAMINES , cinq attachées à la base du tube de la corolle : filets membraneux
, réunis par leurs bords et formant un tube cylindrique
plus étroit au sommet qu'à la base : anthères réunies par leurs bords,
formant un tube cylindrique un peu arqué vers le sommet. De ces
anthères, les trois supérieures sont plus longues et garnies de poils
distincts vers le haut ; les deux inférieures, plus courtes, portent
au sommet un faisceau de poils droits et très-serré.
PISTIL : ovaire presque entièrement infère, sphérique ; style légèrement
arqué, de même longueur que les étamines ; stigmate bilamellé,
garni à sa base d'un anneau de poils très-serrés, qui enveloppe les
divisions du stigmate avant leur écartement, et qui tombe ensuite.
FRUIT : capsule ovale, déprimée, biloculaire; enveloppée par le calice
qui persiste ; elle s'ouvre au sommet en deux valves séparées longitudinalement
par une cloison à la base de laquelle est fixé le réceptacle.
GRAINES nombreuses, très-petites.
O B S E R V A T I O N S .
Le genre Lobelia est très-anciennement connu ; il a été établi en l'honneur
L O B E L I A FULGENS. 3I
de Lobel, botaniste flamand. Les espèces de ce genre sont vivaces ou annuelles.
On en trouve dans tous les climats et dans tous les pays.
En général, ces plantes fournissent un suc plus ou moins laiteux, et passent
pour être vénéneuses. A la Havane, où le Lobelia longiflora, que nous cultivons
ici dans nos serres, se trouve très - abondamment sur les bords des
ruisseaux, on le nomme Preventa-Cavalo, parce que les chevaux qui en mangent
enflent presque subitement, et meurent. Dans le royaume de Quito, sur les
bords du Rio Mayo, on en trouve une nouvelle espèce, dont le suc très-laiteux
s'épaissitpar le contact de l'air, et donne de la gomme élastique que les naturels
emploient à faire des balles dont ils se servent pour jouer. Parmi les nombreuses
espèces que M. de Humboldt et moi avons trouvées dans le cours de notre
voyage, nous n'en connoissons aucune autre qui offre des propriétés sensibles.
Le Lobelia fulgens dont je donne la figure à la planche Vil de cet ouvrage,
est originaire du Mexique, d'où nous l'avons apporté en 1804. Cette espèce,
la plus belle de tout le genre, croit spontanément dans les plaines élevées de
l'Intendance de Valladolid, à 800 et 1000 toises de hauteur au-dessus du niveau
de la mer. Plus tard je donnerai la figure et la description du Lobelia splendens,
et j'établirai les différences qui existent entre ces deux plantes, dues au
voyage de M. de Humboldt, et déjà publiées par le professeur Willdenow, à
qui nous les avions communiquées \
On cultive à Malmaison plusieurs espèces de Lobelia, qui toutes se multiplient
de graines, de boutures, ou par les éclats des pieds. Les Lobelia fulgens,
splendens, cardinalis et siphylitica sont de pleine terre, et méritent d'être
cultivés avec soin, par le bel effet qu'ils produisent dans les massifs ; le Lobelia
fulgens sur-tout est remarquable par ses épis de fleurs très-nombreux et d'un
rouge éblouissant. Le Lobelia trùjuetra, qui est d'orangerie, mérite aussi d'être
multiplié : c'est une jolie espèce qui conserve ses fleurs pendant presque toute
l'année. Parmi ceux qu'on cultive dans les serres, le Lobelia surinamensis est
le seul qui mérite de fixer l'attention par la beauté de ses fleurs.
EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.
Fia.i. Vue fleur entière pour montrer la disposition et la forme des divisions de la corolle, a. Idem
dont on a ôtè la corolle pour faire voir la disposition des étamines et la différence de firme des
anthères. 3. Un pistil indiquant [adhérence de l'ovaire avec le calice et l'anneau de poil qui se
trouve au sommet du stigmate.
Wild. hort. Berol. lab. 85 et 86.