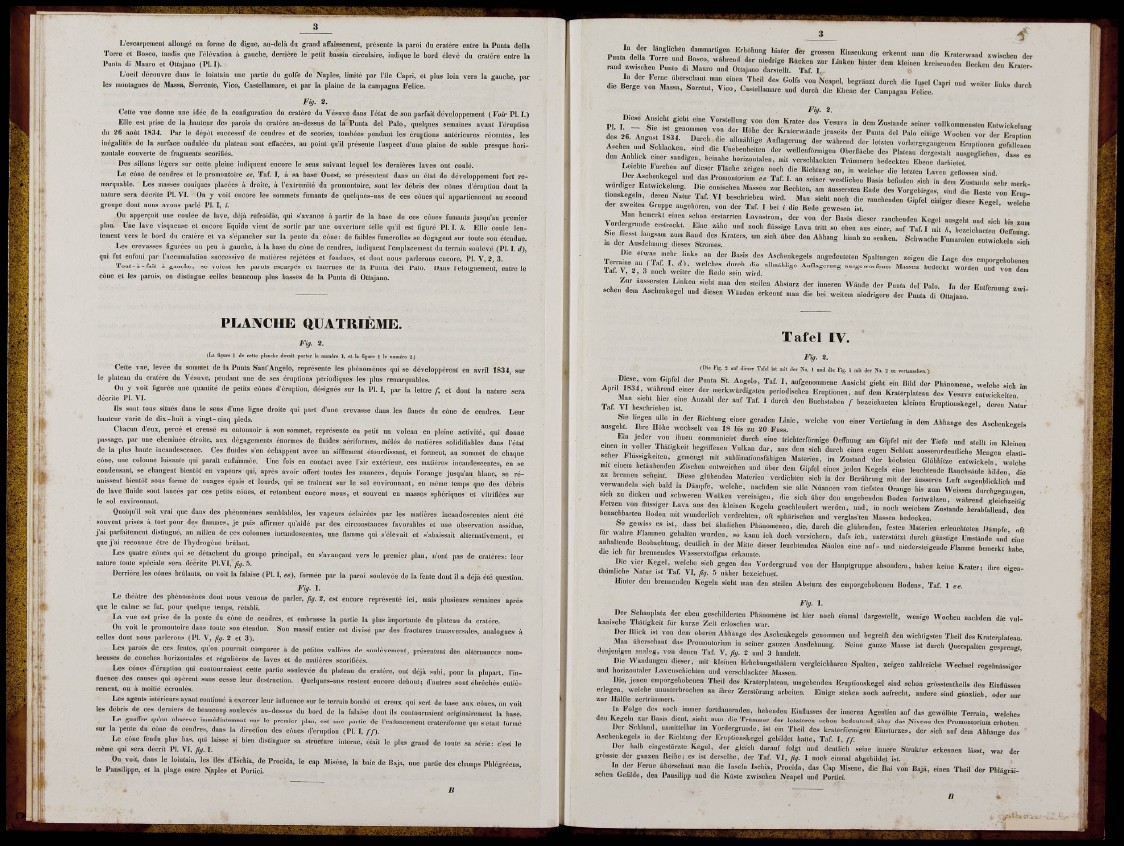
( r
I/escarpemeiil allongé en forme de digne, au-delà du grand affaîssemeui, présente la paroi du cratère entre la Puiila della
Torre el DONCO, tandis que l'élévation à gaudio, derrière le pelit bassin circulaire, indique le bord élevé du cratère entre la
Pillila di Mauro et Oltajaiio (Pl. I).
L'oeil découvre dans le loinlain une partie du golfe de Naples, limitó par l'ile Capri, et plus loin vers la gauche, par
les montagnes de Massa, Sorreute, Vico, Castellaniare, et par la plaine de la campagna Felice.
du
iVoirPl I.)
;ut l'éruption
Fy. 8.
Cette vue donne une idée de la configuration dn cratère du Vésuve dans l'état de son parfa
Elle est prise de la hauteur des parois du cratère au-dessua de la Punta del Palo, quelqu
I 2(5 août 1834. Par le dépôt successif de ceudres et de scories, tombées pendant les éruptions antérieures récentes,
inégalités de la surface ondulée du plateau sont effacées, au point qu'il présente l'aspect d'une plaiue de sable presque borizoiilale
couverte de fragments scorifiés.
Des sillons légers sur cette pleine indiquent encore le sens suivant lequel les dernières laves ont coulé.
Le cône de cendres et le promontoire ee, Taf. 1, à sa base Ouest, se présentent dans un état de développement fort remarquable.
Les masses coin'ques placées à droite, à l'extremité du promontoire, sont les débris des cônes d'éruption dont la
nature sera décrite Pl. VI. On y voit encore les sommets fumants de quelques-uns de ces cônes qui appartiennent au second
groupe dont nous avons parlé Pl. I, i.
On apperçoit une coulée de lave, déjà refroidie, qui s'avance à partir de la base de ces cônes fumants jusqu'au premier
plan. Une lave visqueuse et encore liquide vient de sortir par une ouverture telle qu'il est figuré Pl. I. h. Elle coule lentement
vers le bord du cratère et va s'épauclier sur la pente du cône: de faibles fumerolles se dégagent sur toute son étendue.
Les creviusses figurées un peu à gauche, à la base dn cône de cendres, indiquent remplacement du terrain soulevé (Pl. I. d),
qui fut enfoui par raecnmulation successive de matières rejélées et fondues, et dont nous parlerons encore, Pl. V, 2, 3.
T o u t - à - f a i t à gauche, se voient les parois escarpés et internes de la Punta del Palo. Dans réloignemeiit, entre le
cène et les parois, on distingue celles beaucoup plus basses de la Punta di Ottajano.
PLANCHE QUATRIÈME.
Fig.
(L. lisrnre 1 d« cette pl»ncl>e devait porter te numéro 1, et I. figure
î, levée du sommet de la Punta Sant'Angelo, représente les pliénomèi
cratère du Vésuve, pendant une de ses éruptions périodiques les plus remarquables,
it figurée une quantité de petits cônes d'éruption, désignés sur la Pl. I, par la lettre f , et dont la nature sers
Cette v
le plateau di
On y V
décrite Pl. V
Ils sont tous situés dans le sens d'une ligne droite qi
hauteur varie de dix-huit à viugt-cînq pieds.
Chacun d'eux, percé et creusé en entonnoir à son sommet, représente en petit
passage, par une cheminée étroite, aux dégagements énormes de Ûuides aériformes,
i haute incandescence.
le nu miro 2.)
is qui se développèrent en avril 1834, sur
d'une crevasse dans les flancs du cône de cendres. Leur
volcan en pleine activité, qui donne
s de matières solidifiables dans l'état
de la plus incandescence. Ces fluides s'en échappent avec un sifflement étourdissant, et fiwment, au sommet de chaque
cône, une colonne luisante qui parait enflammée. Une fois en contact avec l'air extérieur, ces matières incandescentes, en se
vapeurs qui, après avoir offert toutes les nuances, depuis lorange jusqu'au blanc, se réiges
épais et lourds, qui se traînent sur le sol environ nant, en même temps que des débris
condensant, se changent bientôt
unissent bientôt sous forme di
de lave fluide sont lancés par ces petits cônes, et retombent encore mous, et souvent en masses sphériques et vitrifiées sur
le sol environnant.
Quoiqu'il «oit vrai que dans d
souvent prises à tort pour des flam
que
Les
phénomc
s , Je pu
les semblables, les vapeurs éclairées
: aiTirmer qu'aidé par des circonstan
•faitement distingué, an milieu de ces coloi
j'ai reconnue être de l'Iiydrogène brûlant.
incandescentes, une flamme qui
par les niatii
es favorables
s'élevait et ¡
qui se détachent du groupe principal, en s'avançant vers le premier pli
res incandescentes aient éti
et une observation assidue
'abaissait alternativ et
j r e toute spéciale sera dé(
Derrière les cônes brùlan
n'ont pas de cratères: leur
lté dont il a déjà été question.
•ite PI.VÎ, fy. 5.
<, on voit la falaise (Pl. I, ee), formée par la paroi soulevée de la (
Fiff. 1.
Le théâtre des phénomènes dont nous venons de parler, fî^.2, est encore représenté ici, mais plusieurs semaines après
que le calme se fut, pour quelque temps, rétabli.
L a vue est prise de la pente du cône de cendres, et embrasse la partie la plus importante du plateau du cratère.
On voit le promontoire dans toute .son étendue. Son massif entier est divisé par des fractures transver.vales, analogues à
celles dont nous parlerons (Pl. V, fy. 2 et 3).
Les parois de ces fentes, qu'on pourrait comparer à de petites vallées de soulèvement, présentent des alternances nombreuses
de couches horizontales et régulières de laves et de matières scorifiéès.
Les còl
es d eruption qui contournaient cette partie soulevée du
anses qui opèrent sans cesse leur destruction. Quelque:
fluence des i
rement, ou à moitié
Les agents intérie
les débris de ce.s der
L e gouffre qu'
•croulés.
ayant continué à exercer leur iniliience sur le terrain bombé et creux qui sert de base
rs de beaucoup soulevés au-dessus du bord de la falaise dont ils contournaient origi
1 observe immédiatement sur le premier plan, est une partie dç l'enfoncement cratérifoi-n
sur la pente du cône de cendres, dans la direction des cônes d'éruption (Pi. I, f f ) .
Le cône fendu plus bav. qui laisse si bien distinguer sa structure interne, était le nlus grand de toute
même qui sera décrit Pi. Vi, fy. t.
On voit, dans le lointain, les îles d'Ischia, de Procida, le cap Misène, la baie de Haj;
le Pausilippe, e( la plage entre Naples et Portici.
plateau du cratère, ont déjà subi, pour la plu|)art, l'in
-uns restent encore debout; d'autres sont ébrèchés entiè
cones, on voit
ment la ba.se.
I s'était formé
une partie des champs Phlégréens,
B
rand zwiscbei. Puiilo di Mauro und Ollajaiio darslelll. Taf I ivr aKr -
In der Ferne überscl.aut ,„a„ einen Tlied de, Golfs von Neajel , begrün« dnreh die l,„el Cai.ri „„d weiter llnU I.
d.e Berge von Mas.a, Sorren,, Vico, Ca»,ell»n,are n„d dnrcl, die Ebene der Campagna K e h l '
(Die Fig. 2 auf .Ueser Tafel i,
Diese
April 1834,
Man
Taf. VI i
an.gir 'rii^irifzr^ti:::"'
2.
Die,e Ä„,iebi giebl eine Vor.,elln„g von dem Krater de-, Ve.uv. in den, Zn.innde .einer vollkon,„en„en K„.wickeln„,r
PI. I. — S.B ist genommen von der Hübe der Kraterwände ieim-its der Pnnta del Palo pi„i» Wn,t„ ''"'"'f'""8
den Anbl A etner ,a„d,ge,,, be.nabe horizontalen, mit ver,chlaelcte„ Trnnnnen, bedeckten Ebene darbietet
Lotebte Fnreben anf dieser Fläcbe zeigen noch die Bicb.ung an, in welcher die letzten Laven g l L e , , ,ind
DerA.cbenkegel nnd da, Pron,ont„ri,„n . . Taf. I. an »einer weltlichen Ba,i, belinde,, ,ich In det, z Z n t l .ehr merk
wnrd,ger En«w,ekelnng. Die coni.eben M.»e n znr Reebten, am in»er,ten Ende de. Vorgebirge., vt Er
. , o „ . k e g e „, deren Natnr Taf. V, be.ebrieben wird. Man .ieb, noch die r.oehenden (fipfel ei ig d.ter M wIi ^
der zweien Grnppe angehören, von der Taf. I bei die Rede gewesen i.l, ® '
-Man bemerkt einen .chon e,..ta,.rten Lava.tro,n, der von der Ba,,i. dieser rancbenden Kegel a„,,gebl nnd .ich bi, .„,«
' d"; d ^ e " . " " " » ' » - i c k d . „cS
fl'XeTli'dttf;'" Spaltnngen zeigen die Lage de, emp.rgebohenen
Taf. V, / I I ; i e ; I t l t l w!;i "- " e n „nd von dem
Znr än,,er.le,, Linken ^.ieht „,an den ,teilen Ab.tnrz der inneren Wände der Pnnta del Palo. In der Entfernnng zwi
.chen dem A,chenkegel „nd diesen Wänden erkennt man die bei weitem niedrigere der Pnnta di Ottajano.
Tafel IV.
F i / . 2.
1 mit der fío. I nnd die Fig. I mit der Wo, 2 m verlnnsciien.)
om Gipfel der Pnnta St. Angelo, Taf I, anfgenommene A.,iebt giebt ein Bild der Phänomene, welche sich im
^ wahrend e,ner der merkwürdigsten periodischen Ernplionen, anf dem Kraterplatean de. Ve.nvs entwickelten
l i r i e b e " i l " " ' Ueret, ^ t . r
Ein jeder von ihnen communicirt durch eine trichterförmige OelTnnng am Gipfel mil der Tiefe nnd stellt im Kleinen
H ? Vnlkan dar. an, den, .ich dnrch einen engen Sehlot. .n..er„rde.,.liehe ^ „ 1 " i
.,; ,er Fl.ss,gke,.en gemeng, mit soblimationsfábigen ¡Ma.crien, in, Zn.tand der höchsten Gltlbhit.e en.wiekdr we c e
zn bre,.nen sebe, Dte.e glnhenden Materien verdicblen sieh in der Berñhrnng mit der änsseren Lnft an-enblickliel nnd
verwandeln .,eh bald in Dämpfe, welche, nachdem ,ie alle Nñancen vom tiefsten Orange hl, znm We,W,, d, r I " g L e ^
fITVO' S" ° T 7°'",:,° "" "" -^l-end gSS ig b e t l ? r r S' ^ ' " " " " " " » " l « " . - w« » ' - " . Zn.t.nde herabfaUend, ta
benachbarten Boden m,t wnnderlieb verdrehten, oft sphärischen nnd verglaste, Massen bedecken.
S o gewiss e. „. , da., bei äbnlichen Phänomenen, die, dnreh die glühenden, fe,sten .Materien erleuchteten Dampfe „f.
fn wahre Hammen gehalten wnrden, .o kann ich doeh ver,ichen,, daf, ich, nn.er.,.Qtzt durch günstige Umstände , „d eine
d! 'th"t ir" ' " f " h : : , ; ; : 1, die ich für brennendes W asserstoffgas erkannte. '
Hinter Jen breunenden Kegeln sieh, mau den .telleu Ab.tnrz de, etnporgebobenen Bodens, Taf. 1 ee.
Mi,. 1.
, •I«'- gesehilderte« Phänomene ist hier noch einmal dargestellt, wenige Wochen nachdem die vulkaiusche
Tha.,gkeit für kurze Zeit erloschen war.
Der Blick is. von de,n obe,.en Abhänge de. Ascheukegels genommei
¡Han überschau, da. Pro„,ou.o,.inm in seiner ganzen An.del,
deujeuigeu analog, von denen Taf. V, / i f . 2 und 3 haudelt.
Die Wandungen dieser, mit kleinen Krhebnngs.bälern
nnd borizou.aler J.avensebichteu nnd verschlackter Massen
, nnd begreift den wichtigsten Tbeil de, Kraterplatean.
„g. Seine ganze ,Ma,se ist durch Ouerspalten gesprengt,
ergleichbareu Spalten, zeigen zablreicbe Wechsel regelmässiger
Die, jenen emporgebobeneu Thell de. Kraterplateau, ,„ngebenden Eruptionskegel sind schon grösstentbeils den Eintlñ.sen
e,.legou, welche unuulerbrochen au ihrer Zerstö,
znr Hälfte zert,.üm,nert.
jebenden Eiutlü.f
tilg arbeiten. Einige .teben noch aufrecht, andere sind gänzlich, oder i
In Folge de» noch ¡,nmer fortdanernden, hebenden Eiutlus.e. der inneren Agenlien auf da. gewölbte Terrain welches
den Kegeln znr Ba.„ dient, .lebt man die Trümmer der letzteren ,cl,on bedeutend über da. Niveau de. Promontorio,n erhoben
Der Schlund, num.ttelbar ,m Vordergründe, ist ein Tbeil de, kratertormigen Einsturzes, der sich auf dem Abbange des
A..che„kegel. in der Bicbtnng der Eruptiou.kegel gebildet hatte, Taf. I, f/l
Der halb eingestürzte Kegel, der gleich darauf folgt und deu.lich .eine innere S.ruktnr erke,
griisste der ganzen Reihe; es ist der.selbe, der Taf. VI, fu,. l noch einmal abgebildet i...
In der Perne übersclian. man die Inseln Iscbia, Procida, das Cap Misene, die Bai v
sehen Gelilde, den Pansilipp nnd die Küste zwischen Neapel nnd Portiei.
der
, Bajá, einen Tbeil der Phlägräi