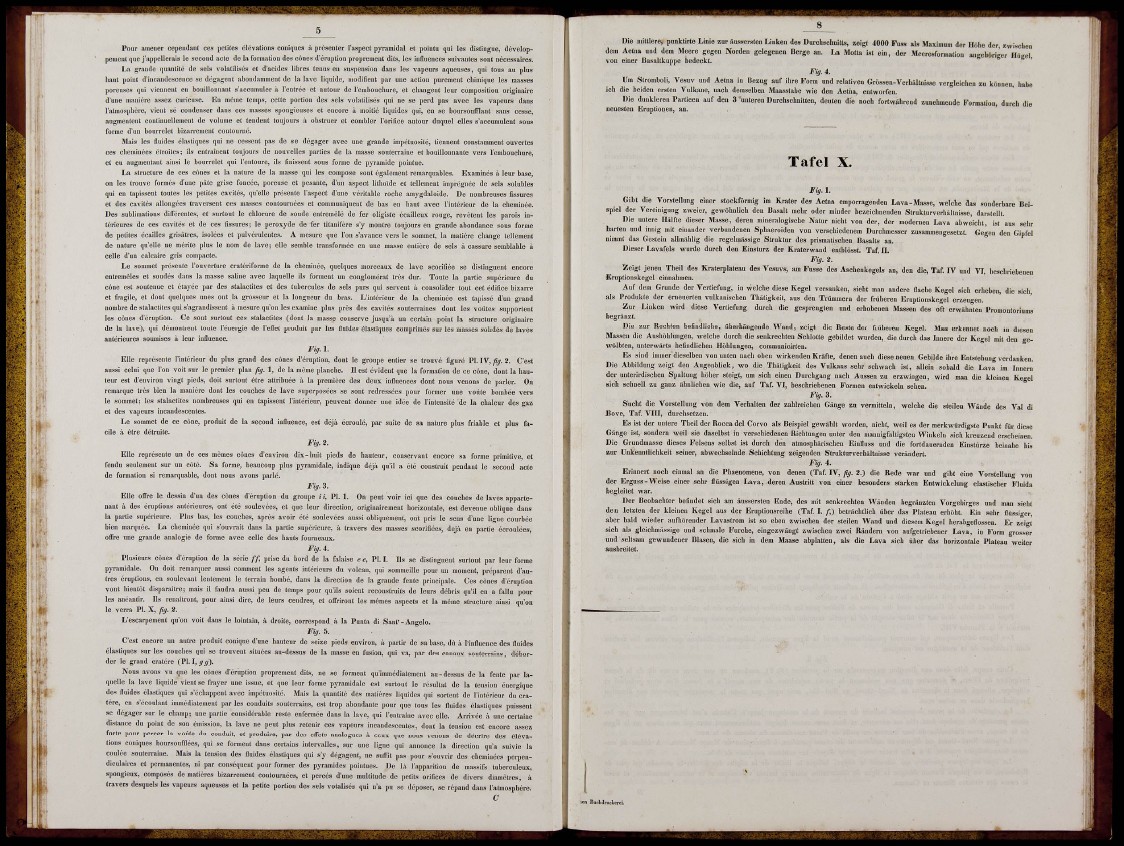
s i.
l i
I I I'
I
Pour amener cepeiidaiil ces peliiea élévations coniques à présenter l'aspect pyramidal et pointu qui les distingue, développement
que j'appellerais le second acte de la formation des cônes d'éruptiou proprement dits, les influences suivantes sont nécessaires.
I,:i •frandc quantité de sels volatilisés et d'acides libres tenus eu suspension dans les vapeurs aqueuses, qui tous au plus
haut point d'incandescence se dégagent abondamment de la lave liquide, inodifieiit par uue action purement chimique les niasses
poreuses qui vieuiieul eu boiiillonnanl s'accumuler à l'entrée et autour de l'embouchure, et changent leur compositio» originaire
d'une manière assez curieuse. En même temps, celle portion des sels volatilisés qui ne se perd pas avec les vapeurs dans
l'atmosphère, vient sé condenser dans ces masses spongieuses et encore à moitié liquides qui, en se boursonfflant sans cesse,
augmentent co: nliimellement de volume et tendent toujours à obstruer et combler l'orifice autour duquel elles s'accumulent sous
forme d'un bourrelet bizarrement contourné.
Mais les fluides éliustiques qui ne cessent pas de se dégager avec une grande impétuosité, tiennent constanmient ouvertes
ces cheminées étroites; ils entraînent toujours de nouvelles parties de la masse souterraine et bouillounante vers l'embouchure,
et eu augmentant ainsi le bourrelet qui l'entoure, ils finissent soits forme de pyramide pointue.
La structure de ces cônes et la nature de la masse qui les compose sont également remarquables. Examinés à leur base,
on les trouve formés d'une pâle grise foncée, poreuse et pesante, d'un aspect lithoïde et tellement imprégnée de sels solubles
qui eu tapissent toutes les petites cavités, qu'elle présente l'aspect d'une véritable roche amygdaloide. De nombreuses fissures
et des cavités allongées traversent ces masses contournées et communiquent de b;is en haut avec l'intérieur de la cheminée.
Des sublimation» difi"érentes, et surtout le chlorure de soude entremêlé de fer oligiste écailleux rouge, revêtent les parois intérieures
de ces cavités et de ces fissures; le peroxyde de fer titanifere s'y montre toujours eu grande abondance sous forme
de petites écailles grisâtres, isolées et pulvérulentes. A mesure que l'on s'avauce vers le sommet, la matière change tellement
de nature qu'elle ne mérite plus le uom de lave; elle semble transformée en une masse entière de sels ii cassure semblable à
celle d'un calcaire gris compacte.
Le sommet présente l'ouverture cratériforme de la cheminée, quelques morceaux de lave scorifiée se distinguent encore
entremêles et soudés dans la masse saline avec laquelle ils forment uu conglomérat très dur. Toute la partie supérieure du
cône est soutenue et étayée par des stalactites et des tubercules de sels purs qui servent à consolider tout cet édifice bizarre
et fragile, et dont quelques unes ont la grosseur et la longueur du bras. L'intérieur de la cheminée est tapissé d'un grand
nombre de stalactites qui s'agrandissent à mesure qu'on les examine plus près des cavités souterraines dont les voûtes supportent
les cônes d'éruption. Ce sont surtout ces stalactites (dont la majsse conserve jusqu'à un certain point la structure originaire
de la lave), qui démontrent toute l'énergie de l'effet produit par les fluides élastiques comprimés sur les niasses solides de laves
autérieures soumises à leur influence.
Fy. 1.
Elle représente l'intérieur du plus grand des cônes d'éruption, dont le groupe entier se trouvé figuré Pl. IV, fig. 2. C'est
aussi celui que l'on voit sur le premier plan fig. I, de la même planche. II est évident que la formation de ce cône, dont la hauteur
est d'envirou vingt pieds, doit surtout être attribuée à la première des deux influences dont nous venons de parler. On
remarque très bien la manière dont les couches de Jave superposées se sont redressées pour former une voûte bombée vers
le sommet; les stalactites nombreuses qui en tapissent l'intérieur, peuvent donner une idée de l'Intensité de la chaleur des gaz
et des vapeurs incandescentes.
Le sommet de ce cône, produit de la second influence, est déjà écroulé, par suite de sa nature plus friable et plus facile
à être détruite.
Fig. 2.
Elle représente un de ces mêmes cônes d'envirou dix-huit pieds de hauteur, conservant encore sa forme primitive, et
fendu seulement sur uu côté. Sa forme, beaucoup plus pyramidale, indique déjà qu'il a été construit pendant le second acte
de formation si remarquable, dont nous avons parlé.
Flg.3.
Elle offre le dessin d'un des cônes d'éruption du groupe li, Pl. 1. On peut voir Ici que des couches de laves appartenant
à des éruptions antérieures, ont été soulevées, et que leur direction, originairement horizontale, est devenue oblique dans
la partie supérieure. Plus bas, les couches, après avoir été soulevées aussi obliquement, ont pris le seus d'une ligne courbée
bleu marquée. La cheminée qui s'ouvrait dans la partie supérieure, à travers des masses scorifiées, déjà en partie écroulées,
offre une grande analogie de forme avec celle des hauts fourneaux.
Fig. 4.
Plusieurs cônes d'éruption de la série f f , prise du bord de la falaise ee, Pl. L Ils se dislinguent surtout par leur forme
pyramidale. On doit remarquer aussi comment les agents intérieurs du volcan, qui sommeille pour un moment, préparent d'autres
éruptions, en soulevant lentemeut le terrain bombé, dans la direction de la grande feule principale. Ces côues d'éruption
vont bientôt disparaître; mais il faudra aussi peu de temps pour qu'ils soient reconstruits de leurs débris qu'il en a fallu pour
les anéantir. Ils renaîtront, pour ainsi dire, de leurs cendres, et offriront les mômes a-spects et la même structure ainsi qu'on
le verra Pl. X, fig. 2.
L'escarpement qi ^oit dans le loiutai i la P droite, correspond unta di Sant'- Angelo.
Fig. 5.
C'est encore un autre produit conique d'une hauteur de seize pieds environ, .
I partir de sa base, dn à l'influence des fluides
, qui va, par des canaux souterrains, débortnmédiatement
élastiques sur les couches qui se trouvent situées au-dessus de la masse en fusion
der le grand cratère (Pl. I,
Nous avons vu que les cônes d'éruption proprement dits, ne se forment qu'i
an-dessus de la fente par lasurtout
quelle la lave liquide vient se frayer une issue, et que leur forme pyramidale est
des fluides élastiques qui s'échappent avec impétuosité. Mais la quantité des matii
tère, en s'écoulant immédiatement par les conduits souterrains, est trop abondante
se dégager sur le champ; une pariie considérable reste enfermée dans b lave, qui l'entraîne avec elle. Arrivée à une certaine
dlsiance du point de son émission, la lave ne peut plus retenir ces vapeurs incandescentes, dont la tension est encore assez
forle pour percer la voûte du conduit, et produire, par des efl-ets analogues à ceux que nous venons de décrire des élévations
le résultat de la tension énergique
res liquides qui sortent de l'intérieur du cra-
|)Our que tous les fluides élastiques puissent
coniques boursoufflées, qui se forment dans certains intervalles, sur une ligne qui annonce la direction qu'a suivie la
coulée souterraine. Mais la tension des fluides élastiques qui s'y dégagent, ne suffit pas pour s'ouvrir des cheminées perpendiculaires
et permanentes, ni par conséquent pour former des pyramides pointues. De là l'apparition de massifs tuberculeux,
spongieux, composés de matières bizarrement contournées, et percés d'une multitude de petits orifices de divers diamètres, à
travers desquels les vapeurs aqueuses et la petite portion des sels votallsés qui n'a pu se déposer, se répand dans l'atmosphère.
C
Die mittlere, pnnktirte Linie zur ä 1 Linken des Durchschnitts, zeigt 4000 Fuss als Maximi
dem Aetna und dem Meere gegen Norden gelegenen Berge an. La Motta ist elu, der Meeresfori
von einer Basaltkuppe bedeckt.
Fij/. 4.
Um Stromboli, Vesuv und Aetna in Bezug auf ihre Form und relativen Grössen-Verhältnisse
ich die beiden ersten Vulkane, nach demselben Maasslabe wie den Aetna, entworfen.
Die dunklereu Partieen auf den 3 unteren Durcliscüultten, deuten die noch fortwährend zunehmende Formation, durch die
neuesten Eruptionen, an.
der Höhe der, zwischen
malion angehöriger Hügel,
ergleichen zu können, habe
al;
s sehr
»gesetzt. Gegen den Gipfel
Tafel X.
Fig. 1.
Gibt die Vorstellung einer stockformig im Krater des Aetna emporragenden Lava-Masse, welche das sonderbare Beispiel
der Vereinigung zweier, gewöhnlich den Basalt mehr oder minder bezeichnenden Slrukturveriiälmisse, darslelll.
Die untere Hälfte dieser Masse, deren mineralogische Natur nicht von der, der modernen Lava abweicht
harten und innig mit einander verbundenen Sphaeroiden von verschiedenem Durchmesse!
nimmt das Gesteiu allmahlig die regelmässige Struktur des prismatischen Basalts au.
Dieser Lavafels wurde durch den Einsturz der Kraterwand entblösst. Taf. II.
F^. 2.
Zeigt jenen Theil des Kraterplateau des Vesuvs, am Fusse des Aschenkegels an, den die, Taf. IV und VI, beschriebenen
Eruptionskegel einnahmen.
Auf dem Grunde der Vertiefung, in welche diese Kegel versanken, siebt man andere flache Kegel sich erheben, die sich
Produkte der erneuerten vulkanischen Thätigkelt, aus den Trümmern der früheren Eruptionskegel erzeugen.
Zur Linkeu wird diese Vertiefung durch die gesprengten und erhobenen Massen des oft erwähnten Promouloriums
begränzt.
Die zur Rechten befindliche, überhängende Wand, zeigt die Reste der frühere« Kegel. Man erkennet noch in diesen
Massen die Aushöhlungen, welche durch die senkrechten Schlotte gebildet wurden, die durch das Innere der Kegel mit den gewölbten,
unterwärts hefindlicheu Höhluugen, communicirten.
Es sind immer dieselben von unten nach oben wirkenden Kräfte, denen auch diese neuen Gebilde ihre Entstehung verdanken.
Die Abbildung zeigt den Augenblick, wo die Thädgkeit des Vulkans sehr schwach ist, allein sobald die Lava im Innern
der unterirdischen Spaltung höher steigt, um sich einen Durchgang nach Aussen zu erzwingen, wird man die kleinen Kegel
sich schnell zu gauz äbnliehen wie die, auf Taf. VI, beschriebenen Formen eutwickelu sehen.
F ^ . 3.
Sucht die Vorstellung von dem Verhalten der zahlreichen Gänge zu vermitteln, welche die steilen Wände des Val di
Bove, Taf. VIII, durchsetzen.
Es ist der untere Theil der Rocca del Corvo als Beispiel gewählt worden, nicht, weil es der merkwürdigste Punkt für diese
Gänge ist, sondern weil sie daselbst in verschiedenen Richtungen unter den mannigfaltigsten Winkeln sich kreuzend erscheinen.
Die Grundmasse dieses Felsens selbst ist durch den atmosphärischeu Einfluss und die fortdauernden Einstürze beinahe bis
zur ünkeuntiichkelt seiner, abwechselnde Schichtung zeigenden Strukturverhältnlsse verändert.
Fig. 4.
Erinnert noch einmal an die Phaeaoraene, von denen (Taf. IV, fig. 2.) die Rede war und gibt eine Vorstellung von
der Erguss-Weise einer sehr flüssigen Lava, deren Austritt von einer besonders starken Entwickelung elastischer Flulda
begleitet war.
Der Beobachter befindet sich aiu äussersten Ende, des mit senkrechten Wänden begränzten Vorgebirges und
den letzten der kleine«i Kegel aus der Eruptionsreihe (Taf. I. /;) beträchtlich über das Plateau erhöht. Ein sehi
aber bald wieder aufhörender Lavaslrom ist so eben zwischen der steilen Wand und diesem Kegel herabgeflossen.
sich als gleichmässige uud schmale Furche, eingezwängt zwischen zwei Rändern
und seltsam gewundener Blasen, die sich in dem Maase abplatten, als die Lav
ausbreitet.
nan sieht
flüssiger.
Er zeigt
grosser
weiter
von aufgetriebener Lava, in For
sich über das horizontale Plateai
Í
I
r
L