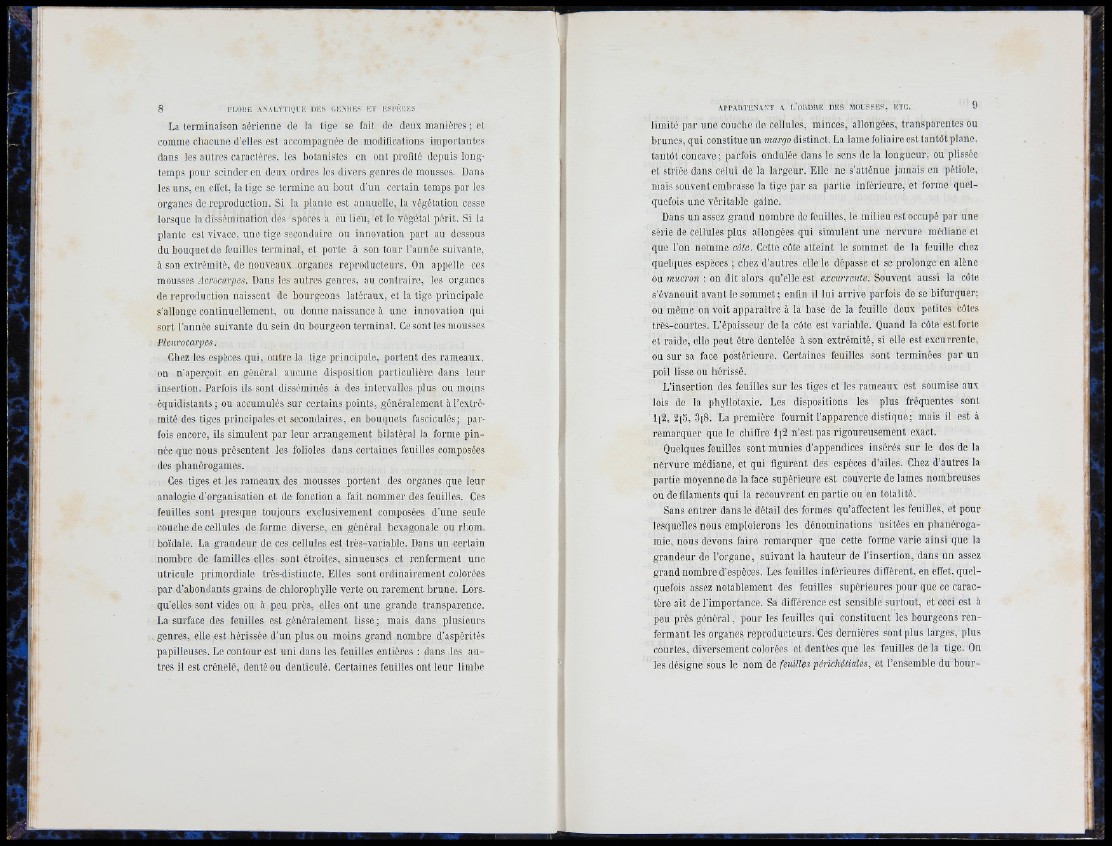
8 FLOHE ANALYTIQUE UES QENHES ET E S i'ÈCE S
La term in a iso n aérien n e de la tige se fait de deux manières ; et
comme chacune d’elles est accompagnée de modifications importantes
dans les autres caractères, les botanistes en ont profité depuis longtemps
p o u r scinder en deux ordres les divers g enres de mousses. Dans
les u n s, en effet, la tige se te rm in e au bout d’u n c erta in temps p a r les
organes de reproduction. Si la p lan te est a n n u elle, la végétation cesse
lorsque la dissémination des spores a eu lieu, et le végétal p é rit. Si la
p lan te est vivace, u n e tige secondaire ou innovation p a rt au dessous
du bouquet de feuilles te rm in a l, et porto à son to u r l ’année suivante,
à son extrémité, de nouveaux organes rep ro d u c teu rs. On appelle ces
mousses Acrocarpes. Dans les au tre s genres, au c o n tra ire , les organes
de reproduction naissent de bourgeons la té rau x , et la tige p rin c ip a le
s’allonge c ontinue llement, ou donne naissance à u n e in n o v a tio n qui
sort l’année suivante du sein du bourgeon te rm in a l. Ce sont les m ousses
Pleurocarpes.
Chez les espèces q u i, outre la tige p rin c ip a le , p o rte n t des ram e au x ,
on n ’aperçoit en général aucune disposition p a rtic u liè re dans leu r
in sertio n . Parfois ils sont disséminés à des in te rv a lle s plus ou moins
équiclistants ; ou accumulés su r certains p o in ts, g é néralem ent à l’extrémité
des tiges princ ipa le s et secondaires, en bouquets fascicules; p a rfois
encore, ils sim u len t p a r le u r a rran g em en t bila té ra l la forme p in -
née que nous p ré s en te n t les folioles dans certaines feuilles composées
des phanérogames.
Ces tiges et les rameaux des mousses p o rte n t des organes que leur
analogie d'o rg an isa tio n et de fonction a fait n om m e r des feuilles. Ces
feuilles sont presque toujours exclusivement composées d 'u n e seule
couche de cellules de forme diverse, en g énéral hexagonale ou rhom.
boïdale. La g ra n d e u r de ces cellules est trè s -v a riab le . Dans u n certain
nombre de familles elles sont étroites, sinueuses et ren fe rm e n t une
u tric u le p rim o rd ia le très-distincte. Elles sont o rd in a irem e n t colorées
p a r d’abondants g ra in s de chlorophylle v e rte ou ra rem e n t b ru n e . Lorsq
u ’elles sont vides ou à peu près, elles ont u n e grande transparenc e .
La surface des feuilles est g énéralem ent lis s e ; mais dans p lusieurs
genres, elle est hérissée d’u n plus ou moins g ran d nombre d’aspérités
papilleuses. Le contour est u n i dans les feuilles en tiè re s : dans les a u tres
il est crénelé, denté ou denticulé. Certaines feuilles ont le u r limbe
AP PAUÏENAN'I' A U O SU llE DES J IO U S SE S . E TC. 0
lim ité p a r une couche de cellules, minces, allongées, tran sp a ren te s ou
bru n e s, qui constitue un margo distinct. La lame foliaire est tan tô t plane,
ta n tô t concave; parfois ondulée dans le sons de la longueur, ou plisséo
et striée dans celui de la la rg e u r. Elle ne s’a ttén u e jamais en pétiole,
mais souvent embrasse la tige p a r sa p a rtie in fé rieu re, et forme quelquefois
u n e véritable gaine.
Dans u n assez g ran d nombre de feuilles, le m ilieu est occupé p a r une
série de cellules plus allongées qui sim u len t u n e n e rv u re médiane et
que l’on nomme côte. Cette côte a tte in t le sommet de la feuille chez
quelques espèces ; chez d’au tre s elle le dépasse et se prolonge en alêne
ou mucron : on d it alors q u ’elle est excmrente. Souvent aussi la côte
s’évanouit avant le sommet; enfin il lu i a rriv e parfois de se b ifu rq u er;
ou même on voit a p p a ra ître à la base de la feuille deux petites côtes
trè s-courte s. L’épaisseur de la côte est variable. Quand la côte est forte
et raide, elle peut être dentelée à son extrémité, si elle est ex cu rre n te ,
ou su r sa face postérieure. Certaines feuilles sont te rm in é e s p a r un
poil lisse ou hérissé.
L’in sertio n des feuilles su r les tiges et les rameaux est soumise aux
lois de la phyllotaxie. Les dispositions les plus fréquentes sont
ll2 , 2[8, 3[8. La p rem iè re fo u rn it l’apparence d is tiq u e ; mais il est à
rem a rq u e r que le chiffre li2 n ’est pas rig o u reu sem en t exact.
Quelques feuilles sont mu n ie s d ’appendices insérés su r le dos de la
n e rv u re médiane, et qui fig u ren t des espèces d’ailes. Chez d’autres la
p a rtie moyenne de la face su p érieu re est couverte de lames nombreuses
ou de filaments qui la re couvrent en p a rtie ou en totalité.
Sans e n tre r dans le détail des formes q u ’affectent les feuilles, et pour
lesquelles nous emploierons les dénominations usitées en p h an éro g a-
mie, nous devons faire rem a rq u e r que cette forme v a rie a insi que la
g ra n d e u r de l’o rg an e , .suivant la h a u te u r de fin s e rtio n , dans u n assez
g ran d nombre d ’espèces. Les feuilles in fé rieu res diffèrent, en effet, quelquefois
assez notablement des feuilles su p érieu res p o u r que ce caractère
a it de l’importance. Sa différence est sensible su rto u t, et ceci est à
peu près g é n é r a l, p o u r les feuilles q u i c o n stitu en t les bourgeons re n fe
rm an t les organes rep ro d u c teu rs. Ces dernières sont plus larges, plus
courtes, diversement colorées et dentées que les feuilles de la tige. On
les désigne sous le nom de feuilles périchétiales, et l’ensemble du b o u r