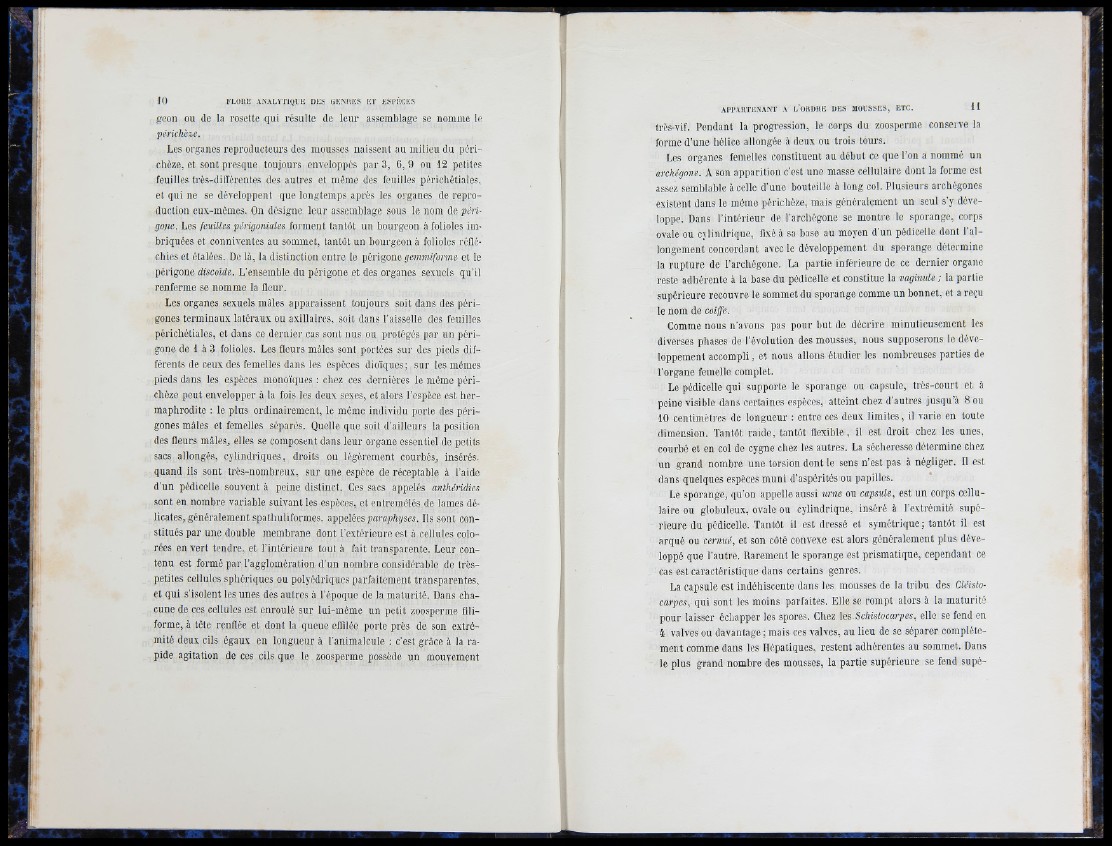
lo l ’LOliE A N A LY T im 'E DUS GE.NIiES ET E S l’ÈGES
gcon OU de la rosette qui r é su lte de leu r assemblage se nomme le
périchize.
Les organes rep ro d u c teu rs des mousses naissent au m ilieu du p é ri-
chèze, et sont presque toujours enveloppés p a r 3, 6, 9 ou 12 petites
feuilles très-différentes des autres et même des feuilles périchétiales.
et qui ne se développent que longtemps après les organes de rep ro duction
eux-mêmes. On désigne le u r assemblage sous le nom de péri-
gone. Les feuilles péngoniales forment tan tô t u n bourgeon à folioles imbriquées
et conniA'entes au sommet, tantôt un bourgeon à folioles réfléchies
et étalées. De là, la distinction e n tre le périgone gemmiforme et le
périgone discoïde. L’ensemble du périgone et des organes sexuels q u'il
renferme se nomme la fleur.
Les organes sexuels mâles apparaissent toujours soit dans des p é ri-
gones te rm in au x latéraux ou axillaires, soit dans l’aisselle des fouilles
périchétiales, et dans ce d e rn ie r cas sont n u s ou protégés p a r u n p é rigone
de 1 à 3 folioles. Les fleurs mâles sont portées su r des pieds différents
de ceux des femelles dans les espèces dioïques; s u r les mêmes
pieds dans les espèces monoïques : chez ces dernières le même p é ri-
chèze peut envelopper à la fois les deux sexes, et alors l’espèce est h e rm
aphrodite ; le plus o rd in a irem en t, le même in d iv id u porte des p é ri-
gones mâles et femelles séparés. Quelle que soit d’a illeu rs la position
des fleurs mâles, elles se composent dans le u r organe essentiel de petits
sacs allongés, cy lin d riq u e s , droits ou légèrement courbés, insérés,
quand ils sont trè s-n om b reu x , su r u n e espèce de réceptable à l’aide
d’u n pédicelle souvent à peine distin c t. Ces sacs appelés anthéridies
sont en nombre variable su iv an t les espèces, et entremêlés de lames délicates,
g énéralement spatlmliformes. appelées parflfi/îj/ses. Ils sont constitués
p a r une double membrane dont l'ex té rieu re est à cellules colorées
en v e rt ten d re , et l’in té rieu re tout à fait transparente. Leur contenu
est formé p a r l’agglomération d’un nombre considérable de trè s -
petites cellules sphériques ou polyédriques p a rfa item en t tran sp aren tes,
et qui s’isolent les unes des autres à l ’époque de la m a tu rité . Dans chacune
de ces cellules est enroulé su r lu i-m êm e u n p e tit zoosperme filiforme,
à tète renflée et dont la queue effilée porte près de son extrém
ité deux cils égaux en lo n g u eu r à l’anima lcule : c’est grâce à la ra pide
agitation de ces cils que le zoosperme possède un mouvement
A l'l’AKTE.NA-NT A l/O B U llE DES MOUSSES, E TC. I l
très-vif. Pendant la progression, le corps du zoospcnne conserve la
forme d’une hélice allongée à deux ou trois tours.
Les organes femelles constituent au début ce que l’on a nommé un
archégone. A son ap p aritio n c’est u n e masse cellulaire dont la forme est
assez semblable à celle d’une bouteille à long col. P lusieurs archégones
existent dans le même périchèze, mais g énéralement u n seul s'y développe.
Dans l’in té rie u r de l’archégone se mo n tre le sporange, corps
ovale ou cy lindrique , fixé à sa base au moyen d’un pédicelle dont l’a llongement
concordant avec le développement du sporange détermine
la ru p tu r e de l’arcliégone. La p a rtie in fé rieu re de ce d e rn ie r organe
reste ad hérente à la base du pédicelle et constitue la vagintde ; la p a rtie
sup érieu re recouvre le sommet du sporange comme un bonnet, et a reçu
le nom de coiffe.
Comme nous n ’avons pas p o u r but do d é crire m in u tieu s em en t les
diverses phases de l’évolution des mousses, nous supposerons le développement
a ccom p li, et nous allons é tu d ie r les nombreuses p a rtie s de
l’organe femelle complet.
Le pédicelle qui supporte le sporange ou capsule, trè s -co u rt et à
peine visible dans certaines espèces, a tte in t chez d’autres ju s q u ’à 8 ou
10 centimètres de longueur : e n tre ces deux lim ite s , il varie en toute
dimension. Tantôt ra id e , tan tô t flexible, il est d ro it chez les unes,
courbé et en col de cygne chez les autres. La sécheresse détermine chez
u n g ran d nombre une torsion dont le sens n ’est pas à négliger. Il est
dans quelques espèces m u n i d’aspérités ou papilles.
Le sporange, q u ’on appelle aussi urne ou capsule, est u n corps cellula
ire ou globuleux, ovale ou cylindrique, in séré à l’extrémité supérie
u re du pédicelle. Tantôt il est dressé et sym é triq u e ; ta n tô t il est
arqué ou cermié, et son côté convexe est alors g énéralement plus développé
que l’au tre . Rarement le sporange est p rism a tiq u e , cependant ce
cas est caractéristique dans certains genres.
La capsule est indéhiscente dans les mousses de la trib u des Cléisto-
carpes, q u i sont les moins parfaites. Elle se rom p t alors à la m a tu rité
p o u r laisser échapper les spores. Chez les Schislocarpes, elle se fend en
4 valves ou davantage ; mais ces valves, au lieu de se séparer complètem
en t comme dans les Hépatiques, re s ten t adhérentes au sommet. Dans
le plus g ran d nombre des mousses, la p a rtie su p érieu re se fend supé