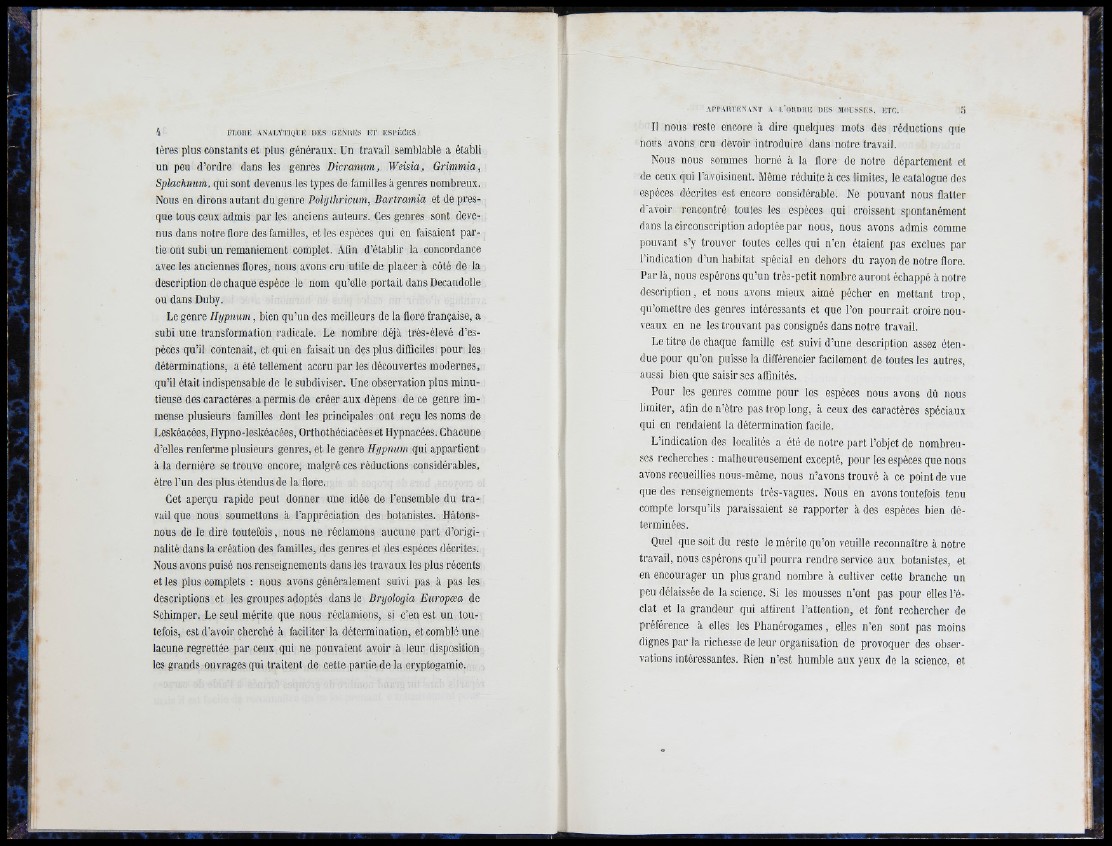
4 PI.OHK ANALYTIQUE DES G EM iE S ET ESPÈCES
tè re s p lu s c o n stan ts et p lu s g é n é ra u x . Un tra v a il semblable a établi
u n peu d ’o rd r e d an s les g en re s D ic ra n um , W e is ia , G r im m ia ,
S p la c h n im , qui sont devenus les types de familles à g en re s n om breux.
Nous en d iro n s a u ta n t d u g en re P o ly th r ic um , B a r tr am ia et de p re s que
to u s ceux admis p a r les a n c ien s au te u rs . Ces g enres sont deven
u s d an s n o tre flore des familles, et les espèces q u i en faisaient p a r tie
ont subi u n rem a n iem en t complet. Afin d ’é ta b lir la concordance
avec les ancien n e s flores, n o u s avons cru utile de p la c e r à côté de la
d esc rip tio n de chaque espèce le nom q u ’elle p o rta it d an s Decandolle
ou d a n s Duby.
Le g e n re H y p n im , bien q u ’un des m e illeu rs de la flore française, a
su b i u n e tra n s fo rm a tio n rad ic a le. Le n om b re déjà trè s-é lev é d ’espèces
q u ’il co n ten ait, et qui en faisait u n des plus difliciles p o u r les
d é te rm in a tio n s , a été te llem en t a ccru p a r les découvertes m o d e rn e s ,
q u ’il é ta it in d isp en sab le de le sub d iv ise r. Une o b s ervation plus m in u tieu
se des c a r a c tè re s a p e rm is de c ré e r a u x dépens de ce g e n re im mense
p lu s ie u rs familles d o n t les p rin c ip a le s o n t re ç u les noms de
Leskéacées, Hypno-leskéacées, O rth o th é c ia cé e se t Hypnacées. C h acu n e
d ’elles ren fe rm e p lu s ieu rs genres, et le g en re H y p n um qui a p p a rtie n t
à la d e rn iè re se tro u v e en co re, m a lg ré ces réd u c tio n s considé rable s,
ê tre l’u n des p lu s é ten d u s de la flore.
Cet ap erçu ra p id e p e u t d o n n e r u n e idée de l ’ensemble d u t r a vail
que n o u s so um etto n s à l ’ap p ré ciatio n des botanistes. H âtons-
n ous de le d ire to u te fo is , nous n e réclamons a u c u n e p a r t d ’o rig in
alité d a n s la c ré atio n des familles, des g en re s et des espèces décrites.
Nous avons puisé nos ren seig n em en ts d an s les tr a v a u x les p lu s ré c en ts
e t les p lu s complets : n o u s avons g é n é ra lem e n t suivi pas à pas les
d e sc riptions e t les g ro u p e s adoptés dans le Bryo lo g ia E u ro poe a de
Schimper. Le seul m é rite q u e nous réclamions, si c’en est u n to u tefois,
est d ’avoir ch erch é à faciliter la d é te rm in a tio n , et comblé u n e
la cu n e r e g re tté e p a r ceux qui ne p o u v a ien t av o ir à le u r disposition
les g ra n d s o uvrage s qui tr a ite n t d e c ette p a rtie d e la cryptogamie.
API’AIiTP.NANT A l.'O R D ilE DES M D fS S E S . ETE. .3
Il n o u s re s te encore à d ire que lq u e s mots des ré d u c tio n s que
nous avons c ru devoir in tro d u ire d an s n o tre trav a il.
Nous n o u s sommes b o rn é à la flore de n o tre d é p a rtem en t et
de ceux qui l ’avoisinent. Même ré d u ite à ces limites, le catalo g u e des
espèces d é crite s est encore considé rable . Ne p o u v an t nous fla tte r
d ’avoir re n c o n tré toutes les espèces qui cro issen t sp o n tan ém en t
dans la c irco n sc rip tio n ad o p té e p a r nous, nous avons adm is comme
p o u v a n t s’y tro u v e r toutes celles qui n ’en é ta ien t p a s exclues p a r
l’indication d ’u n h a b ita t spécial en d eh o rs du ray o n de n o tre flore.
P a r là, nous espérons q u ’u n tr è s -p e tit n om b re a u ro n t échappé à n o tre
d e s c rip tio n , et nous avons mieux aimé p é ch e r en m e tta n t t ro p ,
q u ’om e ttre des g en re s in té re s san ts et q u e l’on p o u r r a it c ro ire n o u veaux
en ne les tro u v a n t p a s consignés dans n o tre trav a il.
Le titr e de ch aq u e famille est suivi d ’u n e d e sc rip tio n assez é te n d
u e p o u r q u ’on puisse la différencier facilement de to u te s les a u tre s,
au ss i bien q u e s a is ir ses affinités.
P o u r les gen re s comme p o u r les espèces nous avons dû nous
lim iter, afin de n ’ê tre pas tro p long, à ceux des c a ra c tè re s sp éc iau x
q u i en re n d a ie n t la d é te rm in a tio n facile.
L ’in d ic a lio n des localités a été de n o tre p a r t l’objet de n om b re u ses
re ch erch e s : m a lh e u re u s em e n t excepté, p o u r les espèces que nous
avons re cueillie s nous-môme, n o u s n ’avons tro u v é à ce p o in t de vue
que des re n s eig n em e n ts trè s -v ag u e s . Nous en avons toutefois tenu
compte lo rsq u ’ils p a ra iss a ien t se r a p p o rte r à des espèces b ien d é te
rm in é e s.
Quel que soit d u re ste le m é rite q u ’on veuille re c o n n a ître à n o tre
tra v a il, nous esp é ro n s q u ’il p o u r r a re n d r e service a u x botanistes, et
en e n c o u rag e r u n p lu s g r a n d n om b re à cu ltiv e r cette b ra n c h e un
peu délaissée de la science. Si les mousses n ’o n t pas p o u r elles l ’é cla
t et la g ra n d e u r q u i a ttire n t l’a tte n tio n , et font re c h e rch e r de
pré fé re n c e à elles les P h a n é ro g am e s , elles n ’e n sont pas moins
dignes p a r la ric h e ss e de le u r o rg an is a tio n d e p ro v o q u e r des o b s e rvations
in té re s san te s. Rien n ’est h um b le au x yeux de la science, et