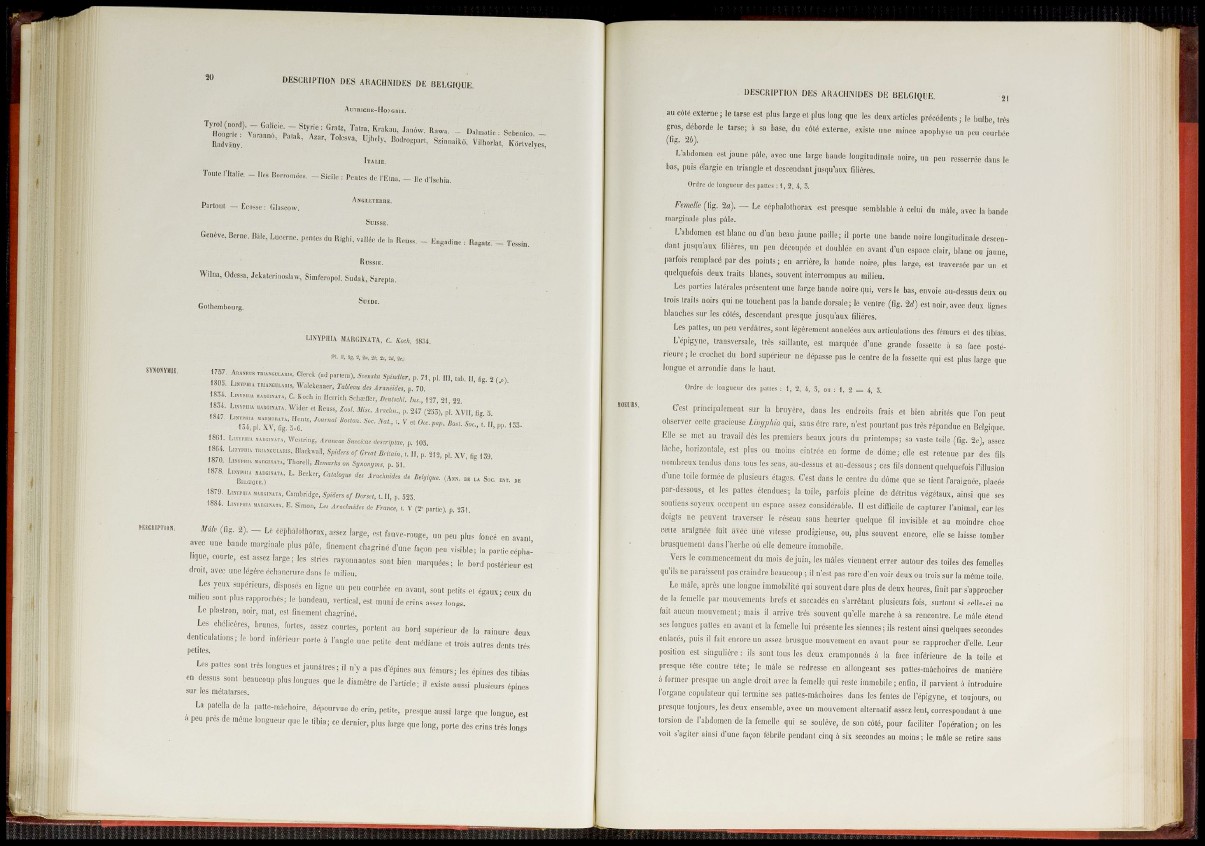
DESCHI [>r I ON.
DESCKIPriOiN DES AIÌACHIVIDES DE BELGIQUE.
AU T R I C I I E -HO.NGHIE.
ITALIE.
T o m e l ' i t a n e . - I l e s B o r r o m é e s . - S i c i l . : P e n t e . s de l ' E t n a . - I l e d ' i s e h i a .
r , . . ANGLETERRE,
F a r t o d I — E c o s s e : ( i l f i s e o w .
S D I S S E .
G e n è v e . B e r n e . B à i e , L u o e r n e . p e n t e s d u H i g h ! , v a l l é e de IH R e « « . - E n ^ a d i n e : R a g a u , - T e s s i » .
RUSSIE.
W i l n a , O d e s s a , J e k a t e r i n o s l a w , S i m f e r o p o l . S u d a k , S a r e p I
G o t h e o i b o u r g .
SUÈDE.
UNYPHIA UAhGINATA, C. Koch, i834.
IPl. Il, fig. s. 2a, 26. Se, 2d. 2î.)
1757. Cl e r c k ( . . I p . n e m ) , p. 7 , , n i , , a b . I l , fig 2
180b. L INVPH. I TRUNGULvnis, Walckenacr, Tableau des Araneides, p. 70.
1834. Li^vPm mncmiA, C. Kocl. in Ilernch Schieiïei^ ,27 21 22
18o4. L.NVP,,,. M.nc)«..TA, Wi d e r et Re u s s , Zoo/. .W. c Arackn., p. 2 4 7 p'i. XVI I , l i . S
1861. Li.vïPii,.v .„AnciN.iTv We s i r ing, Araneae Suecicae dcscripiae, p, 105.
1 8 C 4 L I N V P U U R N U N C M R I I S , p| XV
1870. U>yi.|tu,uttcmT.»,Thorell,ilemarfa on Synonyme p 51 ' ' » "
- - . . .
1879. I m K MARGiNm, Cambr idge , Spiders of Dorset, t. I I , p. 5 2 3
1884. .uncmATA, E. S imo . , Los Arachnides de France, i. V (2- partie), p. 2 5 1 .
ffig. 2) . ^ Le c épha iolhor ax, asse^ large, nst fauve-rouge , un peu pl... foncé en avant
avec . n e b a n d , marginale plus pàle, finement chagr iné d'une façon peu visible, la pa r . i e c épha ^
-que, courte, est assez l a rge ; les stries rayoniianles sont bien ma r q u é e s ; le bord postérieur es.
dro)(, avec une légère é chauc rur e dans le milieu.
Les yeux supérieurs, disposés en ligne un peu courbé e en avant, sont petits e. é g a u x ; ceux du
milieu sont plus rapproché,.; le bande au, vertical, est muni d^ crins assez longs.
Le plasiron, noir, mat, est finement c h a g r i n é .
Les chélicères, brunes, fortes, assez courtes, portent au bord supérieur de la r a i n u r e deux
denticulations; le bord inf é r i eur por.e à l'angle une petite dent médi ane et trois au, r e s dents très
Les paltes sont très longues et j a u n â t r e s ; il „ > a pas d'épines aux f ému r s ; les épines des libias
on essus sont beaucoup plus longues que le diamètre de l'article; il exisie aussi plusieurs épines
sur les métatarses. '
La pa.ella de la patte-mâchoire, dépourvue de crin, petite, pr e sque aussi large longue, est
a peu près de même longueur que le libia; ce de rni e r , plus large que long, porte des crins t r i b n g s
DESCRIPTION DES ARACHNIDES DE RELGIQUE. g,
au côté externe ; le tarse est plus large et plus long que les deux arlicles pr é c édent s ; le bulbe très
gros, déhorde le t ar s e; à sa base, du côté ext e rne , exisie une mince apophys e un peu cou'rhce
(fig.
L'abdomen est j a u n e pâle, avec un e large bande longitudinale noire, un peu resserrée dans le
bas, puis élargie en triangle et descendant jusqu' aux filières.
Ordre de longueur despaitcs : 1, 2, i , 5.
Femelle (fig. '2a). -- Le céphalothorax est presque semblable à celui du màle, avec la bande
marginale plus pâle.
L'abdomen est blanc ou d'un beau j a u n e paille; il porte une bande noire longitudinale descendant
jus(|u'aux (ilière.s, un peu découpée et doublée en avant d'un espace clair, blanc ou j a u n e
parfois r empl a c é par des point s ; en arrière, la b a n d e noire, plus large, est traversée par un e!
quelquefois deux traits blancs, souvent interronipus au milieu.
Les parlies latérales présentent ime large bande noire qui, ve r s le bas, envoie au-dessus deux ou
trois trails noirs qui ne louchent pas la bande dor s a l e ; le venire (fig. est noir, avec deux lignes
blanches sur les côlés, descendant presque jusqu' aux filières.
Les pattes, un peu verdâtres, sont légèrement annelées aux articulations des f émurs et des tibias.
L'épigyne, transversale, très saillante, est ma rqué e d'une gr ande fossette à sa face postér
i e u r e ; le crochet du bord supé r i eur ne dépasse pas le centre de la fossette qui est plus large <jue
longue et a r rondi e dans le haut.
Ordre <lc longueur des panes ; 1, 2, i , 5, ou : 1, 2 = 4., 5.
C'esl principalement sur la b r u y è r e , dans les endroits frais et bien abrités que l'on peut
observer cette gracieuse Linyphia qui, s ans être rare, n'est pourtant pas très r épandue en Belgique.
Elle se me t au travail dés les premiers beaux j o u r s du p r i n t emp s ; sa vaste toile (fig. 2e), assez
lâche, borizonlale, est plus ou moins cintrée en forme de d ôme ; elle est ret enue par des fils
nombreux tendus dans tous les sens, au-dessus et au-dessous ; ces fils donnent quelquefois l'illusion
d'une toile formé e de plusieurs étages. C'est dans le centre du dôme que se tient l'araignée, placée
par-dessous, et les paltes é t endue s ; la toile, parfois pleine de détritus végétaux, ainsi que ses
souliens soyeux occupent un espace assez considérable. Il est difficile de c aptur e r l'animal, car les
doigts ne peuvent traverser le réseau sans heur t e r que lque fil invisible et au moindre choc
cette araignée fuit avec une vitesse prodigieuse, ou, plus souvent encore, elle se laisse tombe r
brusquement dans l'herbe où elle demeur e immobile.
Vers le c omme n c eme n t du mois de juin, les males viennent e r r e r autour des toiles des femelles
qu'ils ne paraissent pas c r a indr e be aucoup ; il n'est pas rare d'en voir deux ou trois sur la môme toile.
Le mâle, après une longue immobilité qui souvent d u r e plus de deux heures, finit par s'approcher
de la femelle par mouvement s brefs et saccadés en s'arrètant plusieurs fois, surtout si celle-ci ne
fait aucun mo u v eme n t ; mais il arrive très souveni qu'elle ma r c h e à sa r encont r e . Le màle étend
ses longues pâlies en avant et la femelle lui présente les s i enne s ; ils restent ainsi quelques secondes
enlacés, puis il fait encore un assez brusque mouvement en avant pour se r approche r d'elle. Leur
position est singulière : ils sont tous les deux c r amp o n n é s â la face inférieure de la toile et
presque tête contre t è t e ; le màle se redresse en allongeant ses pattes-mâchoires de manière
à forme r pr e sque un angl e droit avec la femelle qui reste immobil e ; enfin, il parvient à int rodui re
l'organe copulaleur qui termine ses pattes-màchoires dans les fentes de l'épigyne, et toujours, ou
presque toujours , les deux ensemble , avec un mo u v eme n t alternatif assez lent, cor r e spondant à une
torsion de l'abdomen de la femelle qui se soulève, de son côté, pour faciliter l'opération; on les
voit s'agiter ainsi d'une façon fébrile pendant cinq à six secondes au mo i n s ; le mâ l e se retire sans