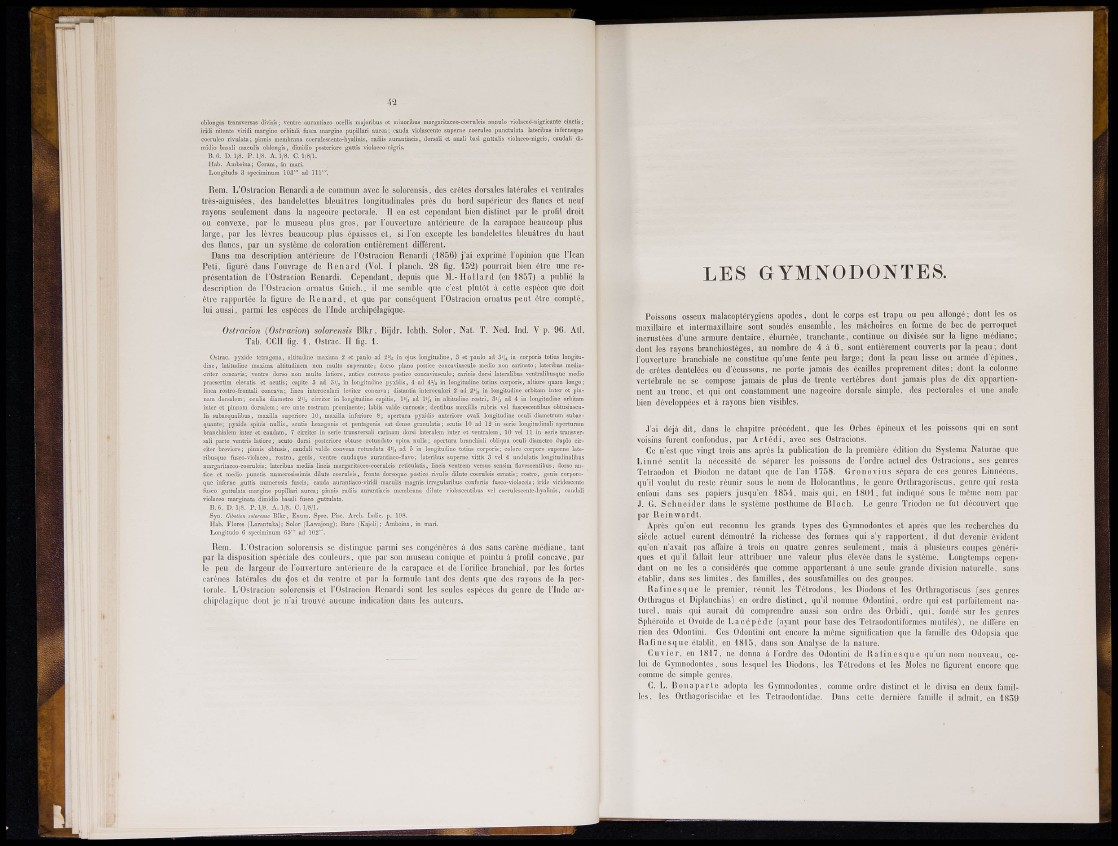
<ibloiigas transversas di;'Ì3Ìs; ventre aurantiaco ocellis iiiajoribus et iiiiiioribus niavga ri tacco-coeru Wis aiiimio vi ulaceo-iiigri conte cinctis;
iridi niteiite viridi inargine orbitali fusca margine pupillari aurea; cauda violasceiito superno cocruleo puiictulata lateribus inferneque
coeruleo rivulata; piiuiis membrana cocrulescente-hyalinis, radiis nurantiacis, dorsali et anali basi guttulis violaceo-nigris, caudali dimid!
o basali maculis oblongìs, dimidio posteriore guttis violaceo-ni gris.
15, 6. D. 1|8. P. 1/8. A. 1/8. C. 1/8/1.
Ilab. Amboina; Corani, in mari.
Longitude 3 speciuiinura 103"' ad 111'".
R e m . L'Oslracion Rcnardi a de commun avec le soloreiisis, des crûtes dorsales latérales el ventrales
t r è s - a i g u i s ó e s , des bandelellcs bleuâtres longitudinales près du bord supérieur des lianes et neuf
r a y o n s seulement dans la nageoire pectorale. Il en esl cependant bien distinct par le profil droit
o u convexe, par le museau plus gros, par l'ouverture antérieure de la carapace beaucoup plus
l a r g e , par les lèvres beaucoup plus épaisses et, si Fon excepte les bandelettes bleuâtres du haut
d e s lianes, par un système do coloi'ation entièrement différent.
D a n s ma description antérieure de l'Osti-acion Uenardi (1850) j'ai exprimé l'opinion que l'Ican
P e t i , figuré dans l'ouvrage de R e n a r d (Vol. I planch. 28 lig. 152) pourrait bien être une rep
r é s e n t a t i o n de rOstracion Renardi. Cependant, depuis que M.-lIollard (en 1857) a publié la
d e s c r i p t i o n de l'Ostracion ornatus Guich., il me semble que c'est plutôt à cette espèce que doit
ê t r e l'apportée la ligure de l l e n a r d , et que par conséquent FOstracion ornatus peut être compté,
l u i aussi, parmi les espèces de l'Inde archipélagique.
Ostradon [Ostradon) solorensis DIkr, Rijdr. Ichth. Solor,
T a b . CCII fig. 1, Ostrac, Il fig, 1.
N a t . T. Ned. Ind. V p. 9G, AU.
Ostrac, pyxide tetragona, altitudine maxima 2 et paulo ad 2»/s in ejus longitudine, 3 et paulo «d 3'/, in corporis totius longitudine,
latitudiae maxima altitudinem non multo superante; dorso plano postica concaviusculo medio non cariiiato; lateribus mediocriter
concavis; ventre dorso non multo latiore, antice convexo postico concaviusculo; carinis dorsi iateralibus ventralibusque medio
praesertim elevatis et acutis; capite 3 ad S'/j in longitudine pysidis, 4 ad 4-/3 in longitudine tolius corporis, altiere quam longo;
linea rostro-frontali concava; linea interoculari leviter concava; distantia interoculari 2 ad 2'/s in longitudine orbitani inter et pinnam
dorsalem; oculis diametro 2'/, circiter in longitudine capitis, l"/j ad l'I, in altitudine rostri, 3i/j ad 4 in longitudine orbitam
inter et pinnam dorsalem; ore anto rostrum prominente; labiis valde carnosis; dentibus maxillis rubris vel fuscesceutibus obtusiusculis
subaequalibus, raaxilla superiore 10, maxilla inferiore 8; apertura pyxidis anteriore ovali longitudine oculi dianietruni subaequajite;
pyxide spinis nullis, scutis liesagonis et pentagonis -sat dense granulatis; scutis 10 ad 12 in serie longitudinali aperturam
branchialeni inter et caudam, 7 circiter in serie transversali cariuam dorsi lateralem inter et ventralem, 10 vel 11 in serie transversali
parte ventris latiore; scuto dorsi posteriore obtuse rotundato spina nulla; apertura brancliiali obliqua oculi diametro duplo circitov
breviore; pinnis obtusis, caudali valde convexa rotundata 4i/, ad 5 in longitudine totius corporis; colore corpore superne lateribusque
fuse0-violaceo, rostro, genis, ventre caudaque aurantiaco-flavo; lateribus superne vittis 3 vel 4 undulatis longitudinalibus
argaritaceo-coeruleis; lateribus mediis lineis marga ri tacco-coerulei s reticulatis, lineis ventrem versus sensim flavesceutibus, dors'
tico et medio punctis numerosissimis dilute coeraleis, fronte dorsoque postice vivulis dilute coerulois ornatisi rostro, genis corporcque
inferne guttis numerosis fuscis; canda aurantiaco-viridi maculis inagnis irregulai'iiius confertis fusco-vio 1 aceis ; iride viridcscente
fusco guttulata margina pupillari aurea; pinnis radiis aurantiacis membrana dilute violascentibus voi coerulcsccnte-byalinis, caudali
violaceo marginata dimidio basali fusco guttulata,
B.6. D, 1/8. P. 1(8. A. 1/8. C. 1/8/1.
Syn. Cìboiion sóbrense BIkr, Enum. Spec. Pise, Ardi, Indie, p. 198.
Ilab. Flores (Larantuka); Solor (Lawajong); Buru (Kajeli) ; Amboina, in mari.
Longitude 6 speciminum 65"' ad 102"'.
Rem. 1/Ostracion solorensis se distingue panni ses congénères à dos sans carène médiane, tant
p a r la disposition spéciale des couleurs, (juc par son museau conitiue et pointu à profil concave, par
l e peu de largeur de l'ouverture antérieure do la carapace et de l'orifice branchial, par les fortes
c a r è n e s latérales du dos et du venire et par la formule tant des dents que des rayons de la pecl
o r a l e . L'Ostracion solorensis et FOstracion Henardi sont les seules espèces du genre de l'Inde arc
h i p é l a g i ( i u c dont je n'ai tj'ouvé aucune indication dans les auteurs.
LES GYMNODONTES.
P o i s s o n s osseux malacoptérygiens apodes, dont le corps est trapu ou peu allongé ; dont les os
m a x i l l a i r e et intermaxillaire sont soudés ensemble, les mâchoires en forme de bec de perroquet
i n c r u s t é e s d'une armure dentaire, éburnéc, tranchante, continue ou divisée sur la ligne médiane;
d o n t les rayons branchiostèges, au nombre de 4 à G, sont entièrement couverts par la peau; dont
l ' o u v e r t u r e branchiale ne constitue qu'une fente peu large; dont la peau lisse ou armée d'épines,
d e crêtes dentelées ou d'écussons, ne porte jamais des écailles proprement dites; dont la colonne
v e r t é b r a l e ne se compose jamais de plus de trente vertèbres dont jamais plus de dix appartienn
e n t au tronc, et qui ont constamment une nageoire dorsale simple, des pectorales et une anale
b i e n développées et à rayons bien visibles.
J ' a i déjà dit, dans le chapitre précédent, que les Orbes épineux et les poissons qui en sont
v o i s i n s furent confondus, par A r t é d i , avec ses Ostracions.
Ce n'est que vingt trois ans après la publication de la première édition du Systema Naturae que
L i n n é sentit la nécessité de séparer les poissons de l'ordre actuel des Ostracions, ses genres
T e t r a o d o n et Diodon ne datant que de Fan 1758. Gronovius sépara de ces genres Linnéens,
q u ' i l voulut du reste l'éunir sous le nom de llolocanthus, le genre Orthragoriscus, genre qui resta
enfoui dans ses papiers jusqu'en 1854, mais qui, en 1801, fut indiqué sous lo même nom par
J . G. S c h n e i d e r dans le système posthume de Bloch. Le genre Triodon ne fut découvert que
p a r Reinwardt.
A p r e s qu'on eut reconnu les grands types des Gymnodontes et après que les recherches du
s i è c l e actuel eurent démontré la richesse des formes qui s'y rapportent, il dut devenir évident
q u ' o n n'avait pas affaire à trois ou quatre genres seulement, mais à plusieurs coupes génériq
u e s et qu'il fallait leur attribuer une valeur plus élevée dans le système. Longtemps cependant
on ne les a considérés que comme appartenant à une seule grande division naturelle, sans
é t a b l i r , dans ses limites, des familles, des sousfamilles ou des groupes.
R a f i n e s i i u e le premier, réunit les Tétrodons, les Diodons et les Orthragoriscus (ses genres
O r l h r a g u s et Diplanchias') en ordre distinct, qu'il nomme Odontini, ordre qui est parfaitement nat
u r e l , mais qui aurait du comprendre aussi son ordre des Orbidi, qui, fondé sur les genres
S p h é r o ï d e et Ovoïde de L a c é p è d e (ayant pour base des Tetraodontiformes mutilés), ne dilTère en
r i e n des Odontini. Ces Odontini ont encore la même signification (¡ue la famille des Odopsia que
R a f i n e s q u c établit, en 1815, dans son Analyse de la nature.
C u v i e r , en 1817, ne donna à l'ordre des Odontini de R a l i n e s q u e qu'un nom nouveau, celui
de Gymnodontes, sous lesqucl les Diodons, les Tétrodons et les Moles ne figurent encore que
comme de simple genres.
C. L. R o u a p a r t e adopla les Gymnodontes, comme ordre distinct et le divisa en deux famill
e s , les Ortliagoriseidae cl les Tetraodonlidae. Dans celle dernière famille il admit, en 1859