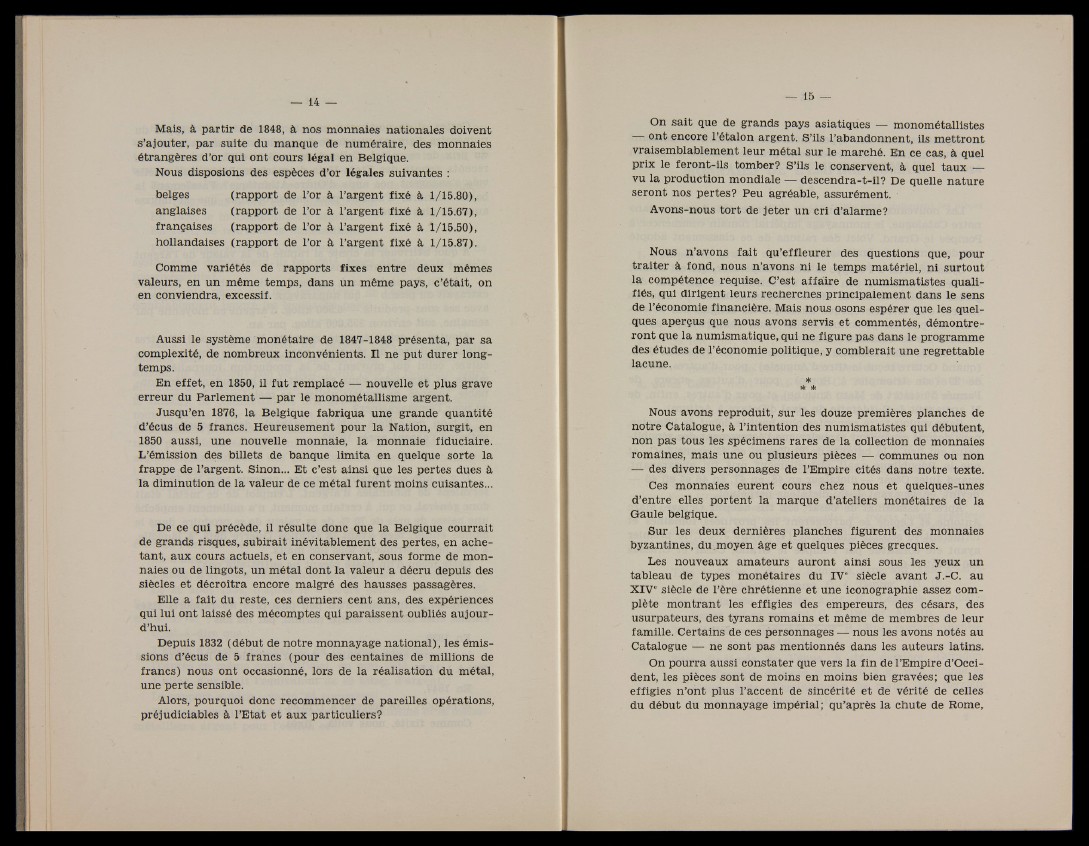
Mais, à pa rtir de 1848, à nos monnaies nationales doivent
s ’ajouter, par suite du manque de numéraire, des monnaies
étrangères d’or qui ont cours légal en Belgique.
Nous disposions des espèces d’or légales suivantes :
belges (rapport de l’or à l’argent fixé à 1/15.80),
anglaises (rapport de l’or à l ’argent fixé à 1/15.67),
françaises (rapport de l’or à l’argent fixé à 1/15.50),
hollandaises (rapport de l’or à l’argent fixé à 1/15.87).
Comme variétés de rapports fixes entre deux mêmes
valeurs, en un même temps, dans un même pays, c’était, on
en conviendra, excessif.
Aussi le système monétaire de 1847-1848 présenta, par sa
complexité, de nombreux inconvénients. Il ne put durer longtemps.
En effet, en 1850, il fu t remplacé — nouvelle et plus grave
erreur du Parlement — par le monométallisme argent.
Jusqu’en 1876, la Belgique fabriqua une grande quantité
d’écus de 5 francs. Heureusement pour la Nation, surgit, en
1850 aussi, une nouvelle monnaie, la monnaie fiduciaire.
L’émission des billets de banque limita en quelque sorte la
frappe de l’argent. Sinon... Et c’est ainsi que les pertes dues à
la diminution de la valeur de ce métal fu ren t moins cuisantes...
De ce qui précède, il résulte donc que la Belgique courrait
de grands risques, subirait inévitablement des pertes, en achetan
t, aux cours actuels, et en conservant, sous forme de monnaies
ou de lingots, un métal dont la valeur a décru depuis des
siècles e t décroîtra encore malgré des hausses passagères.
Elle a fa it du reste, ces derniers cent ans, des expériences
qui lui ont laissé des mécomptes qui paraissent oubliés aujourd’hui.
Depuis 1832 (début de notre monnayage national), les émissions
d’écus de 5 francs (pour des centaines de millions de
francs) nous ont occasionné, lors de la réalisation du métal,
une perte sensible.
Alors, pourquoi donc recommencer de pareilles opérations,
préjudiciables à l’E ta t et aux particuliers?
On sa it que de grands pays asiatiques — monométallistes
— ont encore l’étalon argent. S’ils l’abandonnent, ils m e ttront
vraisemblablement leur métal sur le marché. En ce cas, à quel
prix le feront-ils tomber? S’ils le conservent, à quel taux —
vu la production mondiale — descendra-t-il? De quelle nature
seront nos pertes? Peu agréable, assurément.
Avons-nous to rt de je te r un cri d’alarme?
Nous n ’avons fa it qu’effleurer des questions que, pour
tra ite r à fond, nous n ’avons ni le temps matériel, ni surtout
la compétence requise. C’est affaire de numismatistes qualifiés,
qui dirigent leurs recherches principalement dans le sens
de l’économie financière. Mais nous osons espérer que les quelques
aperçus que nous avons servis e t commentés, démontrero
n t que la numismatique, qui ne figure pas dans le programme
des études de l’économie politique, y comblerait une regrettable
lacune.
* **
Nous avons reproduit, sur les douze premières planches de
notre Catalogue, à l’intention des numismatistes qui débutent,
non pas tous les spécimens rares de la collection de monnaies
romaines, mais une ou plusieurs pièces — communes ou non
— des divers personnages de l’Empire cités dans notre texte.
Ces monnaies eurent cours chez nous et quelques-unes
d’entre elles portent la marque d’ateliers monétaires de la
Gaule belgique.
Sur les deux dernières planches figurent des monnaies
byzantines, du .moyen âge e t quelques pièces grecques.
Les nouveaux amateurs auront ainsi sous les yeux un
tableau de types monétaires du IVe siècle avant J.-C. au
XIVe siècle de l’ère chrétienne et une iconographie assez complète
mon tran t les effigies des empereurs, des césars, des
usurpateurs, des tyrans romains et même de membres de leur
famille. Certains de ces personnages — nous les avons notés au
Catalogue — ne sont pas mentionnés dans les auteurs latins.
On pourra aussi constater que vers la fin de l’Empire d’Occi-
dent, les pièces sont de moins en moins bien gravées; que les
effigies n ’ont plus l’accent de sincérité e t de vérité de celles
du début du monnayage impérial; qu’après la chute de Rome,