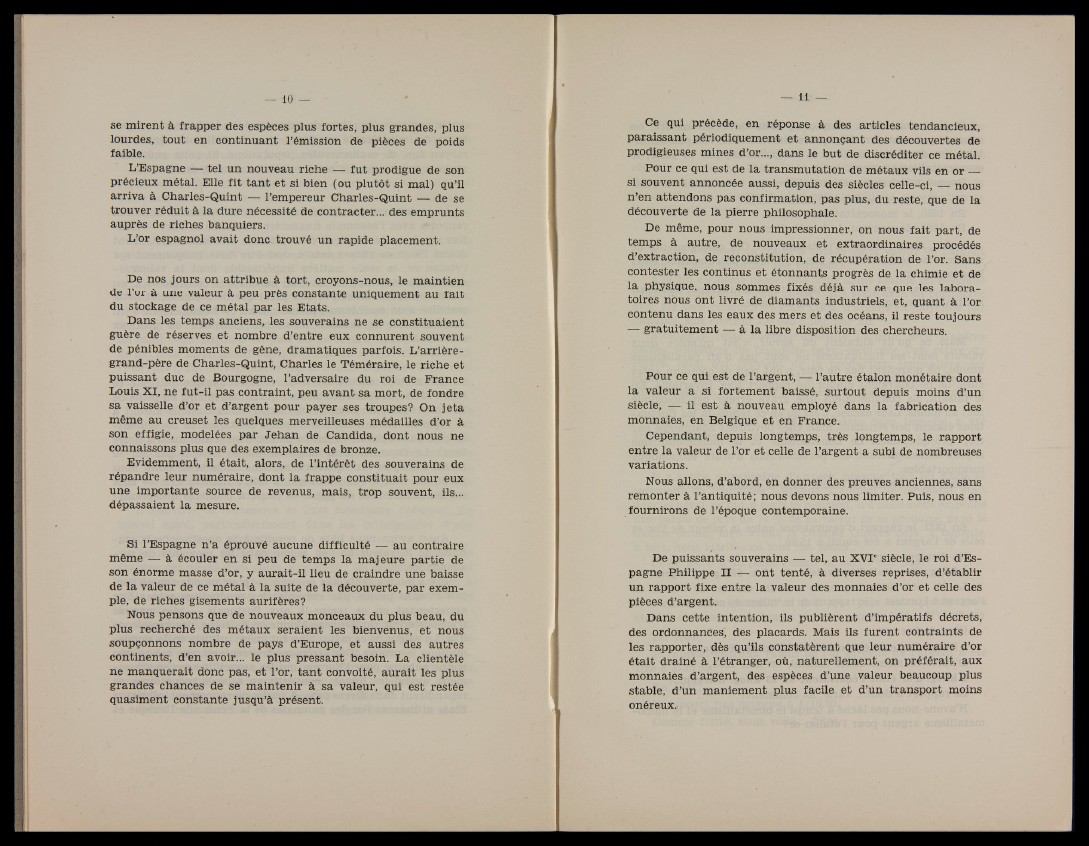
se mirent à frapper des espèces plus fortes, plus grandes, plus
lourdes, tout en continuant l’émission de pièces de poids
faible.
L’Espagne — tel un nouveau riche — fu t prodigue de son
précieux métal. Elle fit ta n t e t si bien (ou plutôt si mal) qu’il
arriva à Charles-Quint — l’empereur Charles-Quint — de se
trouver réduit à la dure nécessité de contracter... des emprunts
auprès de riches banquiers.
L’or espagnol avait donc trouvé un rapide placement.
De nos jours on attribue à tort, croyons-nous, le maintien
de l’or à une valeur à peu près constante uniquement au fa it
du stockage de ce métal pa r les Etats.
Dans les temps anciens, les souverains ne se constituaient
guère de réserves e t nombre d’entre eux connurent souvent
de pénibles moments de gêne, dramatiques parfois. L’arrière-
grand-père de Charles-Quint, Charles le Téméraire, le riche et
puissant duc de Bourgogne, l’adversaire du roi de France
Louis XI, ne fut-il pas contraint, peu av an t sa mort, de fondre
sa vaisselle d’or e t d’argent pour payer ses troupes? On je ta
même au creuset les quelques merveilleuses médailles d’or à
son effigie, modelées par Jeh an de Candida, dont nous ne
connaissons plus que des exemplaires de bronze.
Evidemment, il était, alors, de l’in té rê t des souverains de
répandre leur numéraire, dont la frappe constituait pour eux
une importante source de revenus, mais, trop souvent, ils...
dépassaient la mesure.
Si l’Espagne n ’a éprouvé aucune difficulté — au contraire
même — à écouler en si peu de temps la majeure partie de
son énorme masse d’or, y aurait-il lieu de craindre une baisse
de la valeur de ce métal à la suite de la découverte, par exemple,
de riches gisements aurifères?
Nous pensons que de nouveaux monceaux du plus beau, du
plus recherché des métaux seraient les bienvenus, e t nous
soupçonnons nombre de pays d’Europe, e t aussi des autres
continents, d’en avoir... le plus pressant besoin. La clientèle
ne manquerait donc pas, et l’or, ta n t convoité, au ra it les plus
grandes chances de se maintenir à sa valeur, qui est restée
quasiment constante jusqu’à présent.
Ce qui précède, en réponse à des articles tendancieux,
paraissant périodiquement e t annonçant des découvertes de
prodigieuses mines d’or..., dans le but de discréditer ce métal.
Pour ce qui est de la transmutation de métaux vils en or —
si souvent annoncée aussi, depuis des siècles celle-ci, — nous
n ’en attendons pas confirmation, pas plus, du reste, que de la
découverte de la pierre philosophale.
De même, pour nous impressionner, on nous fa it part, de
temps à autre, de nouveaux e t extraordinaires procédés
d’extraction, de reconstitution, de récupération de l’or. Sans
contester les continus e t étonnants progrès de la chimie et de
la physique, nous sommes fixés déjà sur ce que les laboratoires
nous ont livré de diamants industriels, et, quant à l’or
contenu dans les eaux des mers et des océans, il reste toujours
— gratuitement — à la libre disposition des chercheurs.
Pour ce qui est de l’argent, — l’autre étalon monétaire dont
la valeur a si fortement baissé, surtout depuis moins d’un
siècle, — il est à nouveau employé dans la fabrication des
monnaies, en Belgique e t en France.
Cependant, depuis longtemps, très longtemps, le rapport
entre la valeur de l’or e t celle de l’argent a subi de nombreuses
variations.
Nous allons, d’abord, en donner des preuves anciennes, sans
remonter à l’antiquité; nous devons nous limiter. Puis, nous en
fournirons de l’époque contemporaine.
De puissants souverains — tel, au XVIe siècle, le roi d’Espagne
Philippe II — on t tenté, à diverses reprises, d’établir
un rapport fixe entre la valeur des monnaies d’or et celle des
pièces d’argent.
Dans cette intention, ils publièrent d’impératifs décrets,
des ordonnances, des placards. Mais ils fu ren t contraints de
les rapporter, dès qu’ils constatèrent que leur numéraire d’or
é ta it drainé à l’étranger, où, naturellement, on préférait, aux
monnaies d’argent, des espèces d ’une valeur beaucoup plus
stable, d’un maniement plus facile e t d’un transport moins
onéreux.