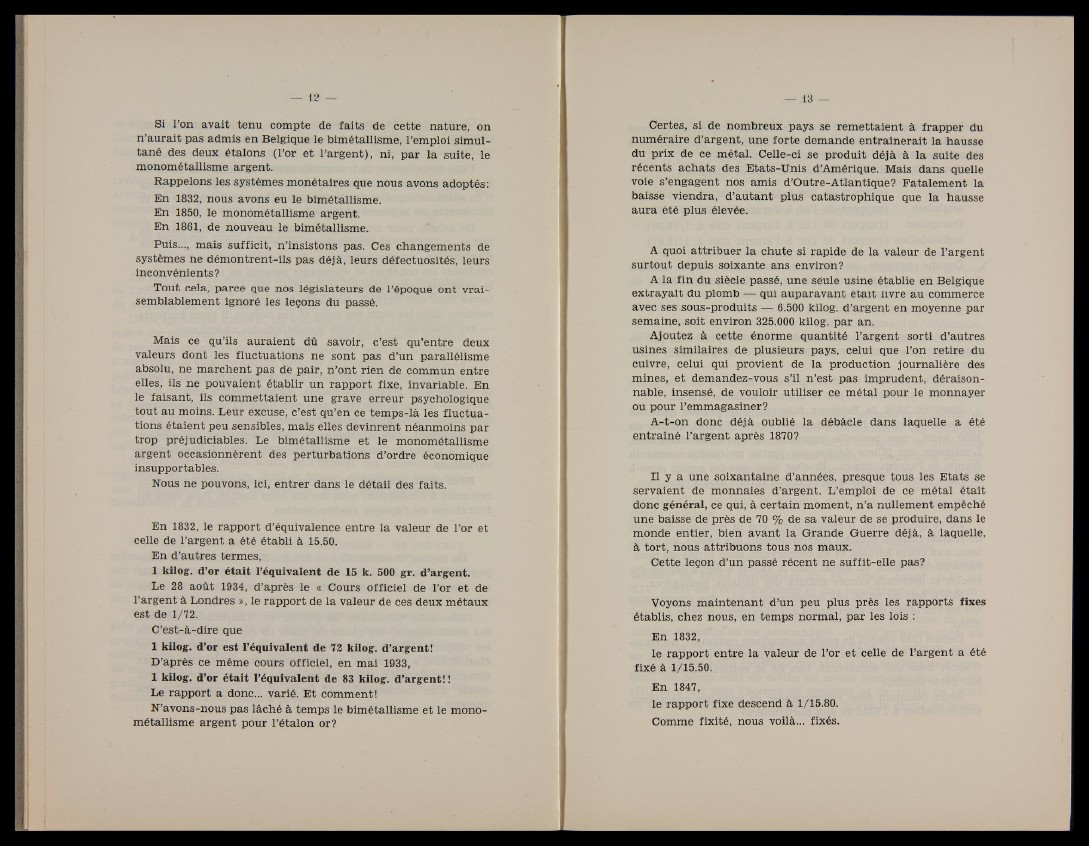
Si l’on avait tenu compte de faits de cette nature, on
n ’au ra it pas admis en Belgique le bimétallisme, l’emploi simultané
des deux étalons (l’or et l’argent), ni, par la suite, le
monométallisme argent.
Rappelons les systèmes monétaires que nous avons adoptés :
En 1832, nous avons eu le bimétallisme.
En 1850, le monométallisme argent.
En 1861, de nouveau le bimétallisme.
Puis..., mais sufficit, n ’insistons pas. Ces changements de
systèmes ne démontrent-ils pas déjà, leurs défectuosités, leurs
inconvénients?
Tout cela, parce que nos législateurs de l’époque ont vraisemblablement
ignoré les leçons du passé.
Mais ce qu’ils auraient dû savoir, c’est qu’entre deux
valeurs dont les fluctuations ne sont pas d’u n parallélisme
absolu, ne ma rchent pas de pair, n ’ont rien de commun entre
elles, ils ne pouvaient établir un rapport fixe, invariable. En
le faisant, ils commettaient une grave erreur psychologique
tout au moins. Leur excuse, c’est qu’en ce temps-là les fluctuations
étaient peu sensibles, mais elles devinrent néanmoins par
trop préjudiciables. Le bimétallisme et le monométallisme
argent occasionnèrent des perturbations d’ordre économique
insupportables.
Nous ne pouvons, ici, entre r dans le détail des faits.
En 1832, le rapport d’équivalence entre la valeur de l’or et
celle de l ’argent a été établi à 15.50.
En d’autres termes,
1 kilog. d’or était l’équivalent de 15 k. 500 gr. d’argent.
Le 28 août 1934, d’après le « Cours officiel de l’or e t de
l’argent à Londres », le rapport de la valeur de ces deux métaux
est de 1/72.
C’est-à-dire que
1 kilog. d’or est l’équivalent de 72 kilog. d’argent!
D’après ce même cours officiel, en mai 1933,
1 kilog. d’or était l’équivalent de 83 kilog. d’argent!!
Le rapport a donc... varié. Et comment!
N’avons-nous pas lâché à temps le bimétallisme et le monométallisme
argent pour l’étalon or?
Certes, si de nombreux pays se reme tta ient à frapper du
numéraire d’argent, une forte demande entra în e ra it la hausse
du prix de ce métal. Celle-ci se produit déjà à la suite des
récents achats des Etats-Unis d’Amérique. Mais dans quelle
voie s’engagent nos amis d’Outre-Atlantique? Fatalement la
baisse viendra, d’a u ta n t plus catastrophique que la hausse
aura été plus élevée.
A quoi a ttribuer la chute si rapide de la valeur de l’argent
surtout depuis soixante ans environ?
A la fin du siècle passé, une seule usine établie en Belgique
extrayait du plomb — qui auparavant é tait livré au commerce
avec ses sous-produits — 6.500 kilog. d’argent en moyenne par
semaine, soit environ 325.000 kilog. par an.
Ajoutez à cette énorme quantité l’argent sorti d’autres
usines similaires de plusieurs pays, celui que l’on retire du
cuivre, celui qui provient de la production journalière des
mines, et demandez-vous s ’il n ’est pas imprudent, déraisonnable,
insensé, de vouloir utiliser ce métal pour le monnayer
ou pour l’emmagasiner?
A-t-on donc déjà oublié la débâcle dans laquelle a été
entraîné l’argent après 1870?
Il y a une soixantaine d’années, presque tous les Etats se
servaient de monnaies d’argent. L’emploi de ce métal était
donc général, ce qui, à certain moment, n ’a nullement empêché
une baisse de près de 70 % de sa valeur de se produire, dans le
monde entier, bien avant la Grande Guerre déjà, à laquelle,
à tort, nous attribuons tous nos maux.
Cette leçon d’un passé récent ne suffit-elle pas?
Voyons ma in ten an t d’un peu plus près les rapports fixes
établis, chez nous, en temps normal, par les lois :
En 1832,
le rapport entre la valeur de l’or e t celle de l’argent a été
fixé à 1/15.50.
En 1847,
le rapport fixe descend à 1/15.80.
Comme fixité, nous voilà... fixés.