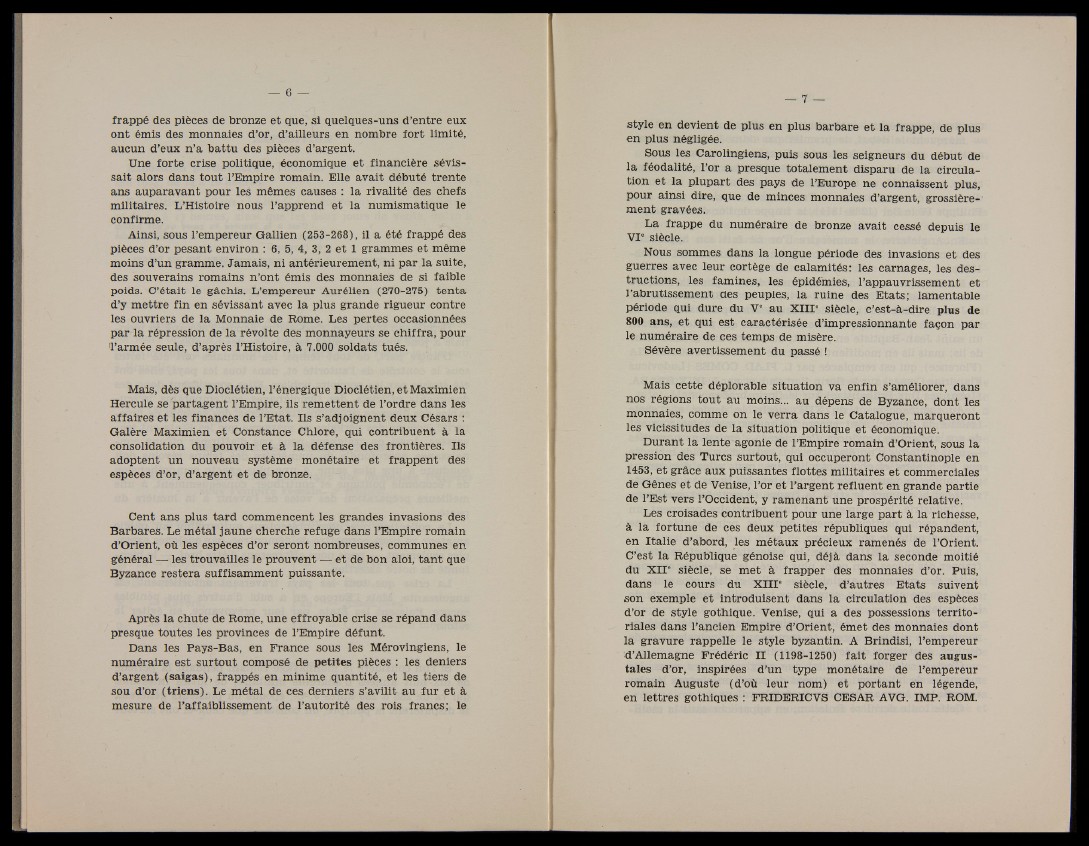
frappé des pièces de bronze et que, si quelques-uns d’entre eux
ont émis des monnaies d’or, d’ailleurs en nombre fort limité,
aucun d’eux n ’a b a ttu des pièces d’argent.
Une forte crise politique, économique et financière sévissait
alors dans tout l’Empire romain. Elle avait débuté tren te
ans auparavant pour les mêmes causes : la rivalité des chefs
militaires. L’Histoire nous l’apprend e t la numismatique le
confirme.
Ainsi, sous l’empereur Gallien (253-268), il a été frappé des
pièces d’or pesant environ : 6, 5, 4, 3, 2 e t 1 grammes e t même
moins d’un gramme. Jamais, ni antérieurement, ni par la suite,
des souverains romains n ’on t émis des monnaies de si faible
poids. C’é ta it le gâchis. L’empereur Aurélien (270-275) te n ta
d’y mettre fin en sévissant avec la plus grande rigueur contre
les ouvriers de la Monnaie de Rome. Les pertes occasionnées
par la répression de la révolte des monnayeurs se chiffra, pour
'l’armée seule, d’après l’Histoire, à 7.000 soldats tués.
Mais, dès que Dioclétien, l’énergique Dioclétien, e t Maximien
Hercule se partag en t l’Empire, ils rem e tten t de l’ordre dans les
affaires et les finances de l ’Etat. Ils s ’adjoignent deux Césars :
Galère Maximien et Constance Chlore, qui contribuent à la
consolidation du pouvoir e t à la défense des frontières. Ils
adoptent un nouveau système monétaire et frappent des
espèces d’or, d’argent e t de bronze.
Cent ans plus ta rd commencent les grandes invasions des
Barbares. Le métal jaune cherche refuge dans l’Empire romain
d ’Orient, où les espèces d’or seront nombreuses, communes en
général — les trouvailles le prouvent — e t de bon aloi, ta n t que
Byzance restera suffisamment puissante.
Après la chute de Rome, une effroyable crise se répand dans
presque toutes les provinces de l’Empire défunt.
Dans les Pays-Bas, en France sous les Mérovingiens, le
numéraire est surtout composé de petites pièces : les deniers
d’argent (saigas), frappés en minime quantité, et les tiers de
sou d’or (triens). Le métal de ces derniers s ’avilit au fur et à
mesure de l ’affaiblissement de l’autorité des rois francs; le
style en devient de plus en plus barbare e t la frappe, de plus
e n plus négligée.
Sous les Carolingiens, puis sous les seigneurs du début de
la féodalité, l’or a presque totalement disparu de la circulation
et la plupa rt des pays de l’Europe ne connaissent plus,
pour ainsi dire, que de minces monnaies d’argent, grossière-'
m en t gravées.
La frappe du numéraire de bronze avait cessé depuis le
VIe siècle.
Nous sommes dans la longue période des invasions et des
guerres avec leur cortège de calamités: les carnages, les destructions,
les famines, les épidémies, l’appauvrissement et
l’abrutissement des peuples, la ruine des Etats; lamentable
période qui dure du Ve au XIIIe siècle, c’est-à-dire plus de
800 ans, e t qui est caractérisée d’impressionnante façon par
le numéraire de ces temps de misère.
Sévère avertissement du passé !
Mais cette déplorable situation va enfin s’améliorer, dans
nos régions tout au moins... au dépens de Byzance, dont les
monnaies, comme on le verra dans le Catalogue, marqueront
les vicissitudes de la situation politique et économique.
Durant la lente agonie de l’Empire romain d’Orient, sous la
pression des Turcs surtout, qui occuperont Constantinople en
1453, et grâce aux puissantes flottes militaires e t commerciales
de Gênes et de Venise, l’or et l’argent refluent en grande partie
de l’Est vers l’Occident, y ram en an t une prospérité relative.
Les croisades contribuent pour une large p a rt à la richesse,
à la fortune de ces deux petites républiques qui répandent,
en Italie d’abord, les métaux précieux ramenés de l’Orient.
C’est la République génoise qui, déjà dans la seconde moitié
du XIIe siècle, se met à frapper des monnaies d’or. Puis,
dans le cours du X IIIe siècle, d ’autres Etats suivent
son exemple et introduisent dans la circulation des espèces
d’or de style gothique. Venise, qui a des possessions te rrito riales
dans l’ancien Empire d’Orient, émet des monnaies dont
la gravure rappelle le style byzantin. A Brindisi, l’empereur
d’Allemagne Frédéric II (1198-1250) fa it forger des augus-
tales d’or, inspirées d’un type monétaire de l’empereur
romain Auguste (d’où leur nom) et p o rtan t en légende,
en lettres gothiques : FRIDERICVS CESAR AVG. IMP. ROM.