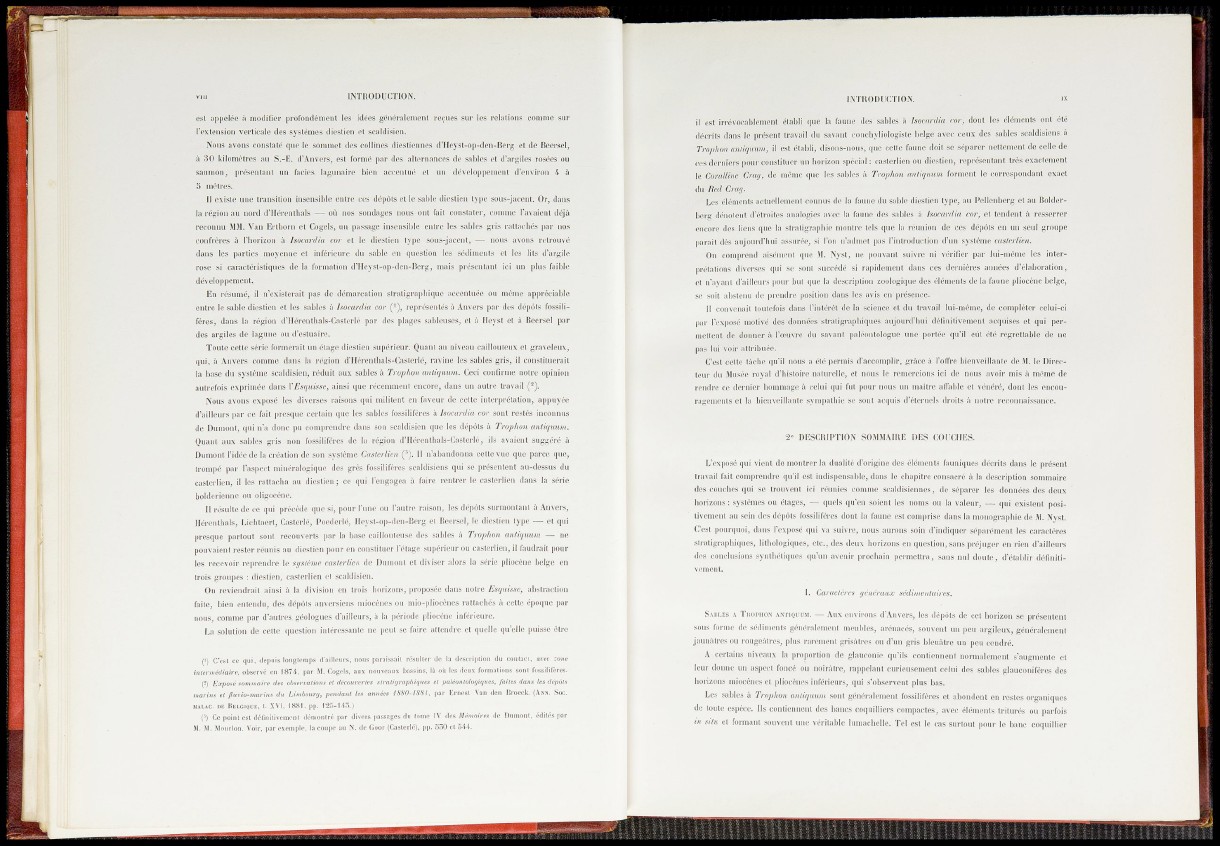
vni INTRODLXTlOlN.
iijipeiee à niotlificr profondémen t les idées généraienieiil reçues sur les relalions conniie sur
IVxlensioii verticale des sys t ème s diestien ol scoklisien.
Nous avons constaté que le somme t des collines diestieiuics d'IIoysl-op-cIcii-Berg et de Beersel,
à 30 kilomètres ¡ni S. -E. d'Anve r s , esl l'orme pai' des a l t e rnanc e s do sables el d'argiles rosées ou
saumon, pr é s ent ant un l'acics l aguua i r c bien a c c entué el un d é v e l o p p eme nt d'envii'on k- à
5 mètres.
Il existe une transition insensible enire ces dépôts et le sahU; diestien ty|)e sous-jaceut. Or, dans
la l'égion au nord d'IIérentlials — où nos sondage s nous ont fait constater, c omme l'avaient déjà
reconnu MM. \ ' a n Er tborn et Cogels, un passage insensible ent r e les sables gris raltacbés par nos
confrères à l'horizon à ¡socurtUu cor el le diestien I) pe s o u s - j a c e n i ,— nous avons r e t rouvé
dans les parlies mo y e n n e et inf é r i eur e du sable en question les sédiments et les lits d'argile
rose si caractérisliqnes de la formation d' I I c}Sl -op-den-Be rg, mais présentant ici un plus faible
développement.
En r é sumé , il n'existerait pas de démar cat ion slratigrapliique accentuée ou même ap|)réciable
e n t re le sable diestien et les sables à hocurdiu cor ( ' ) , r epr é s ent é s à Anve r s pai' des dépôts fossilifères,
dans la région (l'IIérenlbals-Caslerlé p a r de s plages sableuses, et à (leyst el à Beersel par
des argiles de l agune ou d'esluaire.
Toute cette série formerait un étage diestien supé r i eur . Quant au niveau cailloiiteux cl gr ave l eux,
qui, à An ve r s c omme dans la ]'égion d'IIérenibais-Casterlé , ravine les sables gris, il consliluerail
la base du sys t ème scaldisien, r édui l au.v sables à Troplton mtiqimm. Ceci conf i rme notre opinion
aiiti'el'ois cxpi'imée dans VEsquisse, ainsi que r é c emment encor e , dans un aut r e travail ( - ) .
Nous avons expos é les diverses raisons qui militent en f aveur de celte int e rpr e t a t ion, a p p u y é e
d'ailleurs par ce fait |)resque certain que les sables fossilifères à hovaniia cor sont restés incomms
de Du mo n t , qui n'a donc pu c omp r e n d r e dans son scaldisien que les dè|)ôts à Trophon anliq^ium.
QuaiU aux sables gr i s non fossilifères de la région d' I l é r enlba l s -Oa s i c r l é , ils avaient suggé r é à
Dumoni l'idée de la création de son sys i ème Caslerlion ( ' ) . Il n' abandonna cette vue que parce que,
trompé par l'aspect miné r a logiqne de s grès fossilifères scaklisiens qui se présentent au-de s sus du
casterlien, il les rattacha au d i e s t i e n ; ce qui l'engagea ii faire r en t r e r le casterlien dans la série
bolderienne ou oligocène.
Il résulte de ce qui précède ([ue si, pour Tune ou l'autre raison, les dépôts surmoiUanl à Anvers,
Héi'enthals, Liclilaerl, Casterlé, Poedcrlé , IIeysl-o))-(lcn-Berg el Beersel, le dieslien type — el qui
presque partout soni r e couve r t s pa r la base caillouteuse des sables à Trophon aniiquum — ne
pouvaient l'estei- r éuni s au dieslien pour en constituer l'étage supéj'ieur ou ca.^terlien, il faudrait pour
les recevoir r e p r e n d r e le si/sièum easterlies de Dumo n t et diviser alors la série |)hocène belge en
trois groupe s : dieslien, casterlien el scaldisien.
On r evi endr a it ainsi à la division en trois horizons, proposée dans noire Esquisse, abstraction
faite, bien ent endu, des dépôts anve r s i ens mioc ène s on inio-|)liocènes r a t t a ché s à cette épo(iue par
nous, c omme par d' aut r e s géologues d'ailleurs, à la période pliocène infériem-e.
La solution de celle question intéressante ne peul se faire altendi'e el quelle qu'elle puisse être
(1) C-esi
•lier II lèdi a
qui, depuis longlcraps ilaillours, nous païuissait riisuitcr de la doscripüo)) du
observé en tST-i, par M. Cogels, aux nouveaux bassins, là oii les doux (biniali.
contaci, avec zone
ins sont l'ossi li ¡'ères.
(-) Exposé sotniiiaire des obscrvalioiis cl déco ii ver h
marins el /Juvio-marins du limbourg, pendaiil les
MAL.VC- DE iiELGigUK, t. .Wl, 18SI. |)|). ISo-Hr..)
(•) Ce ¡10)111 CSI délinitivemont dóninnlré par cliver
M. M. Moiirlon. Voir, par exproplo, la coupe an N. de
siraliijraphiqiies et paléonKiliiguiues, [ailes dam le
nées I880-18SI. par Krnusl Van den Broeck. (A? i- Soc
?3ges dii inme IV ,les Méw
(Casterlé), pp. oôOc l : ;U.
res de î)nmon(, édités par
LNTBODUCTION.
il est i r r évoc abl ement établi que la f aune des sables à hoeanHa cor, dont les éléments ont été
décrits dans le présent travail du savant concliyliologisle belge avec c eux des sables scaklisiens à
Trophon. auliqiiniii, il est établi, disons-nous, que celle f aune doil se s épa r e r netlemetil de celle de
ces de rni e r s [lour constituer un horizon spécial : casterlien ou diestien, r epr ésentant très exa c t ement
le CoviiUiiie Cray, de même que les sables à Trophon oniiquam forment le cor r e spondant exa c t
du Red Cra/j.
Les éléments actuellemenl connus de la faune du sable diestien type, au Pe l l enbe rg et au Bolde r -
herg dénoleiit d'étroiles analogies avec la faune des sables à Ixoeardia cor, et t endent à r e s s e r r e r
encore des liens que la s t r a t igr aphi e mont r e lois que la réunion de ces dépôts en un seul group e
parait dès aujourd'hu i assurée, si l'on n' adme l pas l'inti'oduclion d'un sys t ème casterlien.
On comprend aisément (pie M. Xy s t , ne pouvaul suivre ni vérifier par l u i -même les inl e r -
prélaiions diverses qui se sont succédé si r apidement dans ces de rni è r es anné e s d ' é l a b o r a t i o n ,
et n ' a \ a n i d'ailleurs pour bui que la description zoologique de s éléments de la l'aune pliocène be lge ,
se soit ahstciui de p r e n d r e [losition dans les avis en présence.
Il convenait touicfois dans l'intérêt de la science et du travail lui -même , de compl é t e r celui-ci
par l'exposé motivé des données s l r a l igruphiqa e s aujourd'hu i déliiiilivemenl acquises et qui pe r -
metient do donne r à l'oeuvre du savant paléontologue u n e portée qu'il eut été regrcllable de ne
pas lui voir attribuée.
C'est celte tiiche qu'il nous a éié permis d'accomplir, grâce à l'olTre bienveillanle de M. le Di r e c -
teur du Musée royal d'histoire naturelle, cl nous le r eme r c i o ns ici de nous avoir mi s à même de
rendre ce dernier h omma g e à celui qui fut pour nous un ma î t r e alTahle el véné r é , dont les e n c o u -
ragements et la bienveillante s ymp a t h i e se sont acquis d'éternels droits à notre r e conna i s s anc e.
2» DESCRIPTION SOMMAIHIÍ DES COrCI IES .
L'exposé qui vient de mo n t r e r la dualité d'origine de s éléments fauniques décrits dans le présent
travail fait compr endr e qu'il esl indispensable, dans le chapi t re cons a c ré à la description s omma i r e
des conches qui se trouvent ici réunies c omme s c a ldi s i enne s , de s épa r e r les donné e s des deux
horizons : systèmes ou étages, — quels (ju'en soient les noms ou la va l eur , — qui existent positivement
au sein des dépôts fossilifères dont la faune esl compr i s e dans la mo n o g r a p h i e de M. Nvst.
(7est pourquoi, dans l'exposé qui va suivre, nous aur on s soin d' indiquer s épa r êmen i les caractères
siratigraphii|nes, lithologiques, etc., des deux hor i zons en ([uestion, sans p r é j u g e r en rien d'ailleurs
des conclusions synthéli(|ues (|u'un avenir prochain | ) ermeUr a , sans nul d o u t e , d'établir définitivement.
I. Caractères yvuëraux sédiineiitaires.
SABLES A TISOPIIOX AXTIQUUM. — Aux envi rons d'Anvers, les dépôt s de cet horizon se p r é s e n t e n t
sous forme de sédiments géné r a l ement meubl e s , ar énacés, souvent un peu a rgi l eux, géné r a l ement
jaunâtres ou i'ougeàtres, pins r a r ement gr i s â t r e s ou d'un gris bl euâ t r e un peu c endr é .
A certains niveaux la [iroportion de glauconic qu'ils cont i enneni n o rma l eme n t s ' augmeni e et
leur donne nu aspect foncé ou noirâtre, r appe l ant cur i eus ement celui dos sables gl auconi f è r es des
horizons miocènes et [)liocènes inférieurs, qui s'observent pins bas.
Les sables à Trophon antiquum sont géné r a l ement fossilifères et a b o n d e n t en restes organique s
de toute espèce. lis contieimenl de s i)ancs coquillicrs compa c t e s , avec é l ément s iriiurés ou parfois
in aiin el formant souvent u n e vérital)le lumachelle . Tel esl le cas surtout pour le banc coquillier