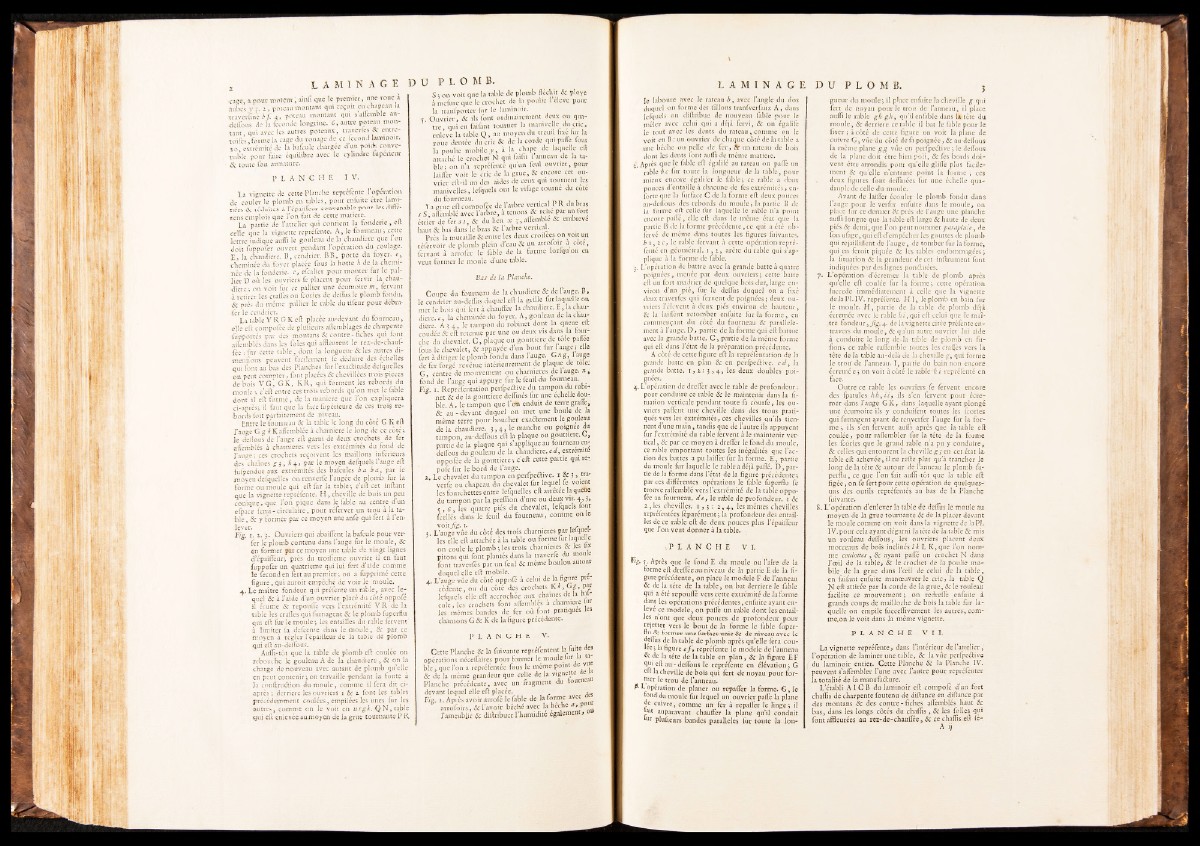
s l a m i n a g e
■ cage, a pour -moteur ; ainfi que le premier, une roue à
iuibes y r. z , poteau montant qui reçoit en chapeau la
traverïine b ƒ 4 , poteau montant qui s’ alfemblc au-
deffous de la fécondé longrinc. C, autre poteau montant
qui avec les autres poteaux, traverfes & emre-
toifes forme la cage du rouage de ce fécond laminoir,
t o . extrémité de la bafcule chargée d'un poitb conve-
■ nable pour faire équilibre avec le cylindre luperreur
Sc toute fon armature.
P L A N C H E I V.
L a vignette de cette Planche repréfente l’ opération
de couler le plomb en tables, pour enfuite être laminées
& réduites à l’ épailîeur convenable pour les difte-
rens emplois que l’on fait de cette matière.
La partie de l’attelier qui contient la fonderie, elt
celle que la vignette repréfente. A , le fourneau ; cette
lettre indique aufli le gouleau de la chaudière que 1 on
doit fuppofer ouvert pendant l’opération du coulage.
E , la chaudière. B , cendrier. B B , porte du foyer. e ,
-cheminée du foyer placée fous la hotte h de la cheminée
de la fonderie, c , efcalier pour monter fur le pallier
D où les ouvriers fe placent pour fervir la chaudière,
on voit fur ce pallier une écumoire m, fervant
à retirer les crafles ou feories de deffus le plomb fondu,
& près du meme pallier le rable du tifeur pour débrà-
fer le cendrier.
La table V R G K e f t placée au-devant du fourneau,
elle eft compofée de plufieurs aflemblages de charpente
fupportés par des montans & contre - fiches qui font
aftèmblés dans les foies qui affleurent le rez-de-chauf-
fée : fur cette table, dont la longueur & le s autres di-
menfions peuvent facilement fe déduire des echelles
qui font au bas des Planches fur l’exaélitude desquelles
on peut compter, font placées & chevillées trois pièces
de bois V G , G K , K R , qui forment les rebords du
moule -, c’eft entre ces trois rebords qu’on met le fable
dont il eft: fo rmé, de la maniéré que l’on expliquera
ci-après; il faut que la face fupérieure de ces trois rebords
foit parfaitement de niveau.
Entre le fourneau & la table le long du côté G K eft
l'auge G g k K aflèmblée à charnière le long de ce côté ;
le dellous de l’ auge eft garni de deux crochets de fer
aftèmblés à charnières vers les extrémités du fond de
l ’auge ; ces crochets reçoivent les maillons inférieurs
des chaînes g 3 , k 4 , par le moyen defquels l’auge eft
ful'pendue aux extrémités des bafcules b a b a , par le
moyen defquelles on renverfe l’augée de plomb fur la
forme ou moule qui eft fur la table ; c’ eft cet inftanc
que la vignette repréfente. H , cheville de bois un peu
conique, que l’on pique dans le fable au centre d’un
efpace femi - circulaire, pour réferver un trou à la ta-
i>le, & y former par ce moyen une anfe qui fert à l’enlever.
Fig. 1 . 1 . 3. Ouvriers qui abaifTent la bafcule pour ver-
fer le plomb contenu dans l’auge fur le moule, &
en former par ce moyen une table de vingt lignes
d’épaiflèur; près du troifieme ouvrier il en faut
iuppofer un quatrième qui lui fert d’aide comme
le fécond en fert au premier ; on a fupprimé cette
figure, qui auroit empêché de vo ir le moule.
4 . L e maître fondeur qui préfenre un rable, avec lequel
8c à l’aide d’un ouvrier placé du côté oppofé
D U P L O M B .
il écume & tepoufle vers l’extrémité V R de la
table les crafles qui furnagent 8c le plomb fuperflu
qui eft fur le moule; les entailles du rable fervent'
à limiter fa defeente dans le moule, & par ce
moyen à régler l’cpaifleur de la table de plomb
qui eft au- deflous.
Aufli-tôt que la table de plomb eft coulée on
rebouche le gouleau A de la chaudière , & on la
charge de nouveau avec autant de plomb qu’elle
en peut contenir; on travaille pendant la fonte a
Ja conftrutftion du moule, comme il fera dit ci-
après : derrière les ouvriers 1 & 1 font les tables
précédemment coulées, empilées les unes fur les
autres,, comme on le voit en u rg k . Q N , table
qui eft enievée au moyen de la grue tournante P R
S ; on voit que la table de plomb fléchit & ployé
à mclure que le crochet de la poulie 1 eleve pour
la cran (porter fur le laminoir.
k. Ou vr ie r , & ils font ordinairement deux ou quat
r e , qui en faifànt tourner la manivelle du cric,
enleve la table Q , au moyen du treuil fixe (ur la
roue dentée du cric & de la corde qui paflè fous
la poulie mobile y , à la chape de laquelle eft
attaché le crochet N qui faifu 1 anneau de la tab
le ; on n’a repréfencé qu’un feul ouvrier, pour
laifler voir le cric de la grue , & encore cet ouvrier
eft-il un des aides de ceux qui tournent les
manivelles, lefquels ont le vifage tourne du cote
du fourneau. I ,
La grue eft compofée de l’ arbre vertical P R du bras
s S affemblé avec l’arbre, à tenons & reke par un fort
ctrier de fer s i , 8c du lien ar aflemblc 8c embreve
haut 8c bas dans le bras 8c 1 arbre vertical.
Près la muraille 8c entre les deux croifées on voit un
réfervoir de plomb plein d’eau 8c un arrofoir a^ cote,
fervant à arrofer le fable de la forme lorfqu on en
veut former le moule d’une table.
Bas de la Flanche.
Coupe du fourneau de la chaudière & d e 1 auge. B ,
le cendrier au-deffus duquel eft la grille fur laquelle on
met le bois qui fert à chauffer la chaudière. E , a chaudière.
e , la cheminée du foyer. A , gouleau de la chaudière.
A j 4 , le tampon du robinet dont la queue eft
coudée & eft retenue par une ou deux vis dans la fourche
du chevalet. C , plaque ou gouttière de tôle paflee
fous le chevalet, 8c appuyée d’un bout fur 1 auge ; elle
fert à diriger le plomb fondu dans l’auge. G n g , 1 auge
de fer forgé revêtue intérieurement de plaque de tôle.1
G , centre de mouvement ou charnières de l’auge. » ,
fond de l’auge qui appuyé fur le feuil du fourneau.
Fig. i . Repréfentation perfpeétive du tampon du robinet
& de la gouttière deffinés fur une échelle double.
A , le tampon que l’cm enduit de terre grade,
& au - devant duquel on met une boule de la
même terre pour boucher exactement le gouleau
de la chaudière. 3 , 4 > le manche ou poignee du
tampon, au-deffous eft la plaque ou gouttière. C ,
partie de la plaque qui s’ applique au fourneau en-
deflous du gouleau de la chaudière, c d , extrémité
oppofée de la gouttière; c’eft cette parue qutre-,
pofe fur le bord de l’ auge.
2. Le chevalet du tampbn en perfpeCtive. 1 8c 3 , traverfe
ou chapeau du chevalet fur lequel fe voi«it
les fourchettes entre lefquelles eft arretee la qudne
du tampon par la prefiion d’une ou deux vis. 4 , 3>
r , <5} les quatre pics du chevalet, lefquels font
fcellés dans le feuil du fourneau, comme on le
vo it fig. 1. . t r i
3. L ’auge vue du côté des trois charnières par lelqueiles
elle eft attachée à la table ou forme fur laquelle
on coule le plomb ; les trois charnières 8c les nx
pitons qui font plantés dans la traverfe du moule
font traverfés par un feul 8c même boulon autour
duquel elle eft mobile. ^
4. L ’auge vue du côté oppofé à celui de la figure précédente,
ou du côté des crochets K A, G g , pac
lefquels elle eft accrochée aux chaînes de la ba -
cule , les crochets font affemblés à charnière ur
les mêmes bandes de fer où font pratiques les
charnons G & K de la figure precedente.
P L A N C H E V.
Cette Planche & la fuivante reprefentent k
opérations néceflaires pour former le moule fur la ta
b le , que l'on a repréfentée fous le meme point e v
& de la même grandeur que celle de la vignette e •
Planche précédente, avec un fragment du tourne
devant lequel elle eft placée. «
Fig. 1. Après avoir arrofé le fable de la forme ave
a rrofoirs, & l’avoir bêché avec la beche a , P
l’ameubiir 8c diftribucr l’humidité egalement >
L A M I N A G E
le laboure avec le rateau b , avec l’angle du dos
duquel on forme des filions tranfverfaux A , dans
lefquels on diftribuc de nouveau fable pour le
mêler avec celui qui a déjà fervi, 8c on egalife
le tout avec les dents du rateau, comme on le
voit en B : un ouvrier de chaque côté de la table a
une bêche ou pelle de fe r , <3f un rateau de bois
dont les dents font aufli de même matière.
a. Après que Je fable eft égalifé au rateau on pafle un
rable b c fur toute la longueur de la table, pour
mieux encore égalifer le fable; ce rable a deux
pouces d’ entaille à chacune de fes extrémités, en-
forte que la furfacc C de la forme eft deux pouces
au-deflous des rebords du moule; la partie B de
la forme eft celle fur laquelle le rable n’a point
encore paflè, elle eft dans le même état que la
partie B de la forme précédente, ce qui a été ob-
fervé de même dans toutes les figures fuivantes.
b 1 , i c , le rable fervant à cette opération repré-
ferne en géométral. r , 2 , arête du rable qui s’applique
à la forme de fable.
1. L’opération de battre avec la grande batte à quatre
poignées, menee par deux ouvriers ; cette batte
eft un fort madrier de quelque bois dur, large environ
d’un pié, fur le deflus duquel on a fixé
deux traverfes qui fervent de poignées; deux ouvriers
relèvent à deux piés environ de hauteur,
8c la laiflènt retomber enfuite fur la fo rm e , en
commençant du côté du fourneau & parallèlement
à l’auge. D , partie de la forme qui eft battue
avec la grande batte. C , partie de. la même forme
qui eft dans l’état de la préparation précédente.
A côté de cette figure eft la repréfentation de la
grande batte en plan & en pcrfpective. c d , la
grande batte. 1 , 1 : 3 j 4 , les deux doubles poignées.
'4. L ’opération de dreflèr avec le rable de profondeur;
pour conduire ce rable 8c le maintenir dans la fî-
tuation verticale pendant toute fa côurfe, les ouvriers
paffcnt une cheville dans des trous pratiqués
vers les extrémités, ces chevilles qu’ils tiennent
d’une main, tandis que de l’autre ils appuyent
fur l’extrémité du rable fervent à le maintenir ve rtical
, & par ce moyen à dreflèr le fond du moule,
ce rable emportant toutes les inégalités que l’action
des battes a pu laifler fur la forme. E , partie
du moule fur laquelle le rable a déjà pafle. D , partie
de la forme dans l’état de la figure précédente;
par ces différentes opérations le fable fuperflu fe
trouve raflemblé vers l’extrémité de la table oppofée
au fourneau, d e , le rable de profondeur. 1 8c
a , les chevilles; 1 , 3 : 2 , 4 , les mêmes chevilles
repréfentées féparément ; la profondeur des entailles
de ce rable eft de deux pouces plus l’épailfeur
que l’on veut donner à la table.
^ P L A N C H E V I .
rig. f. Après que le fond E du moule ou l’aire de la
forme eft dreflee au niveau de la partie E de la figure
précédente, on place le modèle F de l’anneau
& de la tête de la table, on bat derrière le feble
qui a été repoufle vers cette extrémité de la forme
dans les opérations précédentes, enfuite ayant enleve
ce modèle, on paflè un rable dont les entailles
n’ont que deux pouces de profondeur pour
rejetter vers le bout de la forme Je fable fuperflu
8c former une furface unie & de niveau avec le
deflus de la table de plomb après qu’elle fera cou-
k e ; la figure e f , reprefente le modèle de l’anneau
& de la tête de la table en plan , 8c la figure E F
qui eft au - deffous le repréfente en élévation ; G |
eft la cheville de bois qui fert de noyau pour former
le trou de l’anneau.
P* L operation de planer ou repaflèr la forme. G , le
fond du moule fur lequel un ouvrier paflè la plane
de cuivre, comme un fer à repaflèr le linge ; il
k it auparavant chauffer la plane qu’il conduit
*uc plufieurs bandes parallèles fur toute la Ion-
D U P L O M B. 3
gueur du moule; il place enfuite la cheville g qui
fert de noyau pour le trou de l’anneau, il place
aufli le rable gh g l i , qu’ il enfable dans la tête du.
moule, 8c derrière ce rable il bat le fable pour Je
fixer ; à côté de cette figure on voit la plane de
cuivre G , vâ cd u côté de fia poignée, 8c au-de(Tous
Ja même plane g g vue en perfpeélive; le deflous
de la plane doit être bien poli, 8c fies bords doivent
erre arrondis pour qu’elle glifle plus facilement
8c qu’elle n’entame point la forme ; ces
. deux figures font deflînées fur une échelle quadruple
de celle du moule.
Avant/de laifler écouler le plomb fondu dans
Jauge pour le verfer enfuite dans le moule, 011
place fur ce dernier 8c près de l’auge une planche
aufli longue que la table eft large 8c haute de deux
piés 8c demi, que l’on peut nommer parapluie, de
fon ufàge, qui eft d’empêcher les gouttes de plomb
qui rejailliffent de l’auge , de tomber fur la forme,
qui en feroit piquée & les tables endommagées ;
la ficuation & la grandeur de cet infiniment font
indiquées par des lignes ponctuées.
7. L opération d’écremer la table de plomb après
qu’elle eft coulée fur la forme; cette opération
fucccde immédiatement à celle que la vignette
de la PI. IV. repréfente. H I , le plomb en bain fur
le moule. H , partie de Ja table de plomb déjà
écremée avec le rable h i ,q ui eft celui que le maître
fo n d e u r ,^ . 4. de la vignette citée prefente entravers
du moule, 8c qu’ un autre ouvrier lui aide
à conduire le long de-la table de plomb' en fu-
fion ; ce rable raffemble toutes les crafles vers la
tête de la table au-delà de la cheville g , qui forme
le trotf de l’anneau. I , partie du bain non encore
écrémé e ; dn voit à côté le rable 'h i repréfenté en
face.
Outre ce rable les ouvriers fe fervent encore
des fpatules h h , i i , ils s’en fervent pour écrémer
dans l’auge G K , dans laquelle ayant plongé
une écumoire ils y conduifent toutes les feories
qui furnagent avant de renverfer l’auge fur la forme
; ils s’ en fervent aufli après que la table eft
coulée, pour raflembler fur la tête de la forme
les feories que le grand rable n’a pu y conduire,
& celles qui entourent la cheville g , en cet état la-
table eft achevée, il ne refte plus qu’à trancher le
long de la tête & autour de l’anneau le plomb fuperflu,
ce que l’on fait auffi-tôt que la table eft
figée, on fe fert pour cette opération de quelques-
uns des outils repréfentés au bas de la Planche
fuivante.
8. L ’opération d’enlever la table de deflus le moule au
moyen de la grue tournante & de la placer devant
le moule comme on voit dans la vignette de la PI.
IV. pour cela ayant dégarni la tête de la table 8c mis
un rouleau deflous, les ouvriers placent deux
morceaux de bois inclinés l k L K , que l’on nomme
coulottes , & ayant pafle un crochet N dans
l ’oeil de la table, & le crochet de la poulie mobile
de la grue dans l’oeil de celui çle la table,
en faifant enfuite manoeuvrer le cric, la table Q
N eft attirée par la corde de la grue, 8c le rouleau
facilite ce mouvement ; on redreffe enfuite à
grands coups de mailloche de bois la table iùr laquelle
on empile fucceffîvement les autres, com-
ine„on le voit dans la même vignette.
P L A N C H E V I I .
La vignette repréfente, dans l’intérieur d e l’attelier,
l ’opération de laminer une table, 8c la vue perfpeélivc
du laminoir entier. Cette Planche 8c la Planche IV.
peuvent s’aflèmbler l’une avec l’autre pour repréfenter
la totalité de la manufaélure.
L ’établi A I C B du laminoir eft compofé d’un.fort
chaffis de charpente foutenu de diftance en diftance par
des montans & des contre-fiches affemblés haut 8c
bas, dans les longs côtés du chaffis , & les folles qui
font affleurées au rez-de-chauffée, & ce chaffis eft fc-
A ij